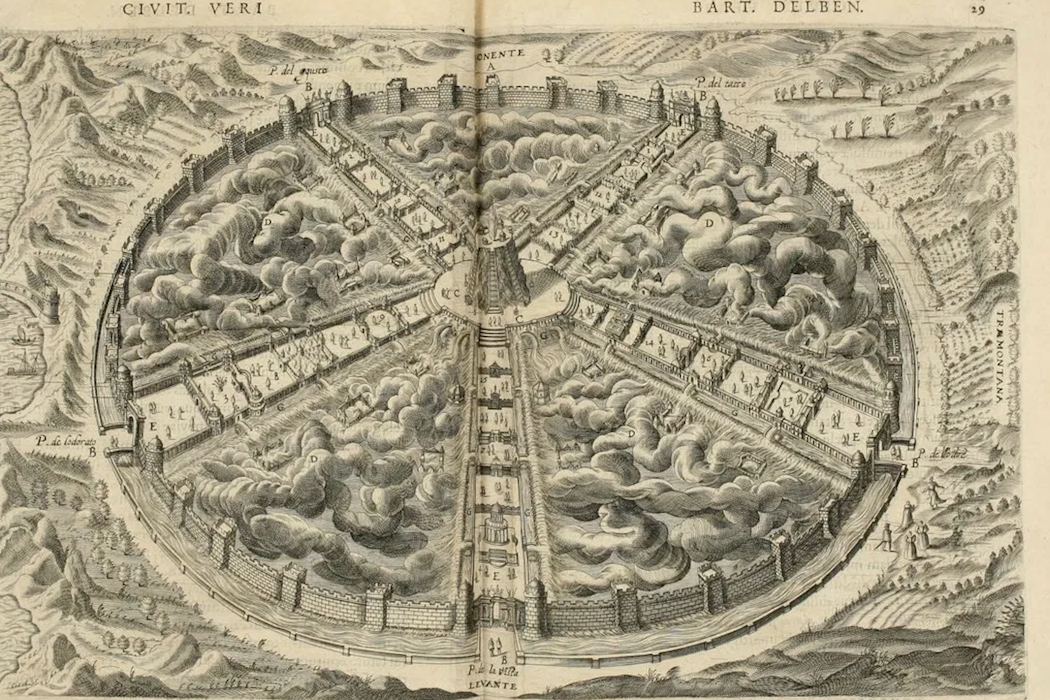Source: The Conversation – in French – By Heike Baldauf-Quilliatre, analyse interactionnelles, interaction en situation de jeux, interaction avec des robots sociaux, interaction à travers des dispositifs technologiques, Université Lumière Lyon 2

Si l’on veut comprendre le jeu et sa place dans nos sociétés, il faut s’intéresser aux joueurs et à leurs interactions. Filmer les situations de jeu offre une lecture renouvelée qui en dévoile le potentiel d’expérimentation sociale.
Des rayons pleins, des ludothèques et magasins spécialisés, des associations, un festival international des jeux annuel en France, des revues scientifiques (Sciences du jeu, Board Games Studies Journal) et même un dictionnaire qui leur est consacré – les jeux sont loin d’être un simple passe-temps d’enfant. Et celui qui pense uniquement aux jeux vidéo ou aux jeux télévisés ou encore aux jeux d’argent, lorsqu’il est question des adultes, se trompe. Les jeux de société aussi occupent une place importante pour ces derniers.
Dans un article paru en 2021, Vincent Berry, sociologue et spécialiste du jeu, remarque une hausse continue du chiffre d’affaires dans ce secteur, un développement constant de nouveaux jeux et une hausse du temps consacré aux jeux en tant qu’activité de loisir. Mais que peut-on trouver dans cette activité pour qu’elle gagne autant en popularité ? Pourquoi des personnes de différents âges se réunissent-elles autour des jeux de société ?
Penser le jeu au cœur de la vie sociale
Un élément de réponse se trouve déjà dans cette dernière question. Le jeu est une activité sociale qui réunit des personnes, à travers les âges, autour d’une même activité. Cela ne va pas de soi, pour plusieurs raisons. D’une part, parce que le jeu n’est pas systématiquement lié à une activité ludique. Lorsqu’on est dans une situation de confrontation, ou en train de perdre, le jeu n’est pas principalement un plaisir. Le côté ludique est construit, par les joueurs et joueuses, pendant et à travers le jeu. Évidemment, le cadre du jeu favorise ce côté ludique, mais il ne l’implique pas obligatoirement.
D’autre part, le jeu n’existe pas en dehors de tout autre cadre ou activité sociale : on joue à la maison, dans un bar, au travail, en famille, entre collègues, avec des inconnus. Et, pendant qu’on joue, on boit, on mange, on répond au téléphone, on parle avec des gens qui passent, etc.
Enregistrer les situations de jeu
Si l’on veut comprendre le jeu et sa place dans nos sociétés, il faut donc s’intéresser au jeu en tant que tel, mais également aux joueurs et à ce qu’ils font dans une situation et à un moment précis. C’est sur ce point que débutent nos recherches.
Dans notre approche, on porte l’attention aux pratiques des joueurs et joueuses et on essaye de comprendre comment ils et elles construisent cette activité dans une situation sociale donnée. Pour cela, nous filmons et enregistrons des situations de jeu, dans leur cadre naturel. Les personnes qui jouent acceptent d’être filmées pendant des sessions de jeu de société, sans instruction particulière, dans des situations de jeu qui se seraient déroulées même sans l’enregistrement. Le tout sur la base d’un appel à une participation volontaire au projet de recherche.
Nous transcrivons par la suite tout ce que nous entendons et voyons, et analysons ces situations en prêtant attention à tous les détails (parole, gestes, mimique, manipulation d’objets). Nous nous appuyons sur la méthodologie de l’analyse conversationnelle, dont le but est de décrire comment nous organisons et construisons nos sociétés à travers les interactions.
Nous ne nous intéressons pas tant à ce que disent les personnes, mais plutôt à la manière dont elles agissent ensemble, les pratiques par lesquelles elles construisent leur activité. On peut ainsi observer comment les joueurs et joueuses construisent ensemble des (ou leurs) visions du monde, comment ils intègrent le jeu dans leurs pratiques du quotidien, comment ils (s’)expérimentent en transgressant des règles, en créant ou inversant des catégories. Nos différentes analyses apportent des briques d’éléments de réponse à la grande question : pourquoi les gens jouent-ils aux jeux de société ?
Apprendre, s’organiser et s’amuser
Différentes activités sociales sont associées au jeu. Autrement dit, que font les personnes lorsqu’elles jouent ? Dans nos données, qui contiennent essentiellement des jeux en famille et entre amis à la maison, ou bien entre collègues au travail, nous avons observé trois grands types d’activités : apprendre, s’organiser et s’amuser.
L’apprentissage dans un sens très large n’est pas limité aux jeux éducatifs ou aux enfants. En jouant, on se confronte à différentes visions du monde et on se construit en tant qu’individu et comme groupe, à travers des règles et des normes morales. Cela va de l’apprentissage de ce qui est accepté, souhaité ou recommandé dans un jeu particulier à la connaissance et aux pratiques sociétales de manière générale.
Dans l’extrait en ligne d’une famille jouant à Timeline Inventions, l’année de naissance de la mère a permis de construire des repères pour situer l’invention dans la ligne temporelle du jeu.
D’une part, les échanges autour de tout et de n’importe quoi permettent de découvrir d’autres façons de voir les choses, d’autres préoccupations, et ainsi d’élargir nos horizons. D’autre part, ces échanges participent à la construction discursive du groupe en tant que tel et, dans une perspective plus large, de nos sociétés. Pour donner un exemple, Emilie Hofstetter et Jessica Robles ont montré dans un article sur la manipulation stratégique dans le jeu, que les types de manipulation autorisés (jusqu’où peut-on aller pour gagner ?) sont constamment et négociés pendant le jeu sur la base de certaines valeurs d’équité et de moralité.
L’aspect organisationnel concerne la régulation du jeu, c’est-à-dire l’alternance des tours de jeu, le respect des règles, mais aussi la vie sociale qui se poursuit autour. Car, lorsqu’on joue, le monde ne s’arrête pas de tourner. Il y a des personnes et des activités autour des joueurs qui existent en dehors du jeu : d’autres personnes dans la même pièce, un téléphone qui sonne, des conversations entre certains joueurs, des activités parallèles comme manger et boire. L’analyse conversationnelle parle ici de multiactivité qui est gérée de différentes manières. Cependant, ce n’est pas la multiactivité en soi qui est recherchée dans le jeu, mais plutôt les possibilités qu’ouvre cette implication dans différentes activités :on ne joue pas pour pouvoir faire plusieurs activités en même temps, mais on utilise les opportunités qui s’offrent grâce à cela.
Ainsi, des activités parallèles permettent de gagner du temps dans le jeu ou bien, à l’inverse, le jeu permet d’adoucir une discussion sérieuse, un reproche ou une transgression des règles sociales du groupe. Par exemple, les pleurs d’une fille ouvrent pour les parents un moment éducatif tout en gardant le focus principal sur le jeu (et donc sur le plaisir partagé).
L’expérimentation de pratiques sociales peu appréciées, sans craindre de sanctions
Enfin, l’amusement paraît certainement le type d’activité le plus évident lorsqu’on parle du jeu. Nos données et nos analyses montrent de manière plus détaillée en quoi consiste cet amusement. Le jeu permet par exemple d’expérimenter des catégorisations sociales, bien évidemment en adossant des identités dans le jeu, mais également en jouant avec les ambiguïtés entre le monde du jeu et le monde des joueurs : être la princesse et donc solliciter l’aide des autres pour ranger ses cartes, être pauvre dans le jeu et dans la vie et demander de l’aide aux autres, être sérieux dans son rôle du jeu ou, au contraire, ne pas le prendre au sérieux et donc brouiller les pistes pour les autres.
Dans cet extrait en ligne, qui montre une partie du jeu Catane entre trois amis, Romain rappelle Marie à l’ordre pour ranger ses cartes. Elle refuse en se référant à ses cartes et en indiquant qu’une princesse a bien le droit de déléguer ces tâches.
Il permet aussi d’inverser les rôles entre parents et enfants (les enfants expliquent et applaudissent les parents), ou bien de jouer avec la compétition (renforcer le caractère compétitif ou bien collaboratif d’un jeu, indépendamment du type de jeu). Il permet d’expérimenter des pratiques sociales peu appréciées ou peu communes, sans la crainte d’une sanction sociale : dans le jeu, on peut se moquer des autres, on peut apprécier les attaques, et on peut même explicitement « détester » une personne présente, comme dans cet extrait en ligne, dans une partie de Splendor.
Cela ne situe pas le jeu en dehors du cadre social, comme on le pensait au début des études sur le jeu, mais comme un espace de la vie où l’on peut expérimenter.
Et si l’on n’aime pas le jeu ? Ce n’est évidemment pas bien grave. On le répète, le côté ludique n’est pas directement lié au jeu, on peut le trouver, le construire partout dans ses activités sociales. Faire du sport et même travailler peut également avoir des moments ludiques, autant que le jeu n’est pas ludique en soi. D’où notre intérêt pour les interactions qui permettent d’observer comment les joueurs et joueuses construisent ce côté ludique dans des situations concrètes.
![]()
Heike Baldauf-Quilliatre a reçu des financements de l’ENS de Lyon et du LabEx ASLAN (ANR).
Isabel Colon de Carvajal a reçu des financements de l’ENS de Lyon et du LabEx ASLAN (ANR).
– ref. Pourquoi les jeux de société sont-ils plus populaires que jamais ? – https://theconversation.com/pourquoi-les-jeux-de-societe-sont-ils-plus-populaires-que-jamais-272919