Source: The Conversation – France in French (3) – By Franck Frégosi, Politiste, directeur de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po Aix, Aix-Marseille Université (AMU)
Un sondage réalisé par l’institut Ifop conclut à une forte poussée de religiosité, de rigorisme et de soutien à la mouvance islamiste chez les musulmans de France. Cette étude, critiquée pour ses biais méthodologiques, a été commanditée par une revue soupçonnée de liens avec les Émirats arabes unis. Quelle est la valeur de cette enquête dont les chiffres alimentent déjà le débat politique ? Quelles sont les conclusions d’autres études portant sur ces questions ? Entretien avec Franck Frégosi, spécialiste de l’islam en France, ainsi qu’avec Patrick Simon et Vincent Tiberj, auteurs des analyses sur la religion des enquêtes Trajectoires et origines (Insee/Ined).
The Conversation : Selon une étude de l’Ifop, les musulmans affichent, en France, un degré de religiosité largement supérieur aux autres religions : 80 % se déclareraient « religieux », contre 48 % en moyenne chez les adeptes des autres religions. La pratique quotidienne de la prière chez les musulmans aurait aussi augmenté, passant de 41 % en 1989 à 62 % en 2025. Comment recevez-vous ces chiffres ?
Vincent Tiberj : Quand vous êtes originaire d’un pays où 90 % des gens vous disent que la religion c’est très important (ce que montrent régulièrement les World Value Surveys), et que vous arrivez en France, alors oui, évidemment, la religion est toujours importante. Cela traduit le lien avec le pays d’origine, et pas forcément une dynamique d’« islamisation » à l’œuvre dans la communauté musulmane française.
On constate chez les immigrés qui se définissent comme religieux, qu’il s’agisse de musulmans, de catholiques, ou même de bouddhistes, qu’ils sont plus souvent conservateurs par rapport à la population française en général. Ainsi, plusieurs enquêtes disent que, chez les musulmans, il y a plus souvent des difficultés à accepter les couples homosexuels et chez certains des préjugés anti-juifs. C’est plus répandu mais pas systématique, bien au contraire ; d’ailleurs, les personnes aux tendances antisémites se retrouvent bien plus souvent à l’extrême droite. Mais, ce que montre l’enquête Trajectoires et origines (TeO, Insee/Ined), c’est que les descendants d’immigrés, nés et socialisés en France, sont beaucoup moins conservateurs que les immigrés. Le fait que l’Ifop se focalise uniquement sur les musulmans en général, sans distinguer les immigrés et leurs descendants, pose un gros problème méthodologique pour estimer s’il y a vraiment une montée en puissance de la religion.
Franck Frégosi : L’Ifop met l’accent sur des indicateurs de religiosité en hausse à travers la fréquentation des mosquées, la prière individuelle, l’observance des règles alimentaires, vestimentaires, le degré d’acceptation de la mixité. Mais attention aux biais de lecture ! Un exemple : la proportion de personnes faisant le ramadan est en hausse, mais la pratique du ramadan est-elle vraiment un critère de religiosité ? C’est davantage un marqueur communautaire ou peut être identitaire. Dans des familles où la pratique religieuse individuelle régulière n’est pas la norme, pendant le mois de ramadan, on va jeûner et partager le repas de rupture du jeûne (y compris avec les voisins qui ne sont pas nécessairement musulmans). Pour certaines personnes dégagées de tout lien avec une communauté priante, c’est souvent le seul lien qui les relie encore à l’islam. Est-on encore dans la religiosité ? Cet indicateur doit être questionné.
Que nous disent les enquêtes TeO que vous avez menées sur la religiosité des musulmans de France ?
Patrick Simon : L’enquête TeO 2, réalisée en 2019-2020, et qui concernait 7 400 musulmans (un panel bien supérieur à l’enquête Ifop) permet de constater une stabilité du rapport au religieux chez les musulmans par rapport à l’enquête TeO 1 de 2008-2009. Certains indicateurs montrent même une légère diminution de la religiosité.
On demande par exemple quelle importance joue la religion dans la vie des personnes interrogées. De fait, les musulmans (41 %) déclarent nettement plus que les catholiques (14 %) que la religion joue un rôle très important dans leur vie. Le niveau des musulmans est en revanche assez comparable de celui déclaré par les juifs dans l’enquête. Ces chiffres étaient plus élevés pour les musulmans en 2008-2009 lors de la première enquête TeO (49 %). En dix ans, sur cet indicateur, la religiosité est donc un peu moins intense parmi les musulmans en France.
Un autre indicateur donne une perspective comparable de légère baisse du rapport à la religion : on enregistre les différentes dimensions de l’identité des personnes interrogées, dont la religion. Les catholiques citent rarement la religion comme dimension significative de leur identité, moins de 5 % d’entre eux le font, alors que 30 % des musulmans mentionnent la religion comme élément important de leur identité (en association avec d’autres dimensions, comme l’origine, ou leur situation de famille par exemple). La place de la religion a cependant baissé depuis 2008, passant de 33 % à 30 %. A contrario, elle est plus expressive pour les juifs qui sont 54 % à la citer en 2019, pour 46 % en 2008.
Quid de l’islamisation décrite par le sondage Ifop ? Selon l’institut, « un musulman sur trois (33 %) affiche de la sympathie pour au moins une mouvance islamiste : 24 % pour les Frères musulmans, 9 % pour le salafisme, 8 % pour le wahhabisme, 8 % pour le Tabligh, 6 % pour le Takfir et 3 % pour le djihadisme.
Franck Frégosi : L’enquête parle d’islamisme sans aucune définition en amont, comme si cela allait de soi, comme s’il s’agissait d’un item qui ferait consensus. Que mettent les personnes interrogées derrière ce mot ?
Qu’il y ait une augmentation de la fréquentation des mosquées ou de la prière individuelle parmi les jeunes générations musulmanes, soit. Qu’il existe une montée de l’intransigeantisme religieux, pourquoi pas : il s’observe dans toutes les confessions. Mais l’Ifop lie cette évolution à l’influence des réseaux islamistes chez les musulmans de France, ce qui est problématique.
Finalement, on perçoit une volonté de l’Ifop de montrer que les musulmans seraient en décrochage par rapport à la logique de la sécularisation observable dans le reste de la société. Or la sécularisation est un phénomène plus complexe que ce qui avait été décrit. Certains vont jusqu’à parler d’une séquence historique marquée par une désécularisation.
Vincent Tiberj : Concernant l’islamisation, l’enquête TeO ne propose pas d’indicateurs sur ce sujet, donc nous ne pouvons pas faire de comparaisons. En revanche, je note un certain nombre de problèmes dans l’enquête Ifop. Ainsi, on demande à une population s’ils se sentent proches des Frères musulmans, des salafistes, des wahhabites, du Tabligh, du Takfir, des djihadistes… Ce type de question provoque vraisemblablement un effet d’imposition de problématique classique dans les sondages : les gens n’osent pas dire qu’ils ne savent pas mais répondent quand même. Résultat : on se retrouve avec ce chiffre de 24 % des musulmans français qui disent être proches des Frères musulmans. Mais leur a-t-on demandé « Savez-vous vraiment ce que c’est qu’un Frère musulman » ? « Quelles sont leurs idées » ?
Autre exemple : l’Ifop demande « Êtes-vous favorable à l’application de la charia » ? Résultat : 46 % des musulmans estiment que la loi islamique doit être appliquée dans les pays où ils vivent, dont 15 % « intégralement quel que soit le pays dans lequel on vit » et 31 % « en partie », en l’adaptant aux règles du pays où on vit. Mais de quoi parle-t-on exactement ? De couper la main des voleurs ? Ce n’est pas très sérieux…
Dans vos recherches, observez-vous une montée en puissance d’un islam rigoriste ou intégraliste ? Est-ce la traduction d’un « séparatisme » vis-à-vis des lois de la République ?
Franck Frégosi : Certains individus, que l’on peut qualifier de « rigoristes », considèrent qu’il est important d’être scrupuleux sur la consommation pour eux-mêmes et leurs proches de produits labellisés « halal » (ou « casher » pour les juifs). Cela ne les empêche pas d’avoir des relations professionnelles avec des collègues ou de partager un repas avec des non musulmans. Or l’Ifop met en avant l’idée que les musulmans, parce qu’ils seraient plus observants en matière de normes alimentaires, seraient en rupture avec la dynamique de sécularisation de la société. Ce n’est pas forcément exact.
De nombreux musulmans cherchent des accommodements entre une approche plus ou moins orthodoxe de l’islam avec la réalité de la société environnante. Il existe dans l’islam, comme dans d’autres religions, des orthodoxies plurielles. Cela ne veut pas dire nécessairement que ces personnes ont un agenda caché ou que cette évolution est le fruit de l’influence d’un islamisme conquérant, sauf à considérer qu’il faille considérer l’observance religieuse musulmane comme un problème en soi.
Patrick Simon : Depuis quelques années, des enquêtes cherchent à démontrer que les musulmans sont dans une rupture avec la loi commune et avec les valeurs collectives, en utilisant des questions ambiguës dont l’interprétation est sujette à caution, mais qui servent à qualifier un fondamentalisme religieux et la radicalisation. Les questions utilisées dans ces enquêtes sont reprises dans les sondages posant des problèmes d’interprétation similaires et alimentant un procès à charge contre les musulmans. Le sondage de l’Ifop combine des questions factuelles sur les pratiques avec des questions d’attitudes qui ne traduisent pas vraiment les orientations idéologiques qu’on leur prête.
Par exemple, demander si, pour l’abattage rituel, les enquêtés suivent la loi religieuse plutôt que la loi de la République ne va pas de soi. On peut considérer que l’abattage rituel est défini par la doctrine religieuse sans penser nécessairement à transgresser les normes sanitaires. Il ne s’agit donc pas d’une rupture de la loi commune, de mon point de vue. De même, on peut dire qu’on a effectué un mariage religieux sans mariage civil sans être dans une démarche de rupture vis-à-vis de la République. En clair, le choix des questions ne me semble pas conforme à l’interprétation qui en est faite.
L’Ifop relève que 65 % des musulmans pensent que « c’est plutôt la religion qui a raison » par rapport à la science sur la question de la création du monde. Comment interpréter ce résultat ?.
Vincent Tiberj : Les religions portent une culture de l’absolu, rien d’étonnant à cela, mais il faut mesurer la différence entre des grands principes et des cas concrets comme des positions sur l’avortement, l’homosexualité, etc. En 2019, avec ma collègue Nonna Mayer, dans l’enquête Sarcelles, nous avons interrogé les souhaits de scolarisation des enfants et constaté que les musulmans demandent majoritairement une école publique sans éducation religieuse.
Donc plutôt que de jouer les valeurs de l’islam contre les valeurs de la République, on peut partir de cas concrets pour vérifier effectivement comment elles s’articulent ou s’opposent. À Sarcelles, nous avons aussi constaté que la culture intransigeantiste, qui fait passer effectivement la religion devant la République, est lié au fait d’avoir une religion – quelque soit cette religion. On retrouvait les mêmes proportions de musulmans qui faisaient passer le Coran devant la République que de chrétiens avec la Bible et de juifs avec la Torah.
L’Ifop estime que la pratique quotidienne de la prière a atteint des sommets chez les jeunes musulmans de moins de 25 ans : 40 % (contre 24 % chez les 50 ans et plus). Que constatez-vous dans vos propres enquêtes ?
Patrick Simon : L’enquête Trajectoires et origines (TeO 1) posait des questions sur l’intensité de la pratique religieuse et a identifié qu’elle était effectivement plus fréquente chez les jeunes musulmans par rapport aux plus âgés, alors que ce rapport est inversé chez les chrétiens. S’agit-il d’un effet de génération – une réislamisation par rapport aux générations précédentes plus distanciées, thèse fréquemment avancée, notamment par le sondage IFOP, annonçant une dynamique de développement de l’islam dans les années à venir ?
L’enquête TeO2 montre que ce n’est pas le cas et qu’il s’agit d’un effet d’âge : les moins de 25 ans en 2008-2009 s’avèrent être moins investis dans la religion quand ils atteignent 28-34 ans. Une deuxième explication tient à la transmission familiale, qui joue un rôle déterminant dans la formation du sentiment religieux. Les parents des jeunes musulmans ont eux-mêmes grandi dans des sociétés, notamment celles du Maghreb, où la religion joue un rôle beaucoup plus central depuis la fin des années 1970. Ces parents ont transmis une partie de ce rapport au religieux à leurs enfants qui sont les jeunes musulmans d’aujourd’hui.
Pour résumer, nous avons bien constaté que le rapport à la religion est plus dense pour les personnes dans les pays musulmans dont sont issus les immigrés, mais aussi que ces personnes ne se sont pas nécessairement « islamisées » en France.
Par ailleurs, on note que les jeunes ayant grandi dans des familles mixtes avec un parent musulman et l’autre chrétien ou sans religion sont beaucoup plus nombreux à se déclarer sans religion (de l’ordre de 50 %). Comme la mixité religieuse tend à se développer, une plus grande distance à la religion est probable, à l’avenir, dans les familles.
À propos du port du voile, l’Ifop explique que 31 % des femmes le portent (19 % systématiquement) mais que cette pratique se banalise chez les jeunes : 45 % des musulmanes âgées de 18 à 24 ans, soit trois fois plus qu’en 2003 (16 %) ». Que disent vos enquêtes ?
Patrick Simon : Concernant le voile, TeO montre que les femmes de la seconde génération portent moins le voile que les femmes immigrées : 17 % pour 36 %. Les musulmanes immigrées sont aujourd’hui plus nombreuses (36 %) à porter le voile qu’en 2008-2009 (22 %). Pour la seconde génération, la pratique a augmenté, mais dans des proportions moindres entre 2008 et 2020 (de 13 % à 17 %).
Cette pratique est plus fréquente pour les moins de 25 ans de la seconde génération. Le port du voile n’est pas constant dans le cycle de vie, et il est possible que des femmes abandonnent la pratique après 30 ans, que ce soit par choix personnel ou parce que les barrières à l’accès à l’emploi sont trop massives. Encore une fois, la distinction entre immigrées et descendantes d’immigrées apporte des nuances importantes aux constats.
Propos recueillis par David Bornstein.

Franck Frégosi a reçu des financements du Bureau Central des Cultes du Ministère de l’Intérieur -ligne budgétaire Crédits recherche Islam et Sociétés- dans le cadre d’une recherche commandée par ce service du Ministère de l’Intérieur sur le statut des imams en France pour la période 2015-2017.
Patrick Simon est membre du comité Droits Humains de la Fondation de France et il est président du comité scientifique de l’Observatoire Nationale des Discriminations dans l’Enseignement Supérieur.
Vincent T a reçu des financements de l’ANR, de l’ORA, de la Région Nouvelle-Aquitaine lors des 10 dernières années
– ref. Musulmans de France, religiosité, islamisme : les chiffres contestés de l’enquête Ifop – https://theconversation.com/musulmans-de-france-religiosite-islamisme-les-chiffres-contestes-de-lenquete-ifop-270233

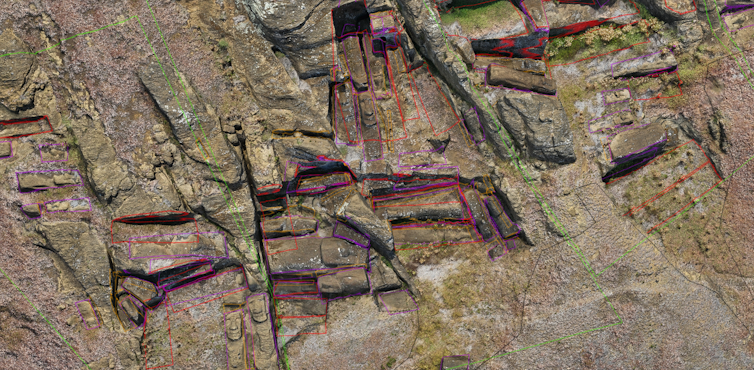
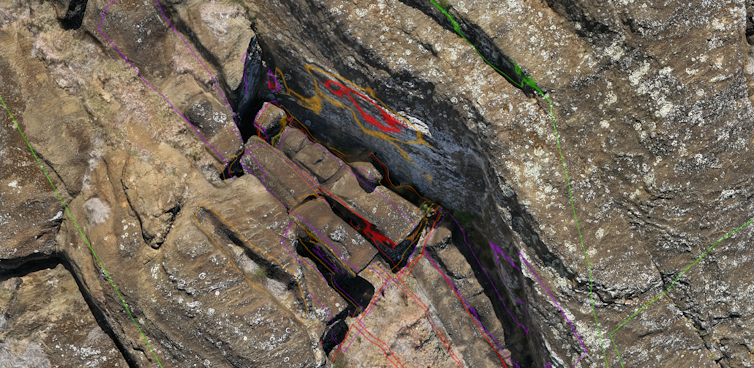
![]()



