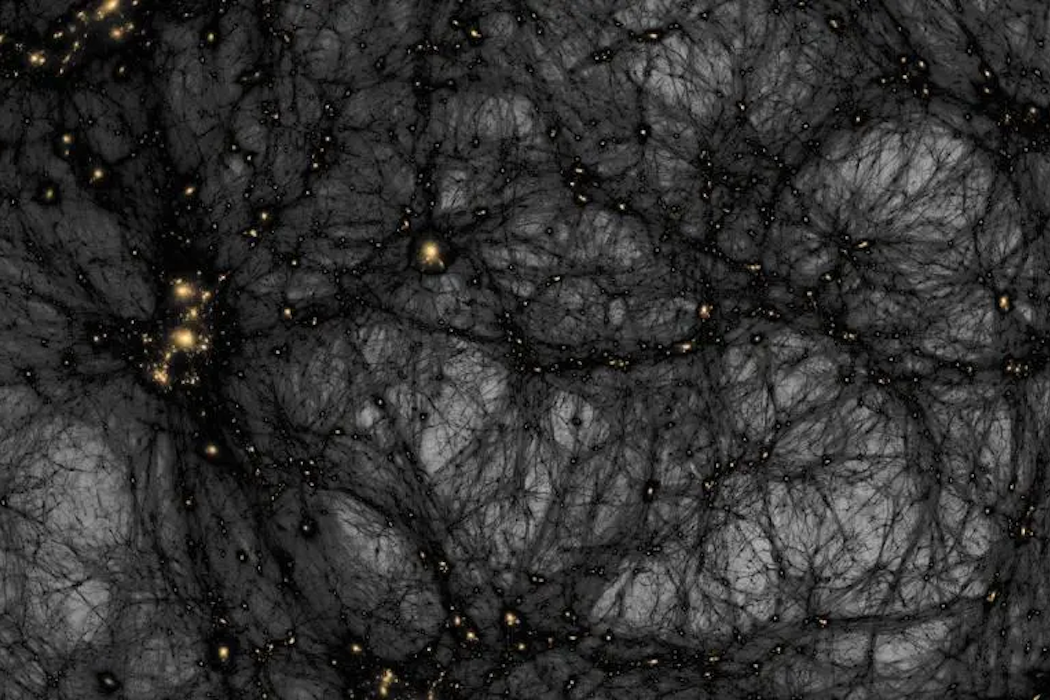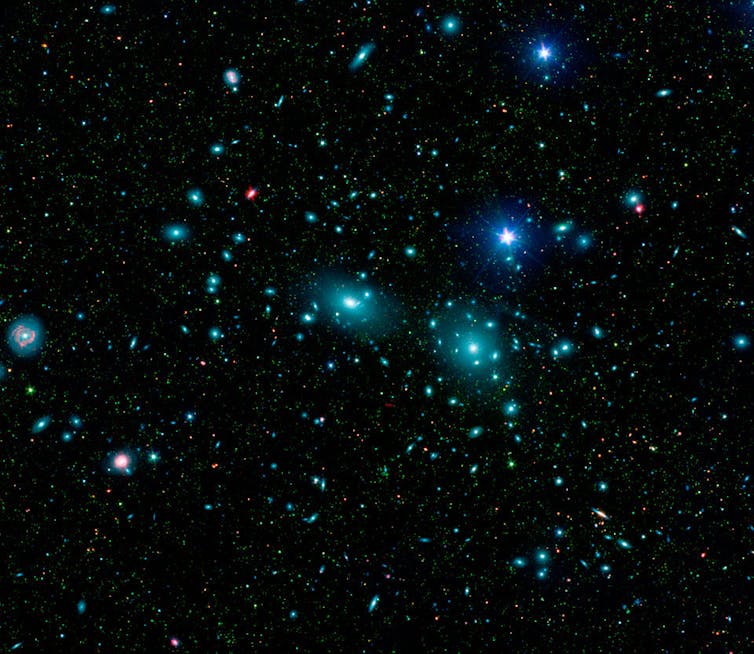Source: The Conversation – in French – By Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po
Alors que l’administration Trump a récemment présenté un plan en 28 points sur l’Ukraine, très favorable aux intérêts de Moscou, on vient d’apprendre que, le mois dernier, le conseiller du président des États-Unis Steve Witkoff avait affiché lors d’une conversation téléphonique avec un conseiller de Vladimir Poutine une grande proximité à l’égard de la position du Kremlin. Ces fuites ont suscité un scandale artificiel : en écoutant cet échange de quelques minutes, on n’a rien appris que l’on ne savait déjà sur la posture réelle de l’administration Trump… laquelle demeure pourtant, qu’on le veuille ou non, le seul véritable médiateur entre Moscou et Kiev.
Que de bruit autour de demi-révélations et de secrets éventés ! Que d’émois autour du « scandale Witkoff » !
Et que de commentaires indignés suscités par la retranscription intégrale, publiée par Bloomberg le 26 novembre, de la conversation téléphonique entre l’envoyé spécial du président Trump, Steve Witkoff, et le conseiller diplomatique du président Poutine, Iouri Ouchakov, le 14 octobre dernier !
Aux États-Unis comme en Europe, on crie à la trahison de l’Ukraine. On met en cause l’honnêteté du magnat de l’immobilier, ami proche de Donald Trump. Et on met en question sa capacité à mener une médiation entre Moscou et Kiev.
Que les propos échangés ne soient pas à l’honneur du milliardaire américain, on peut en convenir. Que sa connivence surjouée avec un membre éminent de l’administration présidentielle russe choque, c’est l’évidence.
Mais invoquer ces fuites comme autant de raisons pour récuser Witkoff comme émissaire atteste d’une naïveté idéaliste qui n’a pas sa place dans la géopolitique contemporaine de l’Europe. Et qui, paradoxalement, dessert la cause ukrainienne.
Fausses confidences et évidences usées
Quelles sont ces prétendues révélations que les opinions publiques occidentales feignent de découvrir ? Quels secrets ces propos livrent-ils ? Et quels mystères ces fuites mettent-elles à jour ?
Le négociateur américain cultive une familiarité avec la Russie, entretient la flagornerie à l’égard du Kremlin, développe des relations d’affaires avec des businessmen proches de lui et affiche sa condescendance pour les Ukrainiens comme pour les Européens. II suggère à son interlocuteur de demander à Vladimir Poutine de flatter l’ego légendaire de l’actuel locataire de la Maison Blanche. Et il accepte la proposition d’Ouchakov quand celui-ci dit vouloir organiser un entretien téléphonique entre les deux présidents avant la visite à Washington de Volodymyr Zelensky, qui allait avoir lieu deux jours plus tard.
La belle affaire ! Ces secrets sont de notoriété publique, et ces fuites, bien inutiles.
Toutes les déclarations publiques de l’univers MAGA le proclament urbi et orbi, autrement dit sur les réseaux sociaux : l’administration Trump veut se débarrasser de la guerre en Ukraine à tout prix, établir des coopérations fructueuses avec la Russie, tenir les Ukrainiens comme les Européens sous la pression et régler le conflit à son seul profit. Elle professe depuis longtemps une admiration non feinte pour le style de gouvernement Poutine. À l’est, rien de nouveau !
L’entourage de Donald Trump ne veut éviter ni les conflits d’intérêts, ni la servilité envers les chefs, ni l’intrigue, ni même de prendre des décisions concernant des États souverains sans consulter leurs autorités légales. Ses représentants officiels, du vice-président J. D. Vance au secrétaire d’État Marco Rubio, ont déjà montré, dans la guerre en Ukraine comme dans le conflit à Gaza, ce qu’était « la paix selon Trump » : un accord précaire, court-termiste et publicitaire. Le succès personnel, rapide et médiatisable compte bien plus que le règlement durable des conflits. Là encore, rien de nouveau sous le soleil de Bloomberg.
Comme on dit en anglais : « Old news ! » Autrement dit, le scoop est éventé depuis longtemps.
Le monopole américain du dialogue avec la Russie
Les critiques formulées à l’égard de Witkoff par les démocrates et les républicains classiques, comme par les Européens, sont sans doute causées par une indignation sincère. Mais, au fond, elles attestent d’une ignorance coupable à l’égard du rapport de force géopolitique actuel en Europe. Et de la nature d’une médiation internationale.
Peut-on crier à la déloyauté quand un médiateur établit une proximité personnelle avec ses interlocuteurs désignés ? Doit-on s’indigner qu’il ait intégré dans son équation des revendications de la partie adverse, comme base de discussion ? Là encore, ces protestations – certes moralement légitimes – ne tiennent pas compte de la réalité du travail de la médiation américaine concernant l’Ukraine.
En rejetant le rôle de protecteur de l’Ukraine et en endossant celui de médiateur, les États-Unis ont rempli la fonction laissée orpheline par les Européens. À tort ou à raison, ceux-ci ont estimé que la défense de l’Ukraine exigeait de couper les canaux de communication avec la Russie. C’est une réalité dérangeante : un médiateur a précisément ce rôle ambigu de dialoguer avec les deux ennemis, l’agresseur et la victime. Il doit réaliser une opération quasi alchimique, transformer les ennemis en interlocuteurs.
Que le plan en 28 points de l’équipe Trump soit profondément favorable aux intérêts russes, c’est l’évidence.
Mais on ne peut pas non plus nier le fait que seul l’entourage du président américain est aujourd’hui en position géopolitique de parler aux deux parties, de leur proposer des documents de travail, d’exercer sur les deux la pression nécessaire à l’ouverture de discussions et ainsi d’esquisser les conditions d’une fragile suspension des combats, dont, répétons-le, les Ukrainiens sont les victimes sur leur propre territoire.
Aujourd’hui, volens nolens, l’équipe Trump a pris le monopole de la discussion avec la Russie et avec l’Ukraine. Les Européens sont (provisoirement) réduits à se faire les avocats de l’Ukraine à l’égard des États-Unis, pas vis-à-vis de la Russie.
Les négociations internationales selon Donald Trump
La discussion entre Witkoff et Ouchakov atteste de l’amateurisme diplomatique du premier et de l’habileté tactique du second, du moins durant ces quelques minutes. La fuite à l’origine de la retranscription souligne que la méthode Trump ne fait pas l’unanimité aux États-Unis et que certains essaient d’entraver la politique que l’administration actuelle met en œuvre.
Mais ce faux scoop doit servir d’alerte aux Européens. Les règles du jeu diplomatique sont bouleversées par le conflit en Ukraine car celui-ci est bloqué : la paix par la victoire militaire de l’une ou de l’autre partie est impossible ; la reconquête par Kiev des territoires illégalement occupés et annexés par Moscou est plus qu’incertaine ; quant aux négociations directes entre belligérants, elles semblent irréalistes. Pour sortir (même provisoirement) du cycle des offensives et contre-offensives et pour donner à l’Ukraine le répit dont elle a besoin, les outils classiques sont momentanément inopérants.
L’administration Trump, dans son style fait de compromissions, de provocations, de revirements, de vulgarité et de coups de pression, essaie de sortir de l’impasse. C’est sur ce point que les révélations Witkoff sont éclairantes : la lutte existentielle de l’Ukraine peut soit se prolonger dans une guerre sans fin, soit être suspendue par une diplomatie non orthodoxe qui choquera moralement les consciences au nom des résultats espérés. Ceux-ci sont bien incertains : ils peuvent être ruinés en un instant par un dédit du Kremlin, par un succès militaire tactique d’un des deux ennemis ou encore par un nouveau scandale en Ukraine.
Quand la victoire paraît hors de portée, quand les négociations sont impensables et quand la paix paraît impossible, comment récuser la seule médiation actuellement possible, aussi biaisée soit-elle ? Quand la paix est lointaine et la négociation impensable, les méthodes non orthodoxes sont nécessaires pour briser le cercle indéfiniment vicieux du conflit.
Plutôt que de s’indigner d’un faux scoop, les Européens devraient le voir comme le symptôme de leur propre conformisme diplomatique. Plutôt que de réagir avec retard comme intercesseurs de l’Ukraine auprès de l’administration Trump, ils devraient innover, dans leur propre intérêt et dans celui de l’Ukraine. Reprendre directement contact avec le Kremlin, proposer un plan de paix qui ne soit pas le simple rappel du droit international, veiller à ce que la reconstruction de l’Ukraine ne se fasse pas à leurs dépens leur permettrait de s’affirmer pour ce qu’ils sont : la première puissance du continent et non pas de simples spectateurs de leur propre sécurité.
![]()
Cyrille Bret ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Le scandale Witkoff : fausses révélations et vrai symptôme – https://theconversation.com/le-scandale-witkoff-fausses-revelations-et-vrai-symptome-270737