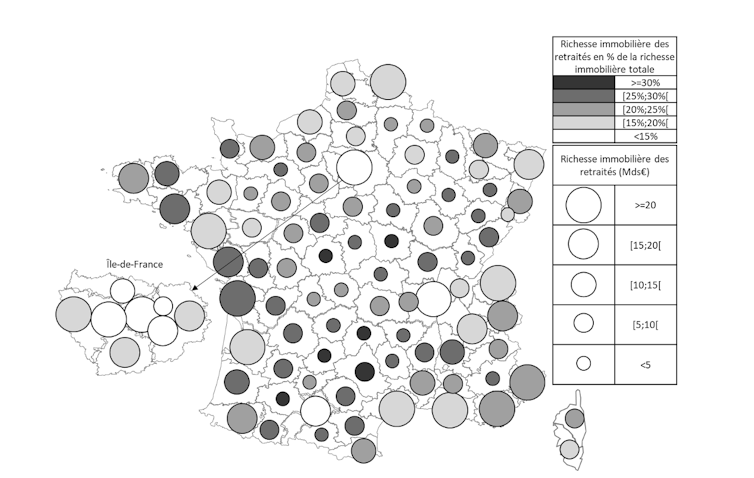Source: The Conversation – in French – By Alexandra Lamarche, PhD Candidate | Doctorante, Université de Montréal
Les Centrafricains éliront leur président, le 28 décembre 2025, dans un contexte toujours fragile, où l’insécurité persiste et où le spectre des groupes armés continue de peser lourdement sur le processus électoral. L’élection présidentielle s’annonce sous haute tension, avec la candidature du président sortant Faustin-Archange Touadéra, mais aussi de figures comme Anicet-Georges Dologuélé ou l’ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra. La chercheuse Alexandra Lamarche jette un éclairage sur les principaux risques entourant le processus électoral en Centrafrique, et évoque les actions prioritaires et nécessaires pour prévenir des violences post-électorales.
Quels sont, selon vous, les principaux risques entourant l’élection du 28 décembre ?
L’élection présidentielle du 28 décembre en République centrafricaine (RCA) se déroule dans un climat d’insécurité marqué par la présence persistante de groupes armés et les tensions avec les Forces armées centrafricaines (FACA). Cette situation fait planer un risque réel de violences et d’affrontements. Dans de nombreuses régions, les électeurs pourraient être confrontés à des intimidations venant tant des forces nationales que des groupes armés. Certains combattants issus d’anciennes coalitions dissoutes ont rejoint de nouvelles factions.
Bien que les membres de certaines milices aient été intégrés aux forces nationales, cette intégration présente des lacunes et bon nombre d’anciens combattants pourraient ne pas se montrer loyaux envers l’État en cas de conflit. Cela accroîtrait encore les risques liés au scrutin. Cette insécurité, combinée à une profonde frustration politique et à un désengagement, suggère que le taux de participation sera faible.
Le référendum du 30 juillet 2023 — boycotté par l’opposition et largement perçu comme un « coup d’État constitutionnel » – a supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels. Il permet à l’actuel chef de l’Etat, Faustin-Archange Touadéra, de demeurer au pouvoir indéfiniment. Cette situation renforce l’impression que les règles du jeu démocratique sont biaisées.
Enfin, les difficultés persistantes pour de nombreux citoyens musulmans à obtenir une carte d’identité nationale risquent de les exclure du scrutin. Elles exacerbent les frustrations communautaires et sapent davantage la crédibilité du processus électoral.
Quel rôle jouent les groupes armés et les acteurs étrangers dans ce scrutin ?
Les groupes armés demeurent des acteurs centraux, surtout dans les zones où ils peuvent perturber les opérations électorales, restreindre l’accès des électeurs ou interrompre le vote afin de préserver leur influence locale ou de se positionner pour d’éventuelles négociations post-électorales.
À leurs côtés, les acteurs étrangers jouent un rôle tout aussi déterminant. La Russie, via ses instructeurs et sociétés militaires alliées, sécurise certaines zones tout en renforçant l’avantage du pouvoir en place. Le Royaume-Uni accuse même Moscou d’envisager de réprimer des voix politiques et de mener des campagnes de désinformation pour influencer le débat électoral.
Le Rwanda, pour sa part, soutient activement le président Touadéra afin de consolider sa présence militaire et protéger un réseau croissant d’investissements dans les secteurs minier, commercial et de la construction, tout en étendant son influence régionale. Cette dynamique s’ajoute à l’appui que la Russie, notamment via Wagner, accorde à Touadéra pour sécuriser leurs propres intérêts miniers et maintenir un régime favorable à son implantation stratégique en Afrique centrale.
Si la force de maintien de la paix onusienne, la Minusca, tente de promouvoir un processus plus crédible, sa marge de manœuvre reste limitée par la fragmentation territoriale et les alliances politiques du régime. Parallèlement, le gouvernement de Touadéra apparaît de plus en plus dépendant de ses partenaires étrangers, au détriment de la souveraineté de la RCA.
Comment la situation des déplacés affecte-t-elle la crédibilité du vote ?
La situation des déplacés internes et des réfugiés centrafricains compromet sérieusement la représentativité du scrutin. Alors que les réfugiés — majoritairement musulmans — avaient pu voter en 2015-2016, ils en sont désormais exclus par le gouvernement, malgré les appels des Nations Unies en faveur de leur inclusion et les offres de soutien pour faciliter ce processus. Cette exclusion prive l’élection de milliers de voix. À l’intérieur du pays, de nombreuses personnes déplacées, de toutes confessions et d’origines ethniques, vivent dans des zones isolées ou se cachent pour échapper aux violences et peuvent hésiter à se rendre aux bureaux de vote par peur d’être ciblées.
Cette combinaison d’exclusion administrative et de contraintes sécuritaires crée un processus électoral qui laisse de côté certaines des populations les plus affectées par le conflit, remettant en doute l’inclusivité et, par conséquent, la légitimité globale du scrutin.
Quelles actions prioritaires sont nécessaires pour prévenir des violences post-électorales ?
Prévenir les violences post-électorales nécessiterait une action anticipée et coordonnée, mais j’ai peu d’espoir que ce soit possible. Même si les bulletins de vote sont déposés, si une partie importante de la population se sent exclue ou contrainte, le résultat pourrait déclencher un retour à la violence.
Bien que le mandat de la Minusca ait été renouvelé année après année, celle-ci ne dispose pas des fonds ni des effectifs nécessaires pour mener à bien sa mission ambitieuse. L’une des principales priorités est de travailler en étroite collaboration avec l’Autorité nationale des élections (ANE). Bien que celle-ci fasse de nombreux efforts positifs, notamment sur les plans technique et logistique, elle n’est probablement pas encore en mesure de garantir que tous les risques majeurs (sécurité, portée, légitimité) soient atténués.
Les élections ne sont qu’une étape. Le véritable test consistera à déterminer si l’État sera capable d’exercer son autorité après les élections de manière à renforcer la paix plutôt qu’à accentuer la polarisation.
La protection des civils doit être assurée de manière impartiale, notamment par un déploiement ciblé de la MINUSCA dans les zones sensibles afin d’éviter l’usage excessif de la force par les FACA ou leurs alliés étrangers.
Il est également crucial de décourager tout discours identitaire inflammatoire et de garantir un accès rapide à la justice pour enquêter sur les violences, protéger les témoins et poursuivre les auteurs, quel que soit leur camp. Cette combinaison de prévention, de transparence et de responsabilité est indispensable pour réduire les risques de violences après le scrutin.
![]()
Alexandra Lamarche receives funding from the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) of Canada.
– ref. Élection présidentielle en Centrafrique : un scrutin à haut risque – https://theconversation.com/election-presidentielle-en-centrafrique-un-scrutin-a-haut-risque-270575