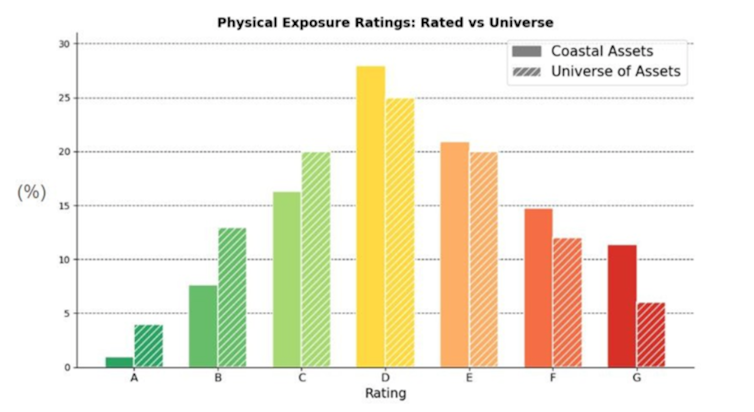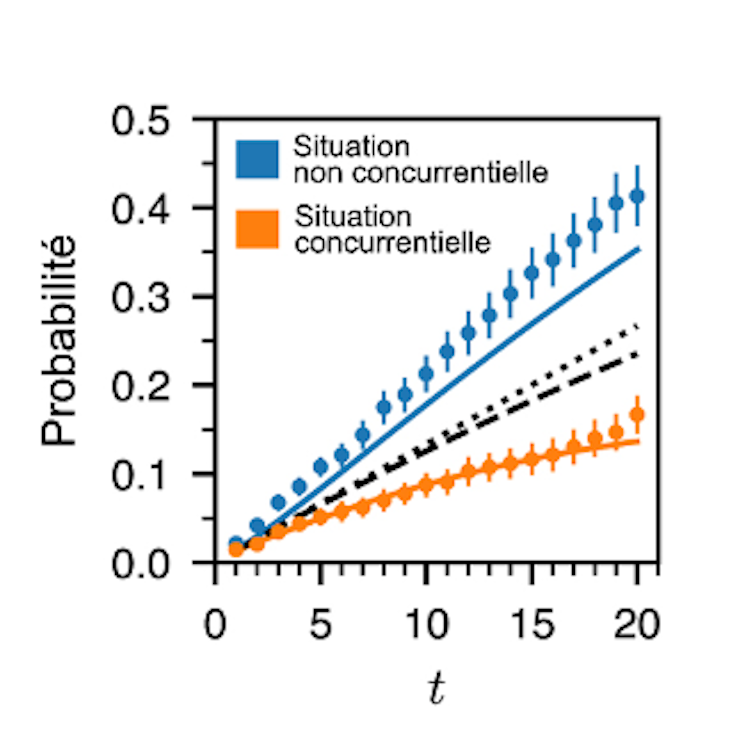Source: The Conversation – in French – By Yaxin Zhou, Doctorante en science politique, Université de Montréal
Le Canada a beaucoup à gagner en Asie du Sud-Est. Du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) à celui de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le voyage diplomatique en octobre de Mark Carney en Asie témoigne de l’intérêt et de la nécessité du Canada de trouver un point d’entrée dans l’immense marché asiatique.
La région de l’Indo-Pacifique est aujourd’hui le principal moteur économique du monde, contribuant jusqu’à 60 % de la croissance mondiale. Tandis que le Japon et la Corée du Sud enregistrent un taux de croissance entre 1 et 2 % pour l’année 2025, la Chine maintient une croissance de 4,2 %, l’Inde de 6,6 % et l’ANASE 4,3 %.
Si ces pays asiatiques aspirent, pour certains, à retrouver un nouvel élan économique, ou, pour d’autres, à accéder au statut d’économie à revenu élevé, ils ont en commun de rechercher des sources d’énergie fiables, accessibles et opérationnelles. Dans les prochaines années, la stabilité et la diversification des fournisseurs énergétiques seront des enjeux clés. Les besoins sont bien réels, et vont augmenter. Qui va en profiter ?
Doctorante en science politique, affiliée au Centre d’études et de recherches de l’Université de Montréal, je travaille sur la Chine et sur la région Indo-Pacifique.
Redéfinition de l’échiquier géopolitique
Le 1ᵉʳ février 2025, Donald Trump a déclaré une guerre commerciale contre le Canada et le Mexique, avant même de s’en prendre à la Chine, son ennemi juré. Dès lors, la diversification économique s’est imposée comme une priorité stratégique pour Ottawa.
Élu en promettant d’être l’homme de la situation, Mark Carney a employé un langage totalement différent de celui de son prédécesseur sur l’importance des questions d’ordre économique. À l’occasion de son discours de victoire électorale, le nouveau premier ministre canadien a affirmé vouloir faire du Canada une superpuissance énergétique, autant dans les énergies propres que dans les énergies conventionnelles.
À lire aussi :
Le Canada est en guerre commerciale avec les États-Unis – voici comment y faire face
Ce pivot vers l’économie, la sécurité nationale et le pragmatisme s’arrime bien aux besoins des pays asiatiques, qui cherchent eux aussi à diversifier leurs chaînes d’approvisionnements et à trouver des partenaires commerciaux stables et crédibles sur le plan politique.
L’attrait du Canada pour des pays en quête de diversification
Selon Statistique Canada, en 2024, les minéraux combustibles (dont le pétrole, le gaz naturel et le charbon), les huiles minérales et leurs produits dérivés représentaient 25 % des exportations canadiennes. De fait, les ressources énergétiques constituent le premier poste d’exportation du Canada. Pourtant, 89,33 % de ces ressources sont acheminées aux États-Unis… Ce que le Canada exporte le plus vers les pays de l’ANASE, ce sont des céréales !
Si le Canada veut devenir une superpuissance énergétique, comme le souhaite Mark Carney, il lui faudra développer des partenariats commerciaux et surtout énergétiques ailleurs qu’au sud du 49e parallèle. Le marché asiatique, en pleine croissance et en quête de stabilité et de sécurité énergétique, pourrait constituer une véritable opportunité à long terme.
La consommation croissante d’énergie en Asie
La dépendance aux énergies fossiles demeure la norme dans la région. Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie, l’industrie et le transport concentrent la plus grande part des besoins en énergie, qui continueront de croître à mesure que l’industrialisation et l’urbanisation s’accélèreront, notamment dans les pays émergents. Le charbon demeure, de loin, la principale source d’énergie, représentant 49,3 % de la consommation d’énergie primaire de la région d’Indo-Pacifique, et 57 % de la production d’électricité. Les ressources tendent toutefois à s’épuiser.
À lire aussi :
Les États-Unis en repli, la Chine en retrait, le monde dans un vide dangereux
Si les économies développées comme la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, et Singapour importent quasiment 100 % de leur pétrole et de leur gaz, l’Indonésie et la Malaisie parviennent à exporter leurs énergies fossiles.
L’Indonésie est le premier exportateur mondial de charbon, et la Malaisie, un exportateur majeur de gaz naturel liquéfié (GNL). Le rapport Asean Oil and Gas Updates 2024 montre cependant que l’Asie du Sud-Est fait face à un épuisement progressif de ses réserves pétrolières, et devrait devenir importatrice nette de gaz d’ici 2027.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Une région qui s’active pour trouver de l’énergie
Les gouvernements de la région s’entendent de manière quasiment unanime sur deux grandes priorités. D’abord, assurer et préserver leur sécurité énergétique, définie par l’Agence internationale de l’énergie comme étant la disponibilité ininterrompue de sources d’énergie à un prix abordable. Ensuite, exécuter une transition vers des formes d’énergies plus propres que le charbon.
Pour atteindre ces deux objectifs, les pays multiplient des initiatives de diversification énergétique et investissent massivement dans la construction d’infrastructures. En Asie du Sud-Est, les nouvelles usines de regazéification et de liquéfaction se multiplient. En 2023, la région totalisait 57,76 Mtpa de capacité de regazéification, et 64,1 Mtpa de capacité de liquéfaction, avec des projets ambitieux d’expansion d’ici 2030, notamment en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines.
Le Canada a-t-il les moyens de ses ambitions ?
Le Canada s’est ainsi nouvellement doté des moyens pour compétitionner avec les États-Unis, qui exportent déjà massivement leur GNL depuis 2016 à partir de terminaux situés dans le golfe du Mexique. Cependant, ceux-ci transitent par le canal de Panama, un détour coûteux.
Le Canada possède un avantage concurrentiel considérable, un terminal portuaire directement accessible à partir de la côte ouest. Au mois de juillet 2025, partait le premier navire transportant du GNL canadien à destination de l’Asie, depuis le port de Kitimat, en Colombie britannique. Parmi les cinq multinationales ayant le plus contribué à ce projet, quatre sont d’origines asiatiques : Petronas (Malaisie), PetroChina (Chine), Mitsubishi Corporation (Japon) et Kogas (Corée du Sud).
Du côté du pétrole, malgré les retards et la flambée des coûts associés à sa construction, l’expansion du réseau d’oléoduc de Trans Mountain a porté la capacité d’exportation du Canada à 890 000 barils par jour, ouvrant la voie à des exportations vers des partenaires asiatiques à partir de la côte ouest du pays. Avec plus d’un partenaire à qui vendre son pétrole, le Canada a vu le prix de son baril augmenter rapidement en quelques mois.
N’ayant exporté aucun GNL avant 2016, les États-Unis sont devenus les premiers exportateurs au monde en 2023, et leurs exportations continuent de battre des records. Le marché est là, mais qui va s’enrichir : le Canada ou les autres ?
![]()
Yaxin Zhou ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Le secteur de l’énergie, une porte d’entrée pour le Canada en Asie – https://theconversation.com/le-secteur-de-lenergie-une-porte-dentree-pour-le-canada-en-asie-269455