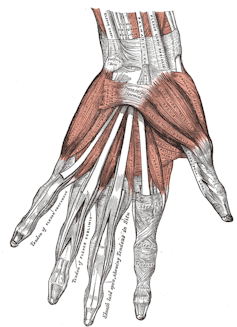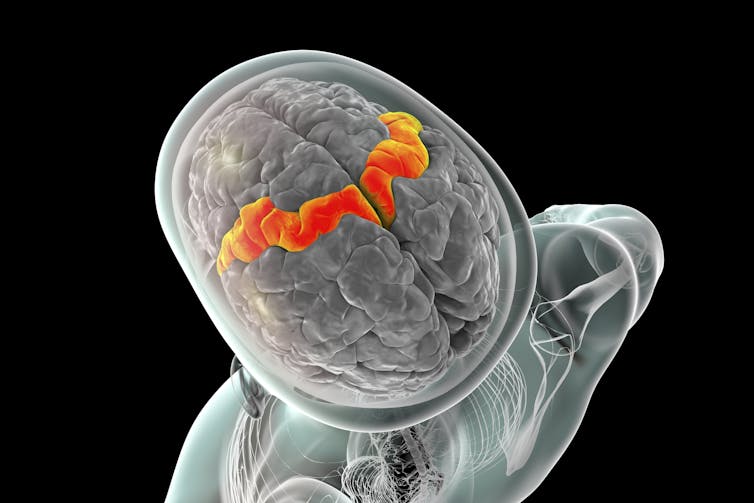Source: The Conversation – France in French (3) – By Danièle Lochak, Porfesseure émérite de droit public, Université Paris Nanterre

Il y a cent vingt ans, le 9 décembre 1905, la loi de séparation des Églises et de l’État était promulguée en France. Mais dès la Révolution, la question de la place concédée aux minorités religieuses – en l’occurrence au sujet des juifs, dans le cadre républicain fait débat. Ces discussions, qui portent notamment sur l’abandon de certaines pratiques cultuelles, font écho aux controverses actuelles portant sur l’islam et les musulmans.
Dans son ouvrage Libres et égaux… L’émancipation des Juifs sous la Révolution française (1789-1791), Robert Badinter souligne qu’en proclamant « la pleine citoyenneté des juifs en France, le 27 septembre 1791, les [révolutionnaires] faisaient triompher leur idéal, celui des Droits de l’Homme, sur les préjugés et la prudence politique ».
À la veille de la Révolution, en effet, les Juifs sont encore soumis, à des degrés variables selon leur origine et leur implantation géographique, à un statut diminué et précaire, dépendant du bon vouloir du roi. La question de savoir s’ils seraient inclus et à quelles conditions dans la communauté des citoyens se pose donc avec acuité dès la convocation des États généraux.
Finalement, en dépit des préjugés à l’égard des Juifs qui s’expriment jusque dans la bouche ou sous la plume des révolutionnaires les plus acquis à leur cause, le décret d’émancipation leur confère l’égalité des droits et l’accès à la citoyenneté sans autre condition que de prêter le serment civique. Pour l’abbé Grégoire, c’est l’émancipation des Juifs qui doit ouvrir la voie à leur « régénération », autrement dit leur assimilation ; aux yeux de Stanislas de Clermont-Tonnerre, de même, dès lors qu’on leur donnera l’égalité de droits, les Juifs s’affranchiront, grâce aux Lumières, « de leurs pratiques fanatiques ou détestables ».
Mais ce qui est frappant, lorsqu’on se replonge dans les débats de l’époque, c’est à quel point on en retrouve l’écho dans les controverses actuelles autour de l’intégration des immigrés, de la laïcité ou du communautarisme. Les solutions aujourd’hui préconisées sont-elles pour autant fidèles aux principes qui ont inspiré « cette mesure véritablement révolutionnaire », pour reprendre l’expression de Robert Badinter, qu’a été le décret d’émancipation des Juifs ? On peut légitimement en douter.
Assimilation, intégration : la constance d’une préoccupation
La question de l’assimilation n’est plus posée désormais – officiellement s’entend – s’agissant des juifs. Mais elle a été érigée en condition d’accès à la nationalité française : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française », énonce le Code civil, une assimilation qui s’apprécie notamment au regard d’une connaissance suffisante « de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises » et de « l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». La laïcité compte au nom de ces « principes et valeurs essentiels » – le « défaut d’assimilation » est en pratique souvent invoqué pour rejeter une demande de naturalisation au vu de comportements ou d’attitudes (le port du foulard, la conception des rapports sociaux de sexe) liés ou imputés à la pratique de l’islam.
En ce qui concerne les étrangers de façon générale, le concept qui a émergé est celui d’intégration. Théoriquement moins impliquante en termes de renonciation à son appartenance d’origine et à ses particularismes, l’intégration est devenue, à partir du milieu des années 1970, un objectif officiel de la politique d’immigration.
L’intégration comme injonction : le syndrome napoléonien
Mais l’effort d’intégration, dont la responsabilité incombait aux pouvoirs publics, a été progressivement reporté sur les immigrés et converti en injonction de s’intégrer, sous peine de conserver à jamais un statut précaire, voire de perdre tout droit au séjour.
Le premier pas en ce sens est intervenu avec la loi Sarkozy de 2003 qui a subordonné l’obtention d’un titre de séjour pérenne à des preuves d’intégration. Aujourd’hui, à l’issue d’une série de réformes législatives allant dans le sens d’un renforcement croissant des exigences – et dernièrement encore avec la loi Darmanin de 2024 –, tout étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit signer un « contrat d’engagement au respect des principes de la République » et tout manquement aux obligations souscrites entraîne le retrait ou le non-renouvellement du titre.
Comment ne pas penser au retournement imposé par Napoléon lorsque, inversant la problématique du décret d’émancipation de 1791, il décide de conditionner la possession des droits civiques à des preuves préalables de « régénération » et impose aux Juifs d’Alsace une période probatoire ?
Le parallèle avec l’époque napoléonienne va même plus loin. Lisons quelques-unes des questions posées par Napoléon aux représentants de la communauté juive, destinées à « tester » la capacité d’assimilation des Juifs, avec le présupposé implicite que les contraintes de leur religion y font obstacle : 1. Est-il licite aux Juifs d’épouser plusieurs femmes ? 2. Le divorce est-il permis par la religion juive ? 4. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères, ou sont-ils des étrangers ? 6. […] Sont-ils obligés d’obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du Code civil ? Le reste à l’avenant. Autant de questions auxquelles le Grand Sanhédrin, réuni en 1807, va répondre point par point, afin de démontrer que les obligations religieuses des juifs ne s’opposent en aucune manière au respect des lois civiles.
Les ressemblances avec la philosophie qui sous-tend les gages d’intégration exigés aujourd’hui des étrangers sont frappantes. Le « contrat d’engagement au respect des principes de la République » comporte sept engagements parmi lesquels le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et le respect du principe de laïcité – qui visent implicitement mais évidemment les étrangers de religion ou de culture musulmane.
On repense aussi aux prises de position de Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, se targuant de prendre modèle sur Napoléon pour endiguer le séparatisme, suggérant que l’État impose aujourd’hui aux musulmans ce que Napoléon avait imposé aux Juifs et n’hésitant pas à affirmer :
« Le bon modèle, pour moi, c’est le Grand Sanhédrin convoqué en 1807 par Napoléon pour vérifier qu’il n’y avait pas d’incompatibilité entre son Code civil et la religion juive. »
Les religions minoritaires prises au piège de la « laïcité républicaine »
La question de savoir si et jusqu’à quel point l’émancipation suppose l’abandon des pratiques religieuses a été débattue dès avant la Révolution, sans être finalement clairement tranchée. Certes, les conflits de normes entre le droit étatique et les préceptes de la religion ne sont pas propres aux religions minoritaires comme le montrent les relations tumultueuses entre la République et l’Église catholique tout au long du XIXᵉ et une partie du XXᵉ siècle. Mais ils sont nécessairement plus fréquents pour les premières.
Et de fait, les juifs, comme les musulmans, subissent aujourd’hui encore
– quoiqu’à un degré inégal – leur statut de minorité religieuse dans un pays où tout est calé en fonction d’un catholicisme culturellement dominant et où le point de savoir jusqu’où doivent aller les « accommodements raisonnables » fait plus que jamais débat.
Les dérogations à la loi commune ne vont jamais de soi, même si certaines sont plus facilement acceptées que d’autres. Un modus vivendi paraît avoir été trouvé dans certains domaines : les autorisations d’absence les jours de fêtes religieuses, dans un contexte où le calendrier légal des jours chômés est calqué sur celui des fêtes chrétiennes ; les carrés confessionnels dans les cimetières, théoriquement interdits en droit mais autorisés en fait sur la base de circulaires ministérielles ; l’abattage rituel, reconnu par le Conseil d’État au nom du libre exercice du culte dès 1936 et autorisé par le Code rural – une dérogation dont la pérennité n’est toutefois pas assurée.
Mais il y a aussi des points de fixation. La loi de 2004 interdisant le port de tout signe d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires attestait déjà du raidissement des pouvoirs publics face aux manifestations extérieures de la religion. On sait à quel point cette loi et son application extensive – comme l’attestent les polémiques sur les mamans accompagnatrices ou celle, plus récente, sur l’abaya – ont fait et font encore débat. Elle aura aussi contribué – on ne le relève pas assez – à la communautarisation tant décriée, en incitant à la fuite des élèves vers les écoles privées juives et musulmanes.
Plus curieusement, la question de la nourriture est apparue récemment comme un autre point de fixation. Dans la République et le Cochon (2013), Pierre Birnbaum rappelle que, dès la Révolution, la question a été posée dans les débats sur l’assimilation des Juifs. Clermont-Tonnerre énonce, en 1789, les reproches adressés aux Juifs à cet égard pour immédiatement les écarter :
« Nos mets leur sont défendus, nos tables leur sont interdites. Ces reproches sont soit injustes, soit spécieux. Y a-t-il une loi qui m’oblige à manger du lièvre et à le manger avec vous ? »
Si les polémiques actuelles visant le cochon, la nourriture casher ou halal, répercutées parfois au plus haut niveau de l’État, n’épargnent pas les juifs, elles sont principalement dirigées contre les musulmans. On rappellera ici, parmi une multitude d’exemples, les accusations de « tomber dans le communautarisme » formulées, en 2010, à l’encontre de la chaîne Quick dont quelques établissements avaient décidé de ne plus servir de viande de porc, les éternelles controverses sur la composition des menus des cantines scolaires ou encore les déclarations du ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, en 2020, se disant choqué par la présence de rayons halal dans les supermarchés et concluant : « C’est comme ça que ça commence, le communautarisme. »
Le spectre du communautarisme : deux poids, deux mesures ?
Qui n’a en mémoire la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre : « Il faut refuser tout aux Juifs comme nation […] Il faut qu’ils ne fassent dans l’État ni un corps politique ni un ordre […] Qu’on leur refuse toute institution communautaire et toute loi particulière » ?
À première vue, on pourrait penser que la dénonciation actuelle du « communautarisme », stigmatisé comme incompatible avec le « modèle républicain », s’inscrit dans le prolongement des principes ainsi énoncés. Ce qui frappe, pourtant, c’est l’attitude ambivalente à cet égard des pouvoirs publics qui se reflète notamment dans le contraste entre ce qu’on concède aux juifs et ce qu’on refuse aux musulmans.
Est caractéristique à cet égard la place officielle reconnue au Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et le dialogue égalitaire qu’il entretient avec les autorités de l’État, dont la reconnaissance tranche assurément avec la dénonciation virulente et constamment réitérée du communautarisme musulman.
D’autant que le soupçon de dérive « communautariste » commence très tôt, lorsqu’il s’agit des musulmans, puisque de simples coutumes vestimentaires – ou le port de la barbe – seront le cas échéant interprétés, non comme une expression légitime de la liberté religieuse, mais comme la porte ouverte à l’ethnicisation de la société française, sapant les bases du « modèle républicain ». Un « modèle républicain », largement fantasmé, mais qu’on brandit comme arme rhétorique pour justifier le resserrement sur une laïcité de combat présentée comme le seul antidote aux risques de dérive communautariste.
Cet article est tiré d’une intervention de Danièle Lochak à l’occasion d’un colloque en hommage à Robert Badinter, le 8 octobre 2025 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
![]()
Danièle Lochak est membre de la Ligue des droits de l’Homme et du Groupe d’information et de soutien des immigré·es (Gisti)
– ref. Émancipation des Juifs sous la Révolution et l’Empire, intégration des musulmans aujourd’hui : des controverses qui se ressemblent – https://theconversation.com/emancipation-des-juifs-sous-la-revolution-et-lempire-integration-des-musulmans-aujourdhui-des-controverses-qui-se-ressemblent-267903