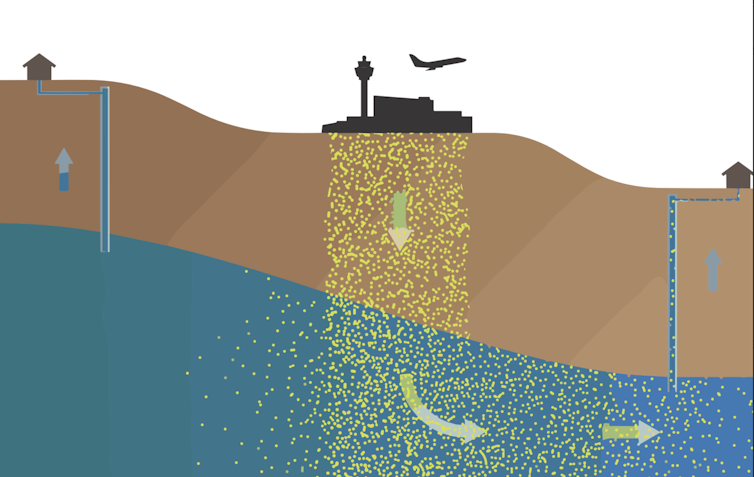Source: The Conversation – (in Spanish) – By Mauro Hernández, Profesor Titular de Historia Económica, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia
A propósito de las relaciones entre la historia y el análisis económico, el economista estadounidense Kenneth Arrow –laureado con el Nobel en 1972 por sus teorías del equilibrio económico general y de la elección social– escribió:
¿Qué clase de médico se atrevería a diagnosticar o prescribir sin conocer antes la historia clínica del paciente?
Con esta frase, Arrow reconocía que eran mayoría los economistas que diagnosticaban problemas y proponían políticas económicas sin prestar atención a la historia. Y así ha seguido siendo casi hasta ahora.
Otorgar el Nobel de Economía de 2025 al historiador económico Joel Mokyr parece indicar que esa disciplina vuelve a ser un socio relevante en el análisis económico. El propio Banco de Suecia arranca su comunicado con una reflexión en clave histórica:
En los dos últimos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha asistido a un crecimiento económico sostenido.
Economía e historia
Mokyr es un historiador a tiempo completo, cuyas contribuciones al estudio del cambio tecnológico le han merecido el galardón. Y, aunque lo comparte con dos economistas puros (Philippe Aghion y Peter Howitt), el orden en que se anunciaron los ganadores no es casual. Además, Mokyr se llevará la mitad –no un tercio– del premio: 6,5 millones de coronas suecas, unos 467 000 euros aproximadamente.
A este reconocimiento se suma que los dos últimos años también han sido galardonados profesores e investigadores que, aunque no son estrictamente historiadores económicos, sí son economistas que dan a la historia un peso muy relevante. Es el caso de Daron Acemoglu, James A. Robinson y Simon Johnson, (2024) así como el de Claudia Goldin (2023).
Los primeros basaron su explicación del desarrollo en la existencia de dos tipos de élites y marcos institucionales: las extractivas (cuyo fin era maximizar la renta de unos pocos a costa de una mayoría de súbditos) y las inclusivas (que buscaban integrar a todos los ciudadanos en el proceso y el reparto de beneficios del desarrollo). Su argumento se basa en el análisis de numerosos ejemplos históricos de ambos tipos de marco institucional.
Claudia Goldin, por su parte, obtuvo el Nobel –el primero otorgado en solitario a una mujer– por sus investigaciones sobre el papel económico de las mujeres y, en especial, sobre la brecha de género en los salarios.
¿Por qué ahora?
Hasta 1993 nunca se había concedido el premio a un historiador económico. Ese año lo recibieron Robert Fogel (director de la tesis de Goldin) y Douglass North por “haber renovado la investigación en historia económica mediante la aplicación de la teoría y los métodos cuantitativos a los cambios económicos e institucionales”. Tuvieron que pasar tres décadas para que los historiadores económicos volvieran a entrar en el Olimpo sueco.
La pregunta es por qué ahora. Los economistas, y en general los científicos sociales, no creen en las casualidades, y tres premios seguidos es una racha que desafía al mero azar. La clave, creo, se revela al hacer una lectura atenta de los comunicados de concesión del premio. Una acotación: si quieren profundizar más en el tema, el Banco de Suecia distribuye tanto una nota divulgativa como una nota académica, más completa y sesuda.
Nobel 2024: ¿por qué fracasan los países?
En el caso de Acemoglu, Robinson y Johnson, la nota de prensa comienza hablando de la colonización de buena parte del globo por los europeos, un proceso que arranca a finales del siglo XV y por el cual se produjeron grandes cambios en los territorios colonizados. Estos cambios afectarían también a sus instituciones, pero no siempre de la misma forma.
En algunos casos, los colonizadores se dedicaron a explotar a las poblaciones indígenas y los recursos naturales, conformando lo que los autores llamaron unas instituciones y unas élites extractivas. En otros, sin embargo, se produjo una ocupación donde eran más numerosos los colonos europeos, que se dotaron de marcos económicos y políticos inclusivos, abiertos a la participación más o menos libre e igualitaria de todos (no de todas).
La tesis de Acemoglu y Robinson es que sólo los segundos países fueron capaces de salir de la maldición de los recursos –que condena a la pobreza a los territorios donde éstos abundan– y desarrollar economías prósperas y capaces de estimular el crecimiento económico. Se trata, como resulta evidente, de un análisis histórico para un problema económico: por qué fracasan los países.
Nobel 2023: la mujer en el mercado laboral
Claudia Goldin, por su parte, fue premiada por sus investigaciones sobre la participación de la mujer en los mercados de trabajo “a lo largo de los siglos”, como destaca el comunicado de concesión. Este subrayaba cómo Goldin ha buceado en fuentes de archivo para estudiar los cambios en los roles de género en el ámbito laboral. Pero la galardonada también ha publicado estudios de historia económica pura, desde su tesis doctoral (sobre la economía de la esclavitud) hasta diversas publicaciones sobre el papel de las mujeres en los mercados de trabajo en los siglos XIX y XX.
Exactitud matemática versus comprensión histórica
Los tres premios Nobel de Economía de los últimos tres años coinciden en señalar que el análisis histórico es relevante para explicar procesos de largo alcance. Ya sea el crecimiento económico sostenido como resultado de la innovación técnica, el papel de las instituciones en el desarrollo económico o las brechas de género en el empleo y el ingreso.
Todos estos temas se resisten a ser modelizados matemáticamente. Aunque la otra mitad del Nobel 2025 ha recaído en dos economistas modelizadores –Philippe Aghion y Peter Howitt–, su aportación se ciñe a un problema concreto e importante: la destrucción creativa generada por los procesos de innovación, que alteran las estructuras económicas vigentes.
Frente a unas ciencias económicas que llevan décadas afilando unas herramientas metodológicas basadas en las matemáticas y los datos cuantitativos, los últimos premios Nobel nos recuerdan que la exactitud no es lo mismo que la verdad y que los procesos complejos no admiten modelos simples.
Dar respuesta a temas complejos
El mundo se está enfrentando en las últimas décadas a problemas enormemente complejos. ¿Por qué hemos sido incapaces de acabar con la pobreza de tantos países? ¿Cómo es que seguimos sujetos a fuertes ciclos económicos marcados por crisis generales, como la de 2008? ¿Qué tipo de soluciones debemos buscar para un cambio climático que exige cooperación, no competencia? ¿Cómo va a cambiar la inteligencia artificial nuestros modos de producir y consumir? La reflexión y el trabajo de los historiadores económicos, aun con series de datos menos fiables y herramientas econométricas menos sofisticadas, pueden ofrecer respuestas complejas –aunque no necesariamente precisas– a estas preguntas.
Por cierto, aunque se lo den a nuestros colegas historiadores económicos, les recuerdo que el Nobel de Economía no existe: lo que entregará este miércoles 10 de diciembre la Academia Sueca a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt será el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel.
![]()
Mauro Hernández recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación) como investigador del proyecto “Transformaciones sociales en Madrid y la Monarquía hispánica en la edad moderna. Movimientos ascendentes y descendentes. Entre cambios y resistencias” (PID2022-142050NB-C22) coordinado por José Antolín Nieto (UAM).
– ref. Joel Mokyr, premio Nobel 2025: cuando la economía trabaja con la historia – https://theconversation.com/joel-mokyr-premio-nobel-2025-cuando-la-economia-trabaja-con-la-historia-268704