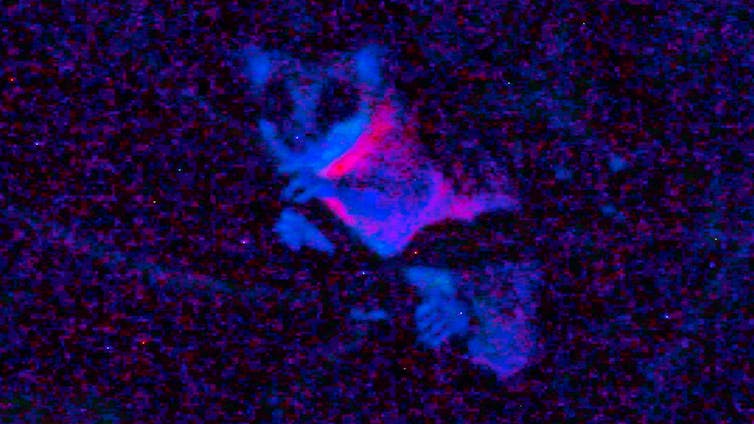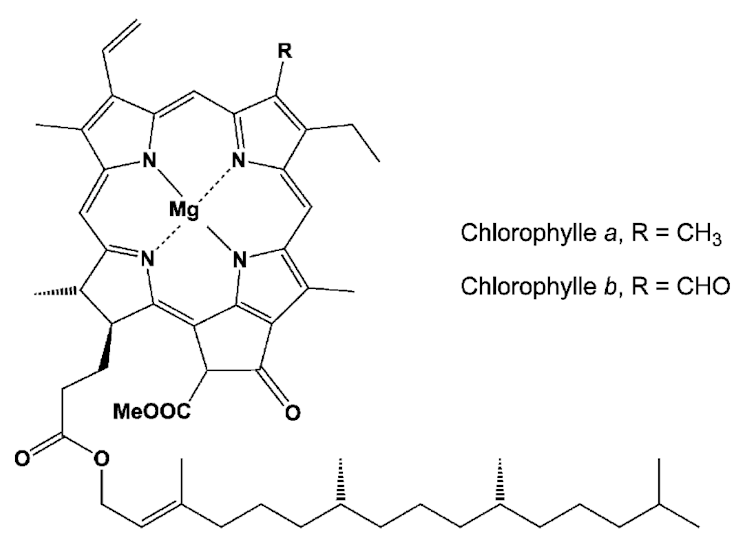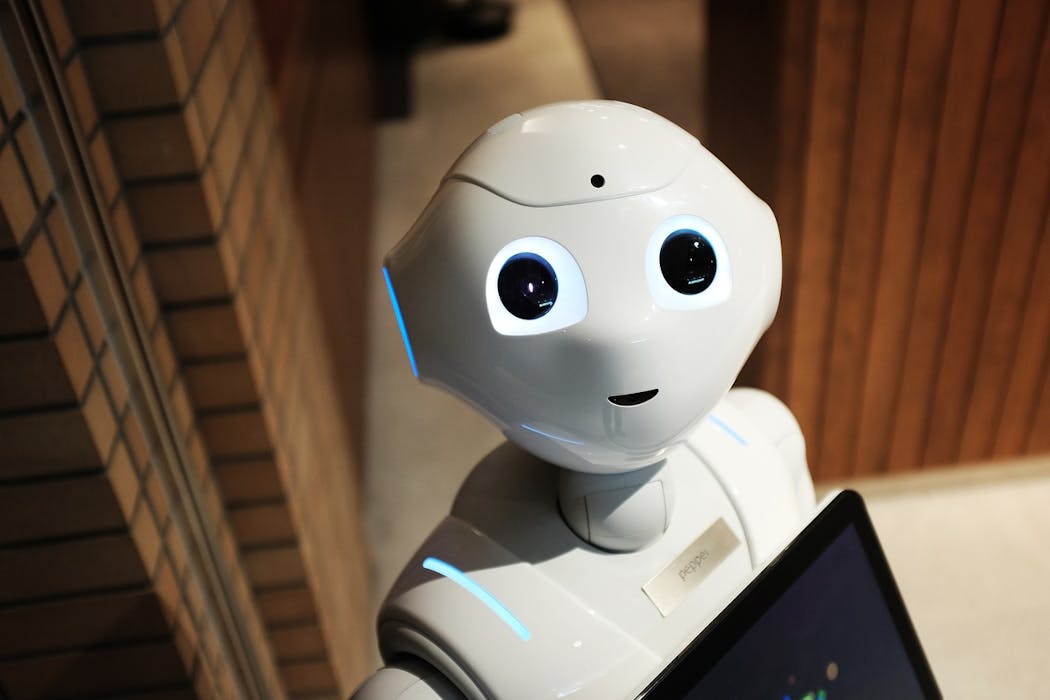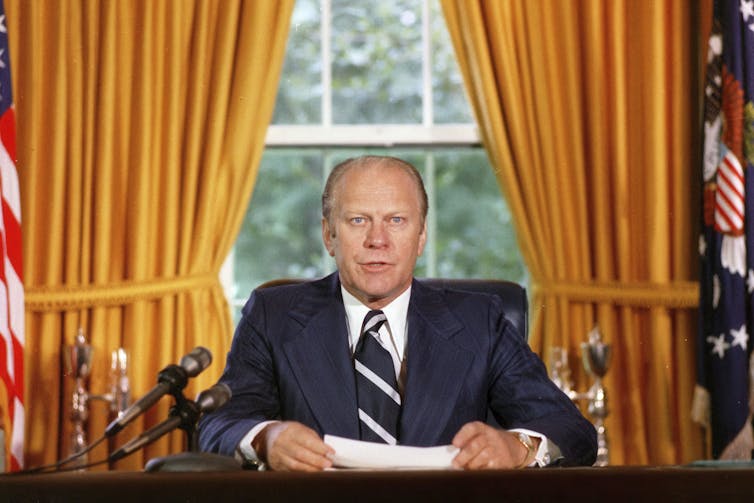Source: The Conversation – in French – By Sylvain Wagnon, Professeur des universités en sciences de l’éducation, Faculté d’éducation, Université de Montpellier
Le rapport de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant publié en cette fin d’année 2025 rappelle que les rythmes scolaires actuels ne sont pas bien en phase avec les besoins des enfants. Proposer régulièrement à ces derniers des pauses actives ne serait-il pas un levier prometteur pour réinventer les journées de classe ?
Rendu public le 22 novembre 2025, le rapport de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant a rappelé que l’organisation de la journée scolaire française reste peu adaptée aux rythmes biologiques et cognitifs des élèves.
Il appelle à une réforme d’ampleur des rythmes scolaires, invitant à repenser non seulement les horaires, mais aussi la manière dont se répartissent attention, repos, mouvement et apprentissages. Dans cette perspective, proposer aux élèves des pauses actives (c’est-à-dire de courtes périodes d’exercices physiques, échauffements ou encore relaxation au fil de la journée) ne serait-il pas un levier particulièrement prometteur ?
Augmenter l’activité physique des enfants, une urgence de santé publique
En 2024 en France, seuls 33 % des filles et 51 % des garçons de 6 à 17 ans atteignent les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : au moins 60 minutes d’activité physique quotidienne d’intensité modérée à soutenue. Parallèlement, entre la classe et les transports, les repas et les temps d’écran, ils restent de longues heures sédentaires.
Cette réalité interroge particulièrement l’école : comment maintenir l’attention d’élèves contraints à rester immobiles de longues heures ? Comment prévenir les troubles de l’attention, fatigue ou anxiété. Des questions d’autant plus urgentes du fait que le système scolaire français fait partie de ceux qui enregistrent le plus grand nombre d’heures de classe données aux enfants durant toute leur scolarité,
Une précision avant de poursuivre : attention à ne pas confondre sédentarité et manque d’activité physique.
La sédentarité correspond au temps passé, assis ou allongé éveillé, avec une dépense énergétique très faible. On peut donc être physiquement actif selon les recommandations de l’OMS (par exemple courir trois fois par semaine), tout en étant très sédentaire si l’on reste assis plus de huit heures par jour. À l’inverse, l’inactivité physique signifie ne pas atteindre les seuils d’activité physique recommandés (au moins 150 minutes hebdomadaires d’intensité modérée).
Ces deux dimensions interagissent mais ne se confondent pas, comme le rappelle le Guide des connaissances sur l’activité physique et la sédentarité publié par la Haute Autorité de Santé en 2022.
Relativement récente en santé publique, cette distinction ne s’est imposée qu’au cours des années 2000, lorsque les grandes enquêtes ont montré que les risques liés à la sédentarité (diabète, maladies cardiovasculaires, certains cancers) existaient indépendamment du manque d’activité physique.
Les pauses actives : bouger quelques minutes ensemble
La pause active désigne un court moment de 5 à 15 minutes de mobilisation physique, intégrée directement dans le temps d’apprentissage ou de travail. Elle se déroule en quatre phases : échauffement, exercice cardio ou moteur, activité de coordination ou d’équilibre, retour au calme par étirements ou respiration.
Elle ne nécessite ni salle dédiée ni matériel particulier. Son efficacité repose sur la régularité : plusieurs fois par jour, entre deux séquences de travail ou d’apprentissage. Si les formes peuvent varier selon les contextes et les âges, il convient de ne pas les confondre avec les temps de recréation, de motricité ou d’éducation physique.
Depuis, de nombreuses études ont confirmé que l’activité physique stimule la plasticité cérébrale et la mémoire. Des études en psychologie cognitive démontrent que quelques minutes de mouvement suffisent à relancer l’attention soutenue et la concentration. La santé publique établit que rompre la sédentarité réduit le stress et prévient les troubles musculosquelettiques.
À l’école : apprendre mieux en bougeant
Depuis une dizaine d’années, les études et les expériences menées au Québec dans la cadre du projet À mon école, on s’active soulignent l’importance de ce type d’activités. En France le ministère de l’éducation nationale français a fait le choix des activités physiques quotidiennes (APQ) pour que chaque élève du premier degré bénéficie d’au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école primaire. Cette mesure lancée, à la rentrée 2022, par le gouvernement, n’est appliquée que par 42 % des écoles primaires, selon un rapport sénatorial de septembre 2024.
Ce dispositif contribue à limiter le manque d’activité physique, mais ne réduit pas nécessairement la sédentarité. Les recommandations françaises actualisées en 2016 distinguent clairement ces deux dimensions : les bénéfices d’une pratique régulière d’activité physique ne compensent pas toujours les effets délétères du temps passé assis. Pour être efficaces, les politiques éducatives doivent donc agir à la fois sur l’augmentation du volume d’activité et sur la réduction des périodes prolongées d’immobilité. La mission flash sur l’activité physique et sportive et la prévention de l’obésité en milieu scolaire d’avril 2025 a réaffirmé l’urgence d’une politique éducative généralisée.
Dans ce contexte, les pauses actives sont présentées comme un moyen complémentaire : elles doivent améliorer la concentration et la mémorisation, réduisent l’agitation pour faciliter la gestion des comportements et le climat scolaire.
Les pauses actives ne peuvent être des activités isolées du reste des apprentissages, elles sont partie prenante d’une éducation intégrale, qui prend en compte non seulement la tête (l’intellect), mais aussi le corps (mouvement, coordination) et le cœur (gestion des émotions). Une vision théorisée par le pédagogue libertaire Paul Robin au milieu du XIXe siècle et qui pourrait être reprise par l’école publique laïque.
Une révolution dans notre rapport au temps
Comme le précise le rapport de la convention citoyenne sur les temps de l’enfant de novembre 2025, les journées des élèves doivent être repensées dans leur globalité, en rééquilibrant sollicitations intellectuelles, besoins physiques et temps de repos.
Intégrer les pauses actives dans les routines quotidiennes ne relève pas d’un gadget, mais d’une transformation profonde de nos manières de travailler et d’apprendre. Elles réintroduisent le rythme, la respiration et le mouvement comme conditions de toute activité intellectuelle. Une question déjà bien étudiée à l’université ou dans le monde professionnel où les pauses actives se développent.
À lire aussi :
Bouger pour mieux apprendre : Comment lutter contre la sédentarité à l’école
Avec les pauses destinées au silence, à la rêverie ou au repos, elles dessinent une véritable écologie du temps, plus respectueuse des besoins humains.
Ces pauses actives à l’école constituent une première étape. Aller plus loin impliquerait d’intégrer le mouvement au cœur même des apprentissages, par exemple grâce au mobilier actif ou encore à des démarches pédagogiques qui associent marche et apprentissage.
La lutte contre la sédentarité pourrait alors devenir l’occasion de repenser plus largement nos modalités éducatives, en valorisant une approche où l’attention, le corps et le savoir évoluent dans l’ensemble des espaces scolaires. Promouvoir ces pratiques, c’est faire le choix d’une société qui prévient plutôt qu’une société qui tente de réparer et qui cultive l’attention plutôt que de l’épuiser.
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Rythmes scolaires : des pauses actives pour repenser les journées de classe et lutter contre la sédentarité – https://theconversation.com/rythmes-scolaires-des-pauses-actives-pour-repenser-les-journees-de-classe-et-lutter-contre-la-sedentarite-271021