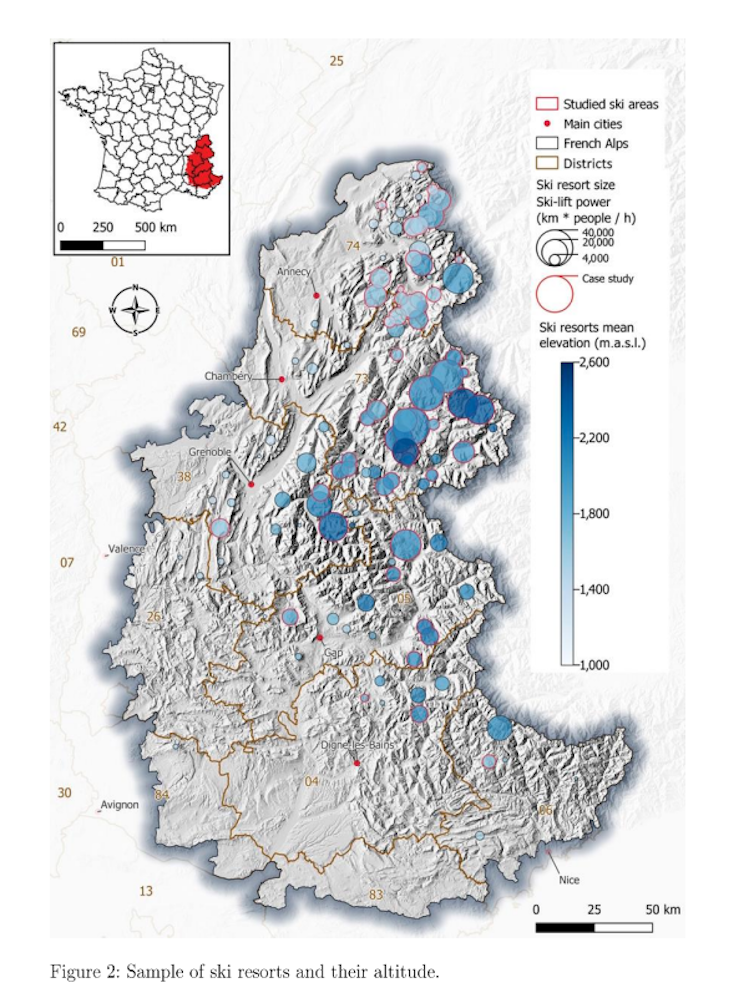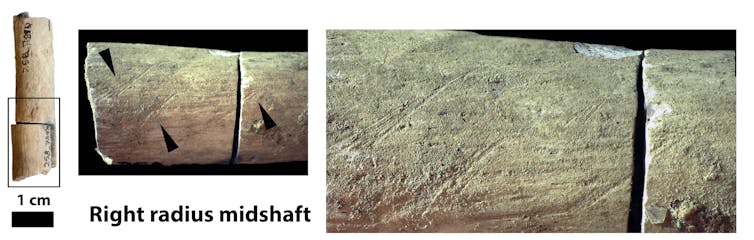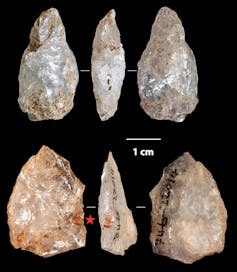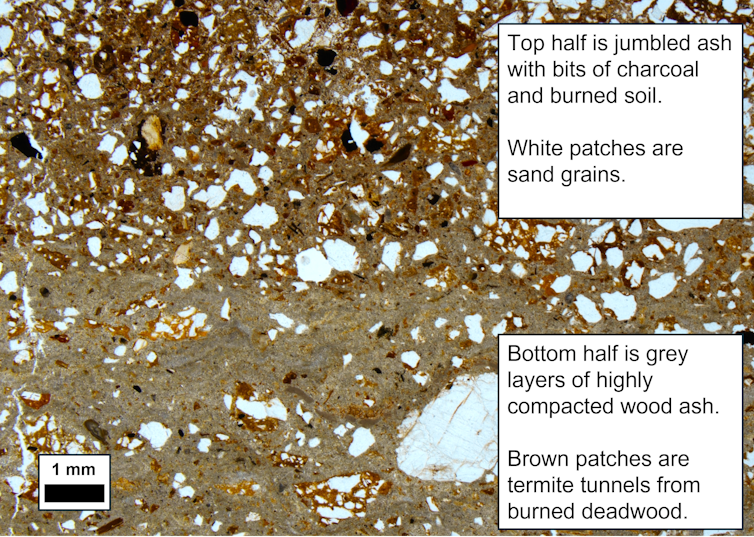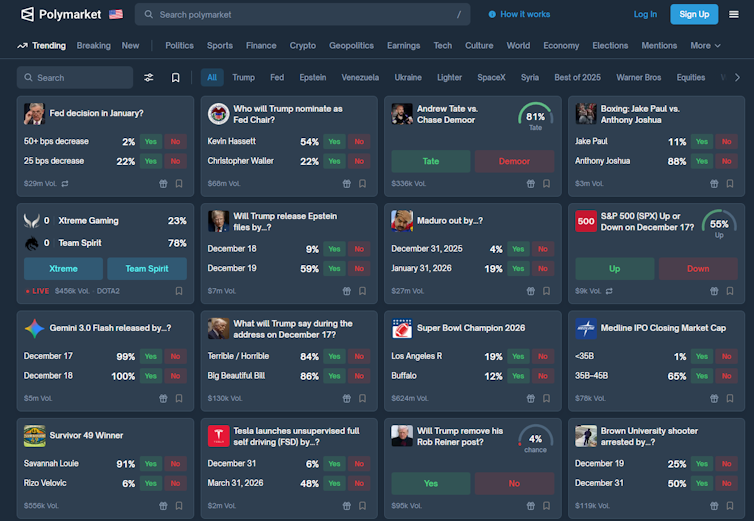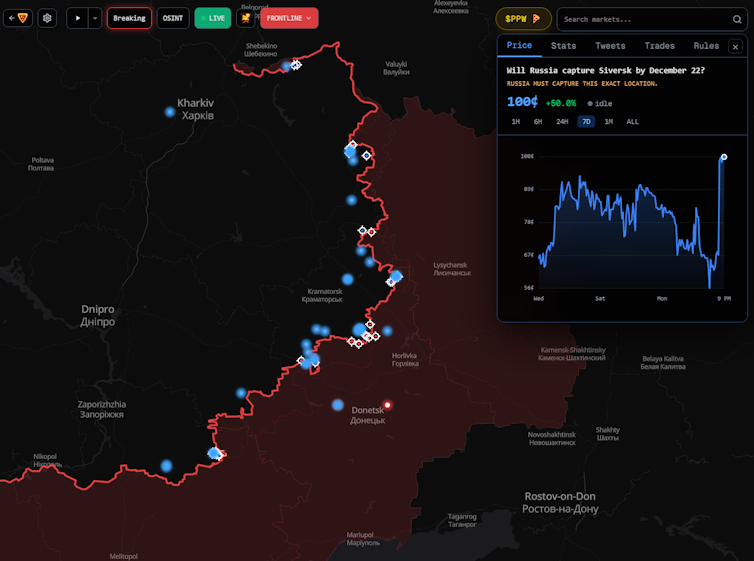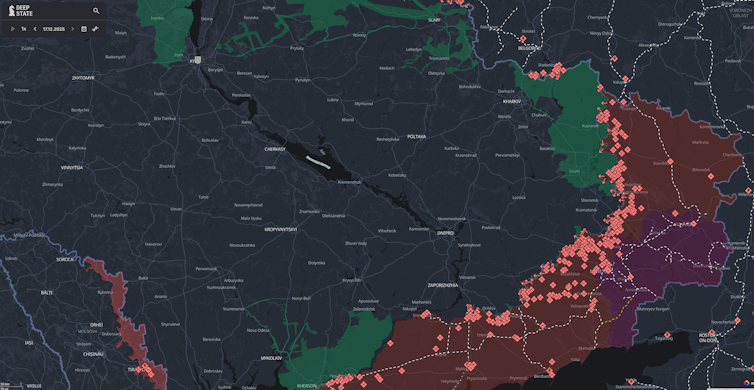Source: The Conversation – (in Spanish) – By Aitana Goicoechea Beltran, Profesora e investigadora en Historia del arte, Aix-Marseille Université (AMU)

Desde Renata de Ferrara hasta Catalina de Médici, el siglo XVI vio nacer a mujeres que supieron entrelazar política y poder en una Europa marcada por las guerras religiosas. Entre esos nombres, sin embargo, Margarita de Francia (1523-1574) ha quedado casi borrada de los grandes relatos.
¿Cómo explicar que una figura que promovió uno de los primeros edictos de tolerancia de Europa, garantizando a los valdenses de Piamonte la práctica de su fe, permanezca en la penumbra?
Su trayectoria recuerda que, incluso en un tiempo de tensiones irreconciliables y violencia religiosa, existieron márgenes para la negociación y la acogida.
Del reino de Francia al ducado de Saboya
Margarita de Francia era hija de Francisco I y hermana del rey Enrique II, dos de los monarcas Valois más influyentes de la Francia del Renacimiento. Exquisitamente formada en lenguas y humanidades y reconocida por su gran cultura, recibió el título de duquesa de Berry en 1550.

Wikimedia Commons
Nueve años después, su matrimonio con Manuel Filiberto de Saboya (1528-1580) selló el fin de las hostilidades entre el reino de Francia y la Monarquía Hispánica. Así, la paz de Cateau-Cambrésis (1559) la situó en el centro de la política europea. La recuperación del ducado de Saboya, ocupado durante años por tropas francesas, le daba al territorio un peso estratégico decisivo en el nuevo tablero político.
Su posición geográfica, en lo que hoy sería la frontera entre Francia e Italia, lo convertía en un territorio permanentemente disputado. Por un lado, el rey Felipe II lo consideraba clave para asegurar el “camino español” hacia Flandes, mientras que, por el otro, la monarquía francesa mantenía ambiciones en el norte de Italia. A ello se sumaba la complejidad religiosa de la región, marcada por la influencia de la Reforma protestante y la proximidad de las comunidades helvéticas.
El duque Manuel Filiberto impulsó la reconstrucción política y militar del ducado con una estrategia de neutralidad armada. En ese marco, la duquesa Margarita no fue una mera consorte: aportó legitimidad dinástica, redes culturales y capacidad diplomática en un espacio fronterizo sometido a constantes presiones.
La paz de Cavour: un edicto pionero
El 5 de junio de 1561, apenas dos años después de su matrimonio y de la restitución de los territorios saboyanos, Margarita de Francia y el duque Manuel Filiberto afrontaron uno de los dilemas más tensos de su gobierno: la convivencia entre católicos y comunidades valdenses en los Alpes piamonteses.

Carlok/Wikimedia Commons, CC BY-SA
La solución fue el Edicto de Cavour, un acuerdo que garantizaba a los valdenses la libertad de culto en sus valles. Las fuentes coinciden en señalar que Margarita desempeñó un papel decisivo en la gestación de este texto. Fue ella quien, con la mediación de Filippo de Saboya, conde de Racconigi y consejero influyente de la corte, convenció al duque de la necesidad de optar por la vía de la tolerancia.
El Edicto de Cavour es considerado uno de los primeros decretos de libertad religiosa en la Europa moderna. Su impacto trascendió las fronteras del ducado: mientras Felipe II consolidaba en la Monarquía Hispánica una política de estricta ortodoxia y los Estados italianos reforzaban el espíritu tridentino, Saboya ensayaba fórmulas de negociación en un territorio marcado por su condición fronteriza.
La corte de Turín, bajo el patronazgo de Margarita, se convirtió además en refugio para perseguidos religiosos, incluidos exiliados franceses y descendientes de sefardíes. La cuestión judía en el ducado de Saboya alimentó el descontento de Felipe II, que veía en ello una connivencia de la duquesa con la heterodoxia. Esta situación hizo que Margarita se hallara bajo sospecha de herejía tanto en Madrid como en Roma, aunque ningún legado papal ni agente del rey español consiguió jamás pruebas en su contra.
Mujeres entre la mediación y la sospecha
La figura de Margarita de Francia puede compararse con varias mujeres de su tiempo y su propia órbita familiar. Renata de Ferrara, su tía materna, mantuvo estrechos lazos con los círculos reformados de Francia, Suiza e Italia, convirtiéndose en protectora de disidentes y foco de tensiones religiosas. Catalina de Médici, su cuñada tras haberse casado con Enrique II, promovió edictos de pacificación que, con mayor o menor eficacia, buscaban contener la violencia confesional que desgarraba el reino de Francia.
Como ellas, Margarita defendió vías de negociación en medio del enfrentamiento entre católicos y reformados. Pero ella lo hizo desde un espacio particularmente frágil: un ducado fronterizo constantemente expuesto a presiones externas al hallarse rodeado por las principales potencias del momento.
En Saboya, su autoridad se vio condicionada por las divisiones internas entre facciones filofrancesas y filoespañolas, y por la cuestión valdense y protestante que marcaba el territorio. La corte de Turín, bajo su patronazgo, acogió a disidentes hugonotes –protestantes calvinistas franceses– y a exiliados de la sangrienta noche de San Bartolomé. Esto acrecentó su prestigio como figura de tolerancia y mediación, pero también las suspicacias en su entorno. Estas resistencias muestran hasta qué punto su apuesta por la convivencia encontró límites, aunque así mismo revelan la singularidad de su posición en la Europa del siglo XVI.
¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.
La trayectoria de Margarita de Francia invita a mirar de nuevo la historia europea desde la periferia y desde voces habitualmente relegadas. En un siglo atravesado por guerras de religión y persecuciones, su decisión de abrir espacios de negociación en un ducado pequeño y vulnerable muestra que la tolerancia no fue solo un ideal teórico, sino una práctica efectiva y posible.
Su silenciamiento posterior en la historiografía responde tanto a su condición femenina como, posiblemente, a la incomodidad que generan las figuras que no encajan en los relatos nacionales o confesionales dominantes. Recordar hoy su experiencia no es solo un ejercicio de memoria, sino también una invitación a repensar la vigencia de la mediación política de las mujeres, la acogida y la pluralidad en sociedades que, aún hoy, siguen debatiéndose entre la convivencia o la exclusión.
![]()
Aitana Goicoechea Beltran no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Margarita de Francia: la duquesa que desafió la intolerancia religiosa en el siglo XVI – https://theconversation.com/margarita-de-francia-la-duquesa-que-desafio-la-intolerancia-religiosa-en-el-siglo-xvi-264087