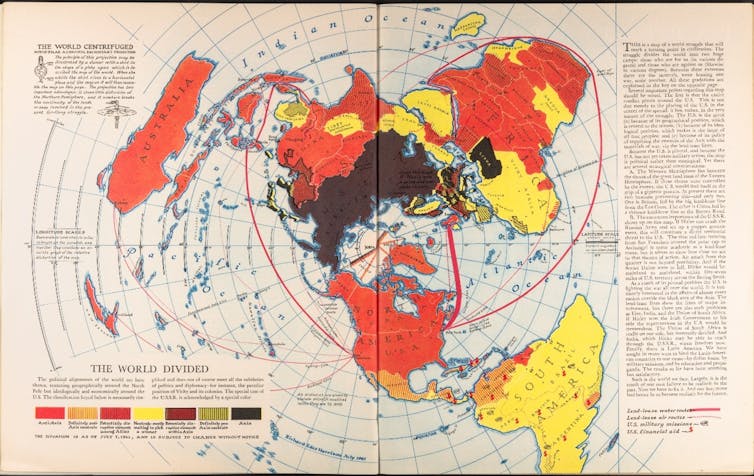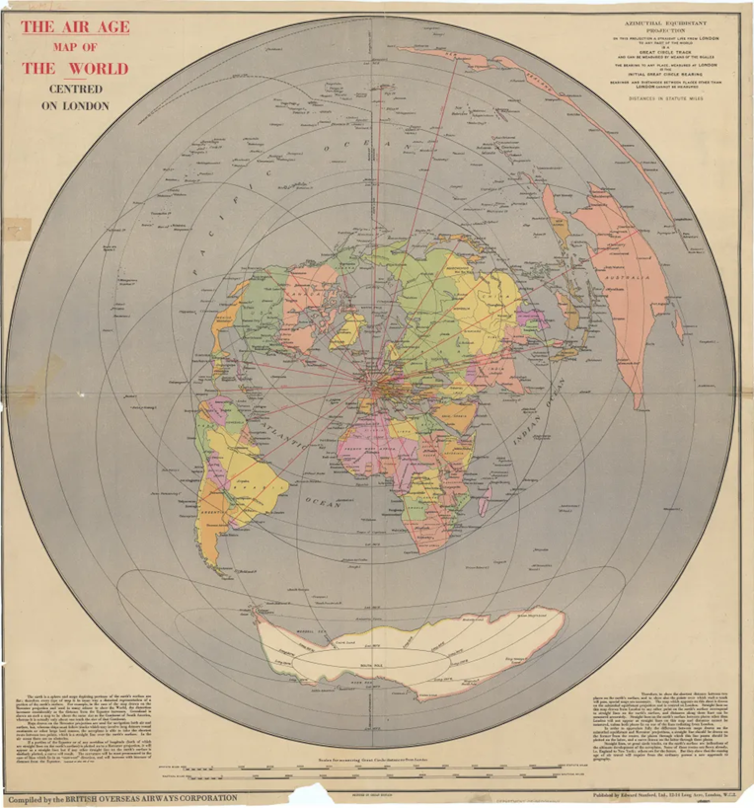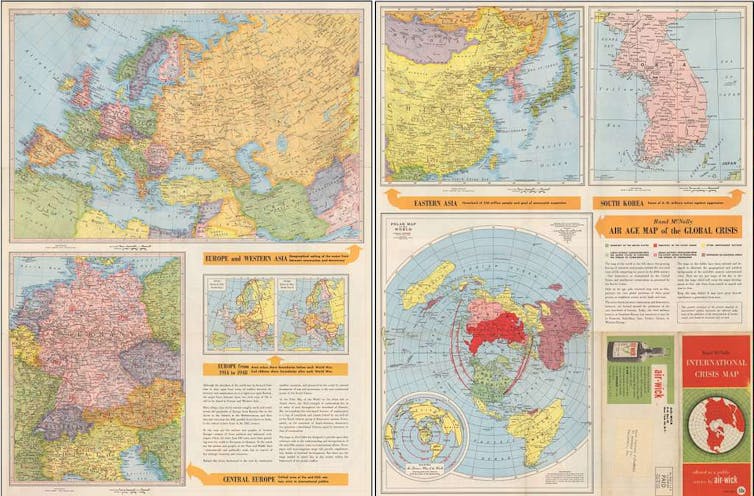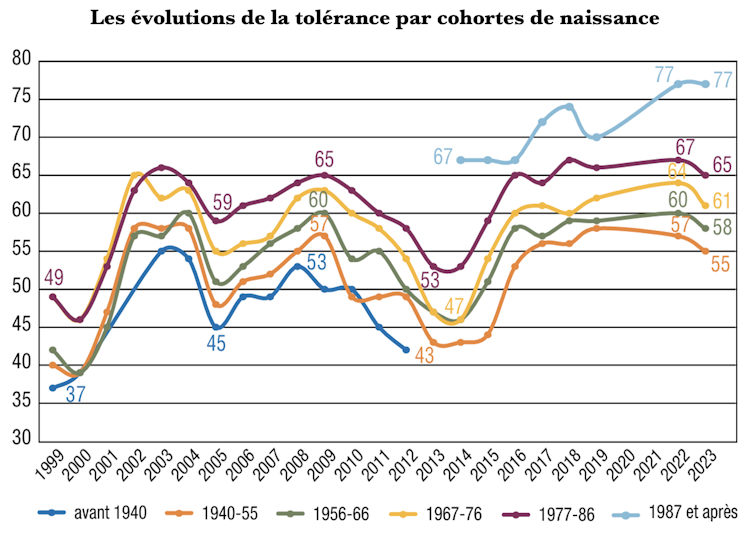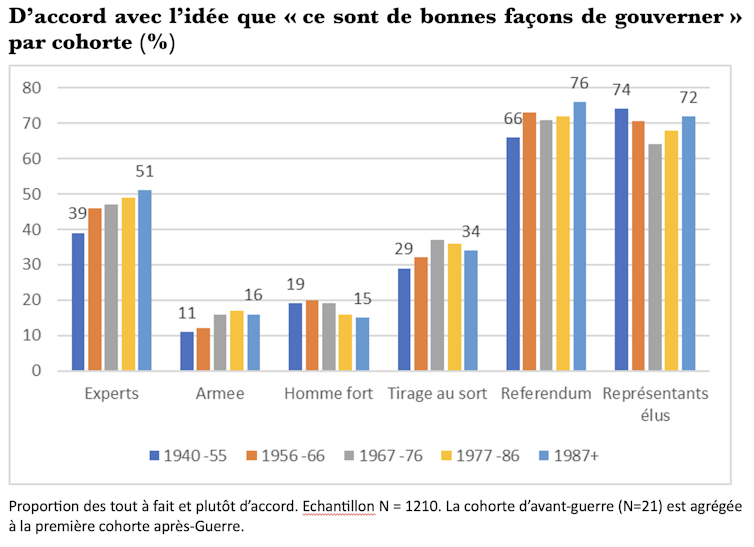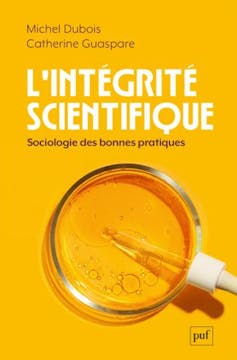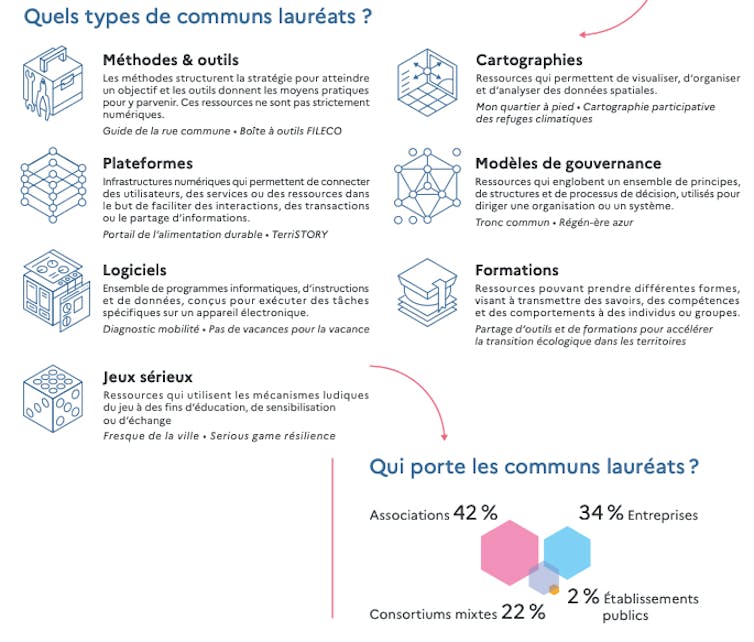Source: The Conversation – UK – By Adam Taylor, Professor of Anatomy, Lancaster University
For some women, pregnancy is a time of profound loss. Not all pregnancies progress as expected. One serious complication is ectopic pregnancy, a condition in which a fertilised egg implants somewhere other than the uterus.
The uterus is the only organ designed to stretch, supply blood and safely support a developing pregnancy. When implantation occurs elsewhere, the pregnancy cannot develop normally and poses significant risks to the mother.
In a very small number of cases, implantation occurs within the abdominal cavity. This is known as an abdominal pregnancy and means the embryo attaches to structures such as the bowel or abdominal lining rather than reproductive organs, often undetected.
There are rare reports of such pregnancies continuing into late gestation and, in extraordinary circumstances, a baby being born healthy. Far more often, however, the outcome is one of the strangest phenomena documented in medicine.
This outcome is known as a lithopaedion, a term derived from Greek that translates literally as “stone baby”. Fewer than 350 to 400 cases have been described in the medical literature, making it exceptionally rare.
In these cases, a woman usually experiences at least the early stages of pregnancy. Some reach full term and even go through labour; the body initiates the physical process of childbirth, but no baby is delivered. In some instances, particularly where access to healthcare is limited, a pregnancy may go entirely unnoticed.
The foetus in these cases has sadly died. After approximately three months of gestation, the foetal skeleton begins to ossify into bone. Ossification is the normal biological process by which soft cartilage turns into hardened bone. Once this has occurred, the foetal remains are too large and structurally complex for the body to break down and absorb.
During a typical pregnancy, the placenta plays a crucial role in regulating the exchange of nutrients and immune signals between mother and foetus. At the same time, the maternal immune system enters a state of immune tolerance: it is partially suppressed to prevent it from attacking the genetically distinct foetus. When the foetus is no longer viable, these protective mechanisms disappear. The immune system then recognises the foetal tissue as foreign and potentially dangerous.
To protect itself from infection or inflammation, the body may respond by calcifying the foetus. Calcification involves the gradual deposition of calcium salts around tissue, effectively isolating it. This process seals the foetus off from surrounding organs, preserving it in place and preventing further harm.
Calcification as a defensive response is not unique to pregnancy. The process of dystrophic calcification occurs when calcium deposits form in dead or damaged tissue. Calcium binds to phospholipids, which are fat-based molecules that make up the outer structure of cells and help hold cell membranes together, stabilising the area and limiting injury. A similar biological mechanism contributes to calcium build-up in blood vessels during atherosclerosis, a condition associated with heart disease.
Lithopaedion formation has also been observed in other species, including rabbits, dogs, cats and monkeys. One of the earliest recorded human cases dates back to 1582, involving a 68-year-old French woman who carried a lithopaedion for 28 years.
Another widely reported case describes a woman in China who carried one for over 60 years. Some lithopaedions have been reported to weigh more than two kilograms, roughly the weight of a full-term newborn. In one exceptionally rare case, a woman was found to have twin lithopaedions.
Symptomless cases
Some women carry a lithopaedion without symptoms for many years. Others develop complications caused by its presence in the abdomen. These include pelvic abscesses, which are collections of infected fluid, twisting or obstruction of the intestines that interfere with digestion, fistula formation – meaning abnormal connections between organs – and other abdominal symptoms such as pain or swelling.
Cases without symptoms are often discovered postmortem – after death during examination. When symptoms do occur, surgical removal is usually required. Because lithopaedions develop outside the uterus, they may attach to nearby organs such as the bowel or bladder.
Each case must therefore be carefully assessed. Surgery may be performed laparoscopically, using small incisions and a camera to minimise recovery time, or may require a more extensive open abdominal procedure.
Diagnosis almost always relies on medical imaging. This often occurs incidentally while investigating other symptoms. Calcified foetal bones can be identified using X-rays, ultrasound or CT scans. CT scans are particularly useful because they provide detailed cross-sectional images that clearly show both bone and surrounding soft tissue.
Lithopaedion cases are now exceptionally rare, likely even more so in modern medicine due to accurate pregnancy testing, early ultrasound scanning and routine antenatal care. Although these cases are medically unusual, they highlight both the vulnerability and resilience of the human body. Whether supporting new life or responding when pregnancy ends unexpectedly, the body works to protect the person carrying the pregnancy, sometimes in ways that continue to surprise medicine centuries later.
Strange Health is hosted by Katie Edwards and Dan Baumgardt. The executive producer is Gemma Ware, with video and sound editing for this episode by Sikander Khan. Artwork by Alice Mason.
In this episode, Dan and Katie talk about a social media clip from tonsilstonessss on TikTok.
Listen to Strange Health via any of the apps listed above, download it directly via our RSS feed or find out how else to listen here. A transcript is available via the Apple Podcasts or Spotify apps.
![]()
Adam Taylor does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
– ref. Stone baby: the rare condition that produces a calcified foetus – https://theconversation.com/stone-baby-the-rare-condition-that-produces-a-calcified-foetus-274178