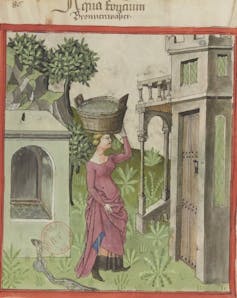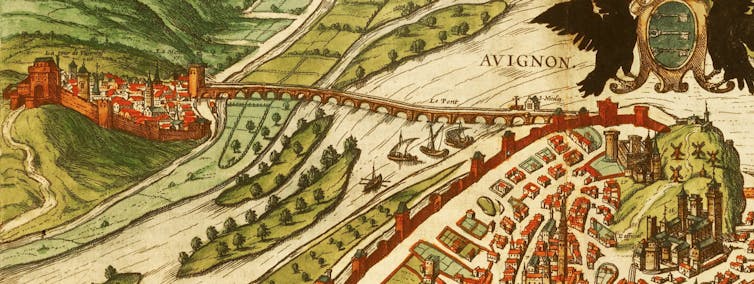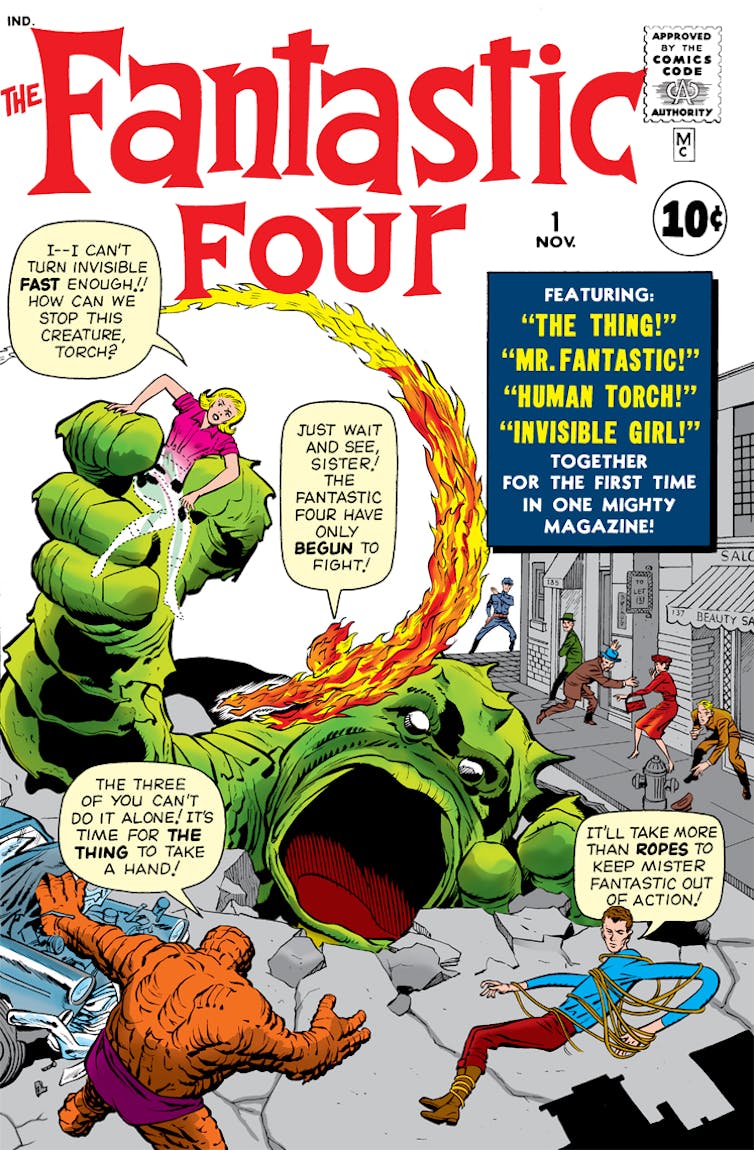Source: The Conversation – (in Spanish) – By James Manuel Pérez-Morón, Profesor Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de La Sabana

¿Cambiaría la comodidad de un hotel cinco estrellas por las frías paredes de una prisión abandonada, la suave brisa soplando en una playa paradisíaca por el silencio estremecedor de un antiguo campo de concentración?
¿Y si sus vacaciones incluyeran el recorrido por escenarios de masacres y batallas o escuchar relatos de muerte narrados por antiguos sicarios?
Aunque pueda parecer una elección imposible, hay personas que optan por destinos asociados con lo trágico o escabroso. Esta práctica tiene nombre, incluso varios. Se le llama turismo oscuro, turismo mórbido, turismo del dolor, turismo de nostalgia, turismo de tristeza o tanatoturismo.
El tamaño del fenómeno
En febrero de 2025, el mercado global del turismo oscuro ascendía a 3,7 mil millones de dólares, con proyecciones que indican que alcanzará los 40,2 mil millones en 2033, a un ritmo de crecimiento anual del 3 %.
Aunque la Organización Mundial del Turismo no ofrece estadísticas específicas para este tipo de turismo, permite inferir su auge el aumento del número de visitantes a:
-
Monumentos conmemorativos, como los memoriales del 11-S, en Nueva York, y el del Holocausto, en Berlín.
-
Zonas de desastre como Wuhan, en China, la zona cero de la pandemia de covid-19; Chernóbil, en Ucrania, donde, en 1987, se produjo el peor accidente nuclear en territorio europeo; o Kobe, en Japón, donde se han mantenido intactas algunas de las zonas devastadas por el gran terremoto de enero de 1995.
-
Lugares relacionados con la muerte y la violencia: los campos de concentración y de exterminio nazis (Auschwitz, Polonia; Buchenwald, Alemania; Mauthausen-Gusen, Austria, entre muchos otros), los campos de la muerte camboyanos o los memoriales del genocidio ruandés.
Algunos países publican cifras precisas: el memorial del 11‑S en Nueva York ha recibido más de 20 millones de visitantes desde su apertura. El campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, sigue siendo uno de los sitios más visitados de Europa con cerca de dos millones de personas al año. Hasta el inicio de la guerra, en 2022, Chernóbil había registrado más de 100 000 turistas por año.
¿Qué motiva al turista oscuro?
Algunos buscan comprender mejor el pasado, otros rendir homenaje a las víctimas o vivir experiencias emocionales profundas. Más allá de lo escabroso, puede haber una búsqueda de vivencias que conecten con el dolor y con la historia.
Este tipo de turistas no suelen ser los viajeros tradicionales, que buscan playas o descanso. Más bien mezclan el perfil del turista cultural con el aventurero. Rechazan el turismo masivo y prefieren lo experiencial, introspectivo y conmovedor.
El perfil más común del turista oscuro es el de personas adultas con alto poder adquisitivo que eligen, por ejemplo, recorrer ciudades marcadas por un conflicto armado o visitar monumentos conmemorativos que recuerdan a héroes o víctimas de conflictos.
De la guerra al turismo: territorios resignificados
Las guerras han dejado tras de sí un legado que muchos países han transformado en memoria y turismo. Hiroshima y Nagasaki, que en agosto de 1945 se vieron arrasadas por las bombas nucleares estadounidenses, son hoy “ciudades de paz”, integradas en asociación para contribuir a la consecución de una paz mundial duradera que promueven museos y parques conmemorativos y reciben entre 6 y 8 millones de visitantes anuales.
Alemania, Francia y Bélgica han convertido trincheras, bunkers y cementerios de guerra en atractivos turísticos, siempre bajo un enfoque educativo y de recuerdo.
Chernóbil, por su parte, se ha convertido en un símbolo del turismo de catástrofes. A pesar del peligro generado por las radiaciones, miles de personas pagan por caminar entre sus ruinas, impulsadas incluso por el éxito de series televisivas y películas.
Lo mismo ocurre con otros destinos afectados por desastres naturales, como Nueva Orleans (huracán Katrina, 2005) o Japón (terremoto y posterior tsunami, 2011), que han desarrollado rutas de interpretación del riesgo.
Turismo y crimen: una línea delicada
Otro componente del turismo oscuro es el turismo relacionado con el crimen y la violencia. En Italia, Mexico, Colombia, por ejemplo, existen recorridos por rutas relacionadas con la vida de extintos capos del narcotráfico, barrios donde operaban carteles o visitas teatralizadas a campamentos guerrilleros simulados.
El turismo sombrío también incluye sitios donde murieron de forma violenta personas famosas. Está el portal del edificio Dakota, en Nueva York, donde fue asesinado John Lennon en 1980. En Dallas es visita casi obligada la zona de la plaza Dealey, por donde pasaba la comitiva presidencial cuando, en noviembre de 1963, un francotirador hirió mortalmente al presidente Kennedy.
En París, en la entrada al túnel bajo el puente de Alma, en París, está la plaza Diana en memoria de Diana Spencer, Lady Di, que murió al chocar contra uno de los pilares del túnel el coche en el que huía de los paparazzis.
Otros lugares clásicos del turismo oscuro son la prisión de Alcatraz (que ahora Trump se ha propuesto recuperar para su uso original), las catacumbas de París o las ruinas de Pompeya. Todos estos lugares, además de por su valor histórico, despiertan un interés especial por haber sido lugares de muerte, encierro o destrucción.
Dolor que genera conciencia y crecimiento
El turismo oscuro no es una moda pasajera. Es una expresión compleja del deseo humano por conectar con los eventos más dolorosos de la historia.
Tampoco se trata de mercantilizar el dolor ni de banalizar el sufrimiento, sino de promover una forma de turismo que si es ético, respetuoso y responsable, puede cumplir una doble función: ofrecer una experiencia significativa al visitante y generar ingresos para comunidades que fueron víctimas de conflictos, catástrofes o de la violencia estructural.
Además de generar empleo local e impulsar el desarrollo económico de la zona, el turismo sombrío puede ser una oportunidad para el resarcimiento (aunque sea simbólico) de las víctimas, y para educar e intentar prevenir futuras tragedias.
Visitar estos lugares implica un llamado a la conciencia: antes de tomarse una selfie o buscar la mejor foto para publicar en redes sociales, recuerde que está pisando escenarios marcados por el sufrimiento humano. La empatía debe guiar cada paso del recorrido.
Mirar este turismo con seriedad, evitar conductas inapropiadas y asegurar su gestión ética es el primer paso para transformar la tristeza en conciencia y el pasado en posibilidad de un presente y futuro más justo.
![]()
James Manuel Pérez-Morón no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Visitas a Auschwitz, selfies en Chernóbil: los atractivos del turismo oscuro – https://theconversation.com/visitas-a-auschwitz-selfies-en-chernobil-los-atractivos-del-turismo-oscuro-261488