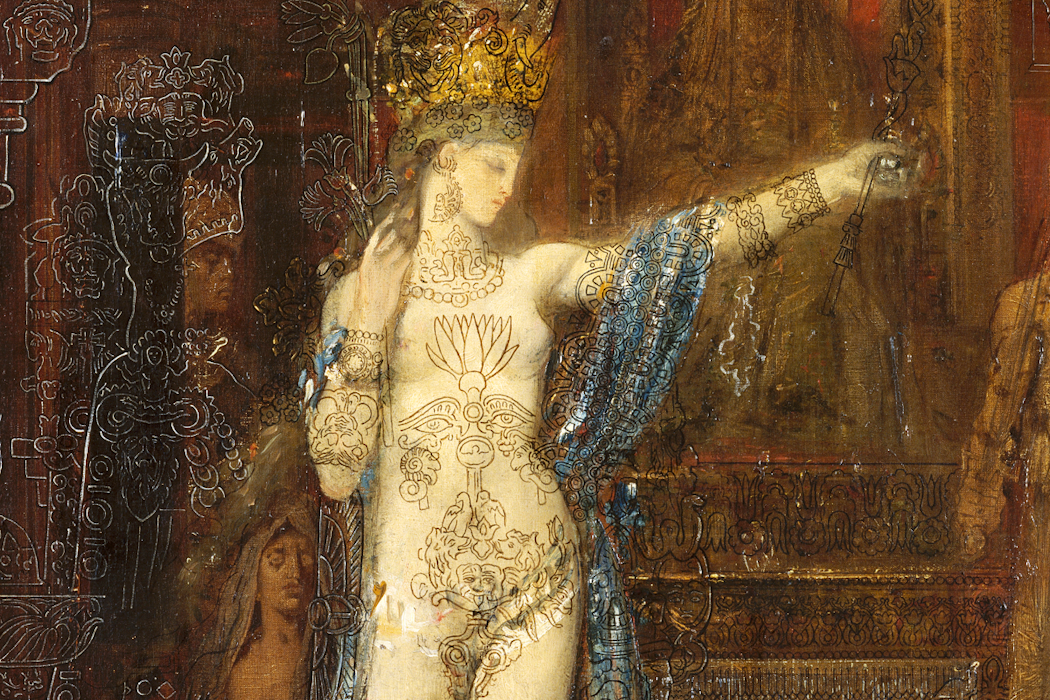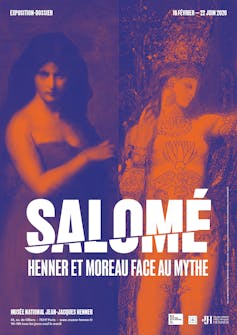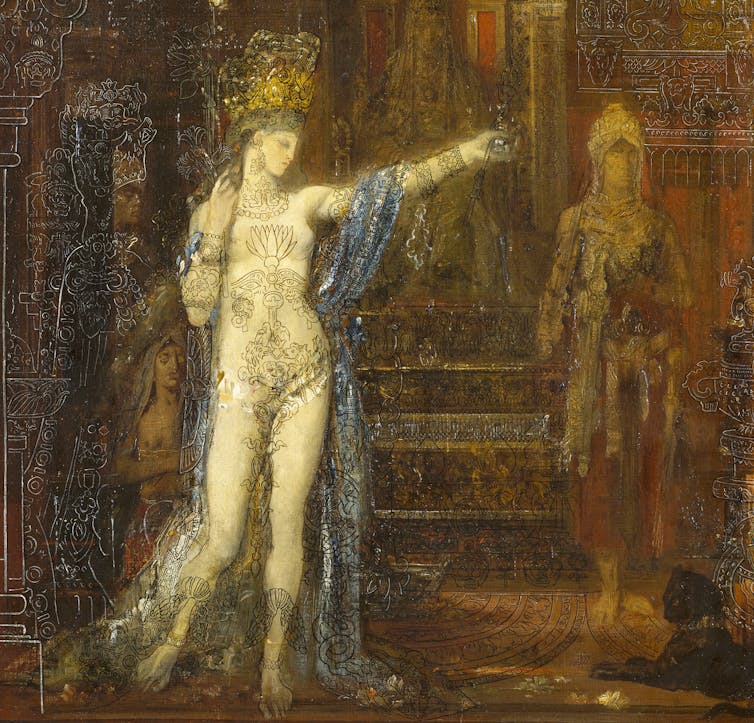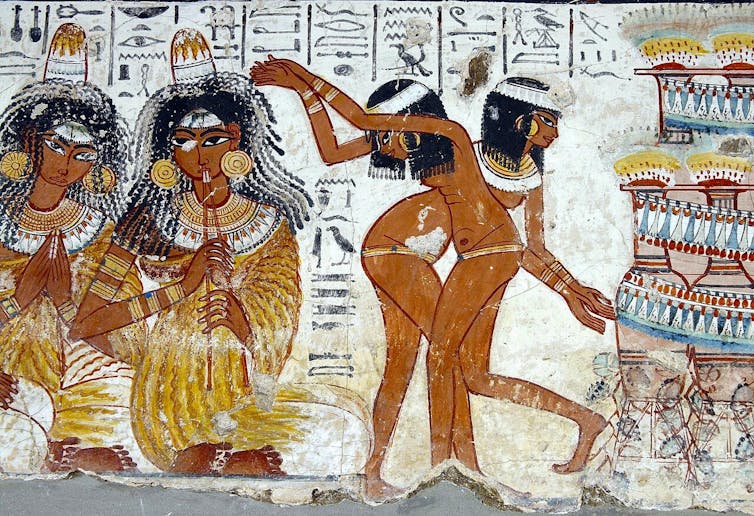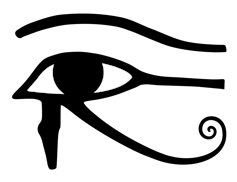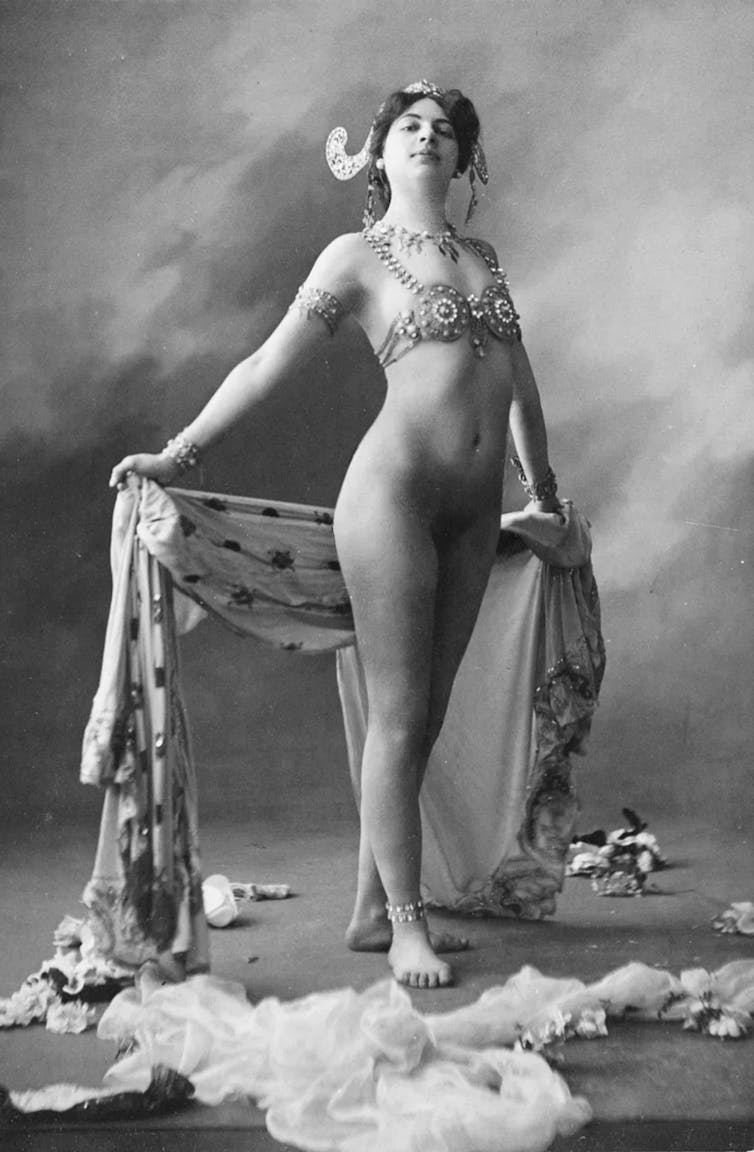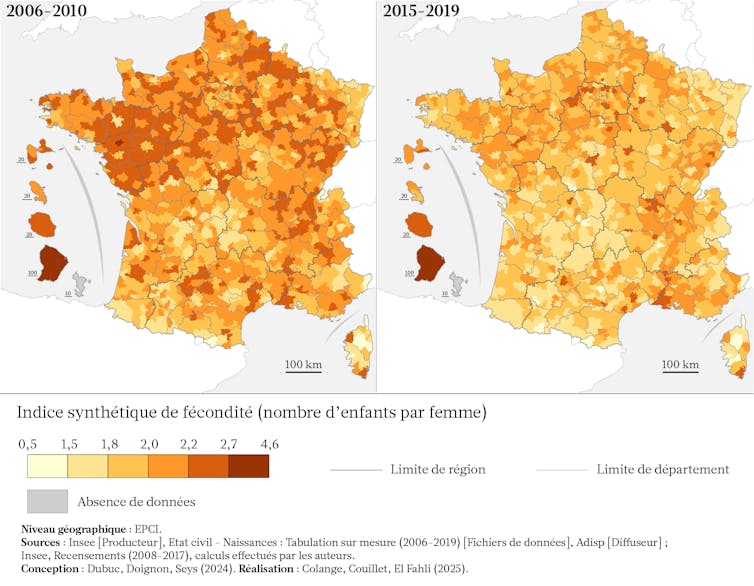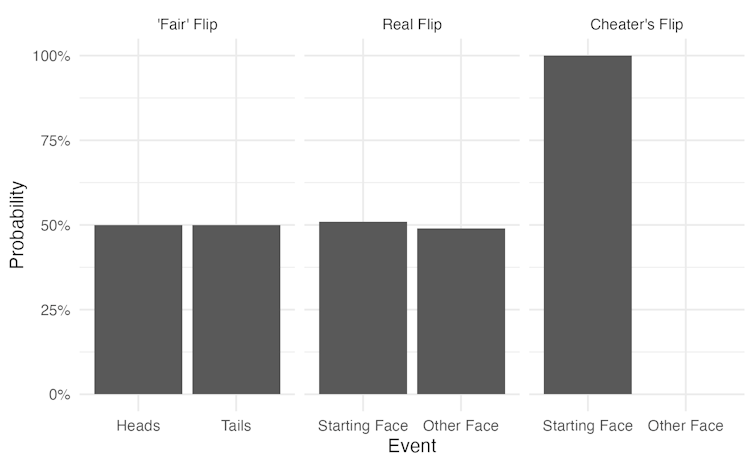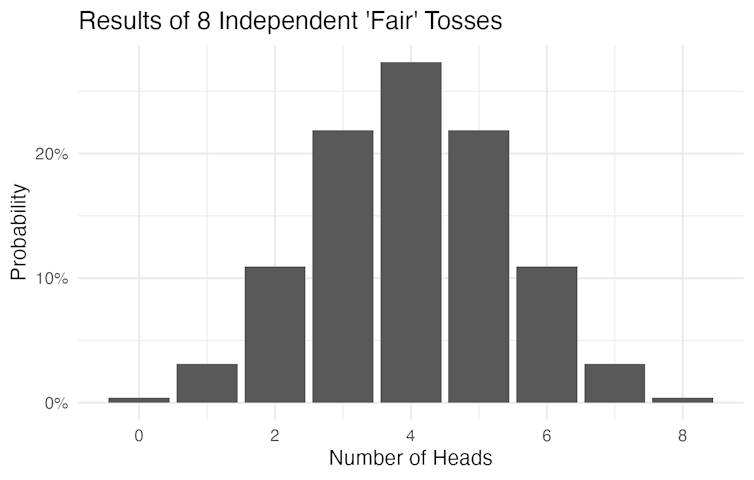Source: The Conversation – in French – By Amanda Bisong, Policy Leader Fellow, School of Transnational Governance, European University Institute
Il y a un an, les nouveaux gouvernements du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont officiellement quitté la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) après avoir créé l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette décision faisait suite aux tensions diplomatiques liées aux coups d’État militaires dans ces trois pays. À la suite des ces événements, l’organisation les avait suspendus et leur avait imposé de lourdes sanctions.
Les répercussions de la scission de la Cedeao continuent de se faire sentir. Un domaine sera particulièrement touché: la migration et la libre circulation dans la région.
La Cedeao a mis en place plusieurs protocoles de libre circulation. Ils permettent de voyager sans visa. En principe, ils donnent aux citoyens le droit de résider et de s’établir dans la région.
Nos travaux sur la gouvernance migratoire en Afrique de l’Ouest, au niveau régional et dans des contextes particuliers comme le Niger, nous permettent de nous forger une opinion sur l’impact de cette rupture.
Nous soutenons qu’à ce stade, la libre circulation reste possible sur le plan technique. Mais la situation évolue vite. Examiner ces évolutions sous l’angle de la mobilité met en évidence la fragilité institutionnelle plus profonde de la CEDEAO, pourtant créée pour renforcer la coopération entre les États de la région.
Read more:
50 ans de la Cedeao : comment incarner la voix des peuples
La Cedeao sans les États de l’alliance du Sahel
Au niveau régional, les dirigeants ont montré leur engagement continu en faveur de la sauvegarde de la libre circulation. Selon le président de la Commission de la Cedeao, Omar Touray, qui s’est exprimé le jour où le retrait de l’AES est entré en vigueur, « nous restons une communauté, une famille.
Les cartes d’identité nationales et les passeports portant le logo de la Cedeao des citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger continueront d’être reconnus. Jusqu’à nouvel ordre, il en sera de même pour tous les droits protocolaires liés au droit de circulation, de résidence et d’établissement. Les États de l’Alliance du Sahel, pour leur part, ont offert pour l’instant un accès sans visa à la Cedeao. Mais il ne s’agit là que d’une solution temporaire.
En décembre 2025, le chef militaire burkinabé Ibrahim Traoré a lancé la première carte d’identité biométrique AES au Burkina Faso. Elle est destinée à remplacer les documents de la Cedeao d’ici cinq ans.
En matière de circulation, les choses bougent déjà sur le terrain. Entre des conditions d’entrée plus strictes, de nouveaux modèles de passeports et des systèmes d’identification, les citoyens qui traversent les frontières sont confrontés à une incertitude croissante et à des coûts plus élevés. Pourtant, les mouvements transfrontaliers restent une nécessité pour travailler et subvenir à ses besoins.
Read more:
Confédération du Sahel : risques et défis d’une nouvelle alliance
Malgré les changements induits par le départ des pays de l’AES de la Cedeao, une autre difficulté pèse sur la libre circulation : la politique d’externalisation des frontières de l’Union européenne (UE). Dans l’ensemble de la région, le financement de l’UE pour l’externalisation des frontières se poursuit. L’UE accorde du soutien financier complémentaire pour les infrastructures de contrôle des migrations et des frontières, comme au Sénégal par exemple. Elle soutien aussi divers projets de renforcement des capacités aux frontières en cours.
Il convient de noter que cette tendance a été partiellement inversée par les États de l’AES. Un exemple frappant est l’abrogation de la tristement célèbre loi 2015-36 sur le trafic de migrants au Niger. Bien qu’il s’agisse d’une loi nigérienne, sa mise en œuvre a été fortement soutenue par les projets de renforcement des capacités de l’UE et a effectivement criminalisé un secteur de la mobilité qui existait depuis longtemps. En abrogeant cette loi, le nouveau gouvernement nigérien a mis fin aux effets néfastes de celle-ci sur l’économie, les droits des migrants et la libre circulation dans la région.
Dans l’ensemble, le retrait de l’Alliance du Sahel affecte déjà la mobilité régionale. Au-delà des droits à la libre circulation, le retrait de l’Alliance du Sahel a également des effets très concrets sur le cadre institutionnel de la Cedeao, en termes de légitimité, d’autorité institutionnelle et de protection des droits des migrants.
Légitimité et défis financiers
La Cedeao est confrontée à une crise de légitimité croissante. Le retrait des pays de l’Alliance des États du Sahel a mis en évidence la faiblesse de la Cedeao à réagir aux changements anticonstitutionnels au sein des gouvernements. Les réponses ont souvent été tardives et sélectives, et les sanctions, lorsqu’elles ont été imposées, ont eu des effets néfastes pour les populations locales.
Le départ de ces pays, qui ont tous connu des coups d’État, a confirmé la perception largement répandue d’une application sélective des normes par l’organisation. Cela a alimenté le scepticisme du public.
En outre, l’inefficacité des processus, la faible utilisation des capacités existantes et la mauvaise communication des résultats ont entraîné depuis le début de faibles taux de mise en œuvre des projets et programmes de la Cedeao. Par exemple, plusieurs États membres n’ont pas supprimé l’obligation de séjour de 90 jours, pourtant adoptée en 2014.
Par conséquent, les citoyens ne voient pas les avantages concrets de l’intégration régionale. De nombreux Africains de l’Ouest continuent de la considérer comme un simple « club de chefs d’État ».
Le fossé entre l’organisation et ses citoyens est également dû à la forte dépendance de la Cedeao vis-à-vis des bailleurs de fonds externes. La réduction des contributions des États membres, souvent due au non-paiement de la contribution à la Cedeao, a privé la commission des ressources de base nécessaires. Elle a été contrainte de réduire le nombre de réunions et d’engagements essentiels à la mise en œuvre des politiques. En conséquence, les priorités régionales sont souvent déterminées par les intérêts des bailleurs de fonds plutôt que par les besoins des citoyens.
Read more:
L’Alliance des États du Sahel : un projet confédéraliste en questions
Des améliorations récentes ont été observées, notamment avec l’augmentation des paiements de certains pays tels que le Nigeria. Mais le système de collecte des contributions reste faible et peut être facilement contourné par les États membres. Cette faiblesse a toujours freiné la mise en œuvre des protocoles sur la libre circulation. Elle risque d’en affaiblir davantage l’application.
Enfin, l’éclatement de de la Cedeao entrave également l’accès à la justice, notamment pour les migrants. Un groupe d’associations de défense des droits des migrants a saisi collectivement la Cour de justice de la Cedeao en 2022. Il dénonce notamment les violations des droits des migrants à la libre circulation au Niger. En mars 2025, la Cour a rejeté toutes les affaires concernant le Niger, le Mali et le Burkina Faso.
Que nous réserve l’avenir ?
Les mouvements au sein de la région se poursuivront, car ils répondent à une nécessité économique. Comme nous l’avons montré dans nos recherches précédentes, quelle que soit la législation en vigueur, les migrations se poursuivront. Et les décideurs politiques le savent.
Mais à quel prix pour les migrants et les citoyens ordinaires si ces faiblesses institutionnelles persistent ? La Cedeao doit affronter sa crise de légitimité. Elle doit mettre en œuvre des réformes significatives et renouer avec les réalités de la vie quotidienne en Afrique de l’Ouest. C’est à cette condition qu’elle pourra offrir un cadre solide de protection des migrants et des personnes en déplacement dans la région.
Sans changement décisif, le fossé entre le discours de l’organisation sur une « Cedeao des peuples : paix et prospérité pour tous » et son impact continuera de s’élargir.
![]()
Franzisca Zanker bénéficie d’un financement de l’Union européenne (ERC, PolMig, 101161856). Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux de l’auteur uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou du Conseil européen de la recherche. Ni l’Union européenne ni l’autorité octroyant le financement ne peuvent en être tenus responsables.
Leonie Jegen received funding from the Rosa Luxemburg Foundation.
Amanda Bisong does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
– ref. La Cedeao sans les États du Sahel : comment cette scission met à l’épreuve la libre circulation et la légitimité régionale – https://theconversation.com/la-cedeao-sans-les-etats-du-sahel-comment-cette-scission-met-a-lepreuve-la-libre-circulation-et-la-legitimite-regionale-276428