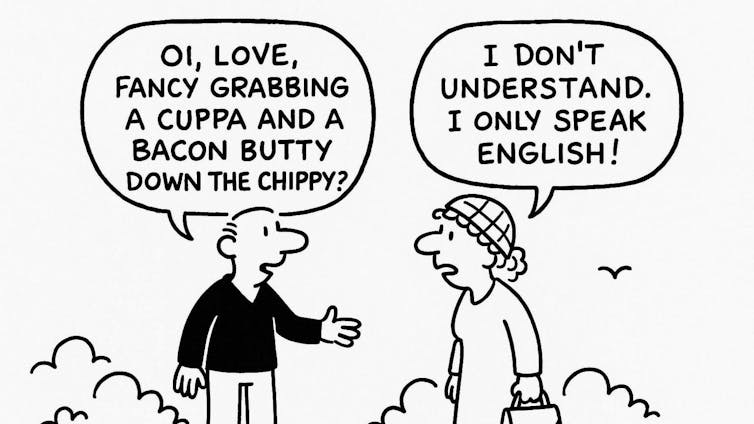Source: The Conversation – in French – By Justin GOMIS, Attaché Temporaire d’enseignement et de Recherche (NIMEC), Université de Rouen Normandie
« Innovation ouverte », « cocréation »… ne sont pas que des mots à la mode. Ils renvoient à de nouvelles pratiques d’innovation, associant de multiples acteurs, là où avant la R&D était toute-puissante. Si ouvrir le processus d’innovation n’est pas sans danger, des moyens existent pour les limiter. L’exemple de Decathlon en est une illustration.
Concevoir de nouveaux produits est une activité risquée et de plus en plus coûteuse, dans un contexte d’intense concurrence. Pour surmonter ces défis, impliquer les clients durant tout le processus d’innovation, en faisant d’eux des acteurs à part entière, afin de créer de la valeur mutuelle, constitue une voie à étudier. Cela passe par l’utilisation des plateformes numériques qui ont aussi, depuis quelque temps, contribué à la démocratisation des pratiques d’innovation ouverte.
La réalité économique récente a mis en évidence le succès de ces nouveaux modes d’innovation.
Ces pratiques impliquent la réunion de multiples intervenants, comme des industriels, des usagers et des clients, ou encore des collectifs de citoyens, des associations, et, dans certains cas, les représentants des pouvoirs publics…
Une rapide adoption
Les pratiques d’innovation ouverte et de cocréation de valeur ont connu un succès et une adoption rapide, de la part des managers de l’innovation, par définition, mais aussi dans les domaines du marketing, de l’ingénierie, de la technologie, de la santé…
Si ces pratiques ont rencontré un certain succès chez les consommateurs, c’est qu’elles faisaient écho à des changements plus profonds les concernant. En effet, la mondialisation de l’économie, les préoccupations environnementales croissantes et le développement d’une société du savoir élèvent le niveau d’exigence et les attentes des consommateurs. Désormais mieux informés et interconnectés, ils ne se contentent plus de recevoir passivement des produits et services.
À lire aussi :
Innovation ouverte et réseaux sociaux : un potentiel qui reste à exploiter
Des réussites, mais aussi des échecs
Une part croissante des clients actuels ou futurs d’une marque désire activement participer à la conception des produits et à la création de valeur. Par exemple, des entreprises telles que Pepsi, Starbucks, Dell, Lego et Adidas ont mis en œuvre le processus de cocréation de valeur pour innover avec leurs clients, en intégrant mutuellement leurs ressources. En France, tous secteurs confondus, plusieurs grandes entreprises se sont, elles aussi, adonnées aux pratiques d’innovation ouverte et de cocréation de valeur depuis plus d’une décennie : Michelin, EDF, la Société générale, la SNCF, Bouygues et Decathlon, par exemple.
Cependant, cela n’est pas sans risque pour les entreprises. Si certaines plateformes obtiennent un succès notable dans la génération continue d’innovations – comme InnoCentive.com, Eÿeka, Storm ID, Lego Ideas –, d’autres – telles que MyStarbucksIdea ou Dell IdeaStorm – échouent ou subissent un exode de participants.
Ces échecs peuvent être attribués à trois facteurs :
-
les difficultés d’adéquation produit/service – marché ;
-
les abus et l’exigence des utilisateurs, ainsi que l’évolution constante de leurs attentes (par exemple, les consommateurs veulent voir sur le marché des produits écoconçus et plus durables, avec des cycles de vie plus allongés, des chaînes d’approvisionnement plus éthiques et des impacts sociaux plus nombreux et plus positifs) ;
-
la complexité dans la mise en place de mécanismes de gouvernance du processus d’innovation en général (recrutement, sélection et animation).
Un processus « win-win »
Pour Decathlon, ces risques sont susceptibles de constituer un frein à l’innovation. Certains chefs de projet les associent à un manque de considération, de reconnaissance et à une mauvaise connaissance des utilisateurs. D’autres les associent à des difficultés d’animation de la communauté en ligne, ou bien à des problèmes de comportement venant du public, dont les risques d’abus. Et d’autres encore l’associent à un problème de gestion de réintégration des contributions diverses.
Face à toutes ces menaces, des entreprises comme Decathlon mettent en place des mécanismes de cocréation de valeur pour limiter ces risques et pour garantir malgré tout un processus d’innovation « win-win » («gagnant-gagnant ») avec les utilisateurs.
La cocréation de valeur est une initiative conjointe à travers laquelle l’entreprise, les fournisseurs et les clients créent de la valeur ensemble.
Chez Decathlon, d’autres partenaires externes peuvent y contribuer, comme des cabinets de conseil, des institutions de recherches… Cette diversité d’acteurs est un véritable atout pour la marque.
L’intérêt de la démarche va au-delà de la création de solutions techniques originales, comme en témoigne un chef de produit interrogé dans le cadre de nos recherches :
« On peut aussi avoir une phase dans le dessin, où on va demander aux utilisateurs de nous dessiner, de nous faire un croquis de leurs idées pour vraiment favoriser l’émergence de solution technique. »
Des outils originaux pour limiter les risques
Cependant, cela n’est pas sans risque pour l’entreprise, car elle déploie beaucoup de moyens pour organiser toutes ces activités, telles que :
-
des cafés sport (travailler avec les utilisateurs à l’élaboration de nouveaux prototypes dans un cadre informel dans les campings ou lors des compétitions sportives),
-
des tables rondes en physique (discuter à bâtons rompus de manière horizontale avec les clients dans les locaux de la marque),
-
ou encore des tests sur le terrain ou à domicile (avec un envoi des produits à tester par la Poste au domicile des testeurs).
Par exemple, lors d’un test produit, une ingénieure essai terrain nous a confié ceci :
« Les risques, ce sont les conditions météo, la non-présence des testeurs, etc. Tu vois, par exemple, les annulations, moi je trouve ça moralement un peu déplacé, dans le sens où OK, on fait signer dans certains cas des contrats d’intérim, donc cela devrait être comme des mini contrats de travail. Mais les gens se disent : “Ah, c’est Decathlon, ah, ce n’est qu’un test produit, bon, bah ce n’est pas grave si je ne viens pas ou si je ne préviens qu’au dernier moment.” Tu vois ? Alors qu’on a déployé des moyens pour déplacer les équipes jusqu’à Strasbourg, par exemple, payer les nuits d’hôtel, les transporter, le matériel… »
Ces propos mettent en évidence plusieurs risques opérationnels et organisationnels liés à l’innovation ouverte ou à la cocréation de valeur. Plusieurs autres défis et risques ont été évoqués dans la littérature en sciences de gestion : les abus de la part des utilisateurs ; le fait que les utilisateurs transforment la plateforme d’innovation en un espace de contestation ou de règlement de compte ; ou encore le sentiment d’être exploité. Le tableau ci-dessous résume les principaux risques potentiels et réels liés à l’intégration des clients dans la conception des nouveaux produits chez Decathlon.
À côté de ces multiples défis et problèmes, l’entreprise a mis en place des stratégies d’animation qui permettent de « limiter les dégâts » :
![]()
Justin GOMIS ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Face aux risques d’une innovation ouverte non maîtrisée, les solutions mises en place par Decathlon – https://theconversation.com/face-aux-risques-dune-innovation-ouverte-non-maitrisee-les-solutions-mises-en-place-par-decathlon-251380