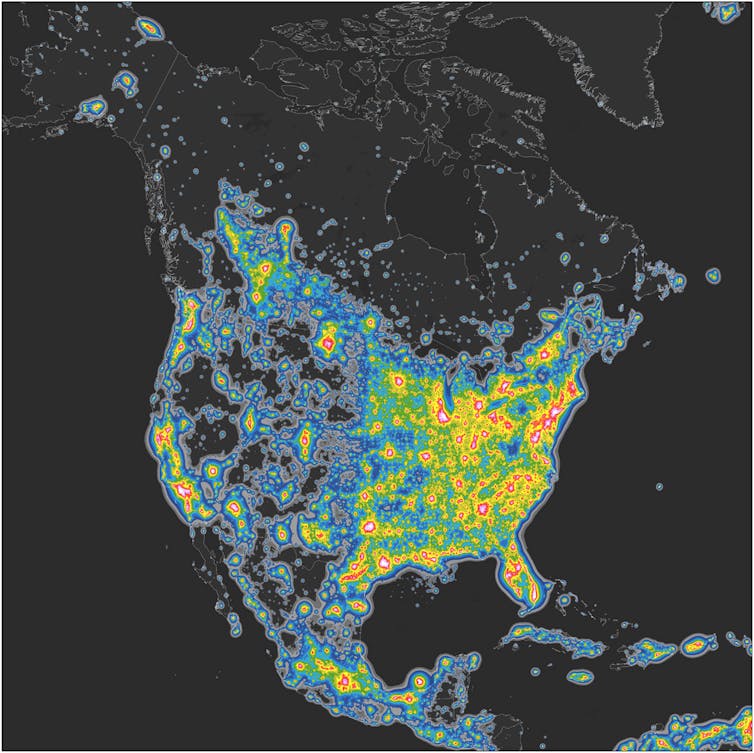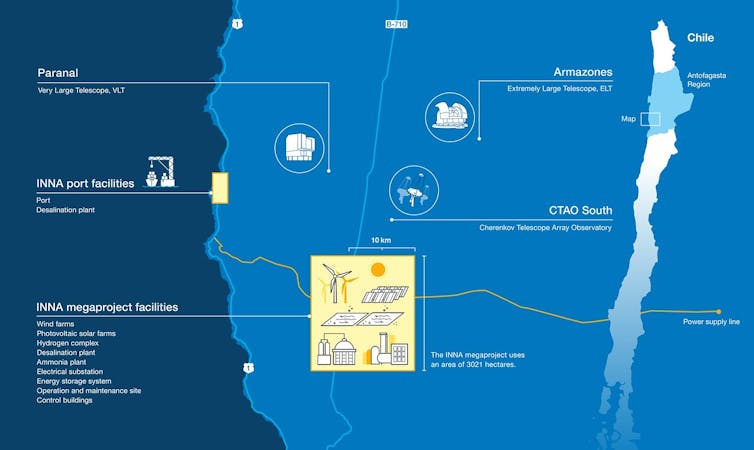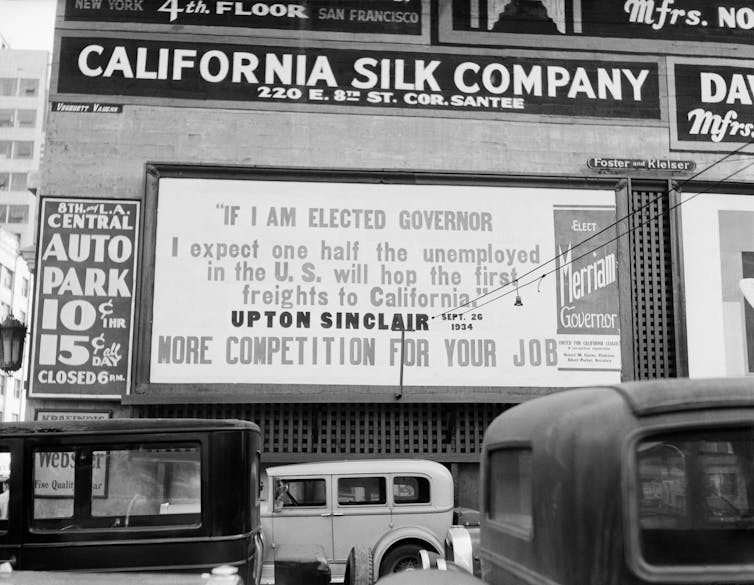Source: The Conversation – in French – By Mylon Ollila, PhD Student in Indigenous Economic Policy, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Le Canada est confronté à des difficultés économiques en raison des changements géopolitiques, dont une guerre commerciale avec les États-Unis, son plus proche partenaire économique.
Les décideurs politiques cherchent de nouvelles sources durables de développement économique, mais en négligent une qui existe déjà : l’économie autochtone émergente. Elle pourrait stimuler l’économie canadienne de plus de 60 milliards de dollars par an.
Toutefois, les peuples autochtones sont encore largement considérés comme un fardeau économique à gérer plutôt que comme une opportunité de croissance. Il est temps de changer les mentalités. Pour cela, le gouvernement fédéral doit supprimer les obstacles économiques injustes et investir dans la réduction des écarts d’emploi et de revenu.
Le futur du Canada dépend des Peuples autochtones
La croissance économique devrait ralentir au cours des prochaines années dans les pays développés, et le Canada aura le PIB le plus faible des 38 pays de l’OCDE d’ici 2060. Avec le ralentissement de la croissance, le niveau de vie baissera et les gouvernements seront confrontés à une pression budgétaire accrue.
Ce défi est aggravé par le vieillissement de la population active. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmente six fois plus vite que celui des enfants de 14 ans et moins, qui entreront sur le marché du travail dans les années à venir. Cette évolution démographique exerce une pression supplémentaire sur les retraites, le système de santé et l’économie.
Mais ces sombres prévisions négligent souvent l’un des avantages comparatifs du Canada : une population autochtone jeune, qui croît à un rythme supérieur à celui de la population non autochtone. Or, bien que les Peuples autochtones représentent 5 % de la population canadienne, ils ne contribuent qu’à hauteur de 2,4 % au PIB total.
Si les peuples autochtones pouvaient participer à l’économie au même rythme que les Canadiens non autochtones, leur contribution au PIB pourrait passer d’environ 55 milliards de dollars à bien plus de 100 milliards de dollars par an.
Malgré ce potentiel, le Canada a largement échoué à investir dans les peuples autochtones et à réformer les structures coloniales à l’origine des inégalités.
En dépit de certaines avancées comme la [Loi sur la gestion financière des Premières Nations] qui offre aux communautés des outils pour renforcer leurs économies, les progrès sont encore trop lents.
Les Premières Nations font face à des obstacles économiques
Toute économie comporte deux volets : les avantages économiques et les institutions qui permettent de tirer parti de ces avantages. Certaines institutions réduisent les coûts des activités commerciales et encouragent l’investissement, tandis que d’autres font le contraire. Les investissements se dirigent naturellement vers les endroits qui offrent à la fois des avantages économiques et des coûts d’exploitation faibles.
Au Canada, les droits de propriété bien établis réduisent les coûts d’exploitation des entreprises et favorisent leur financement. Un régime fiscal efficace assure la prévisibilité et permet aux gouvernements d’offrir des services. Les infrastructures adaptées aux besoins des entreprises réduisent les coûts logistiques. Toutes ces institutions contribuent au développement économique du Canada.
En revanche, les communautés des Premières Nations sont limitées par les institutions canadiennes. La Loi sur les Indiens limite l’autorité des Premières Nations sur leurs propres affaires, les excluant des mécanismes financiers traditionnels. Le flou juridique quant à la répartition des compétences entre les gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones et la faiblesse des droits de propriété découragent les investissements commerciaux.
En raison de leurs pouvoirs limités, notamment sur le plan financier, les gouvernements des Premières Nations ne peuvent offrir des services conformes aux normes nationales et doivent compter sur d’autres gouvernements.
Ces problèmes sont aggravés par la nature fragmentée, insuffisante et culturellement inadaptée des systèmes de soutien fédéraux. Les Premières Nations ont des avantages économiques et un esprit entrepreneurial, mais elles sont confrontées à des obstacles économiques injustes, tels que des infrastructures inadéquates, un accès limité au capital et des obstacles administratifs.
Il est essentiel d’investir dans les économies autochtones
En 1997, la Banque Royale du Canada prédisait que le fait de ne pas investir dans les peuples autochtones creuserait le fossé socio-économique. Comme prévu, c’est ce qui s’est produit.
Le Canada a toujours choisi de gérer la pauvreté plutôt que d’investir dans la croissance. Alors que l’aide financière aux peuples autochtones a plus que doublé au cours de la dernière décennie, cela n’a abouti qu’à une modeste amélioration du niveau de vie.
Le Projet Feuille de route, une initiative nationale menée par le Conseil de gestion financière des Premières Nations et d’autres organisations autochtones, propose une voie vers la réconciliation économique. Investir dans l’économie autochtone signifie soutenir la formation des Autochtones, donner accès au capital aux organisations autochtones et réformer les institutions qui continuent d’imposer des obstacles systémiques.
L’éducation est un des moyens les plus efficaces de réduire la pauvreté, d’améliorer la santé et de stimuler le développement économique. Le gouvernement fédéral devrait donc soutenir des programmes de formation conçus pour répondre aux besoins des Peuples autochtones.
L’apprentissage en ligne pourrait aider les communautés isolées à atteindre leurs objectifs éducatifs, mais son succès dépend de investissements importants dans l’accès à Internet haut débit, qui fait encore défaut dans de nombreuses régions.
Les organisations autochtones sont les mieux placées pour comprendre et répondre aux besoins locaux en matière de formation. C’est pourquoi le contrôle des transferts de revenus et la conception des programmes par les Autochtones doivent être au cœur de tout investissement futur dans l’éducation. Pour ce faire, le gouvernement fédéral devrait établir des partenariats avec les établissements d’enseignement autochtones afin de définir des objectifs et des valeurs en commun.
Financer et soutenir la croissance autochtone
Les peuples autochtones créent neuf fois plus d’entreprises que la moyenne canadienne, mais ne reçoivent que 0,2 % du crédit disponible. La plupart des entreprises autochtones sont de petite taille et ne peuvent croître sans options de financement viables.
Pourtant, les entrepreneurs et les gouvernements autochtones ont du mal à obtenir des prêts et du soutien financier.
À l’échelle internationale, les banques de développement ont été utilisées pour combler les lacunes en matière de crédit lorsque le secteur privé n’était pas en mesure de répondre aux besoins des économies émergentes.
Au Canada, le Conseil de gestion financière des Premières Nations et d’autres organisations autochtones réclament une solution similaire : la création d’une organisation financière de développement autochtone. En accordant des prêts aux gouvernements et aux entreprises autochtones, cette organisation financière pourrait combler le fossé entre les marchés financiers et l’économie autochtone.
Si les investissements dans le renforcement des capacités et le financement du développement sont des besoins urgents, seuls le démantèlement des barrières économiques et un meilleur accès à des institutions efficaces peuvent garantir le développement des peuples autochtones.
Des lois telles que la Loi sur la gestion financière des Premières Nations et la Loi sur l’accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations soutiennent les économies autochtones par le biais de la fiscalité, de la budgétisation, des codes fonciers et des lois financières. Elles offrent une voie entre la Loi sur les Indiens et l’autonomie gouvernementale, sans devoir attendre la fin de longues négociations.
Plus fort ensemble
L’avenir économique du Canada restera incertain si l’on continue de privilégier des solutions à court terme tout en ignorant le potentiel de croissance de l’économie autochtone. Il ne suffit plus d’améliorer le statu quo.
Le gouvernement fédéral doit soutenir les initiatives menées par les Autochtones, comme le Projet Feuille de route, afin de favoriser une croissance et une prospérité partagées par les peuples autochtones et tous les Canadiens. Des investissements sont nécessaires pour réduire les écarts en matière d’emploi et de revenus grâce à de nouvelles mesures de soutien aux capacités, à l’accès au capital et à la réforme institutionnelle.
![]()
Mylon Ollila travaille pour le Conseil de gestion financière des Premières Nations.
Hugo Asselin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. L’économie canadienne fait face à des défis majeurs, et les peuples autochtones offrent des solutions – https://theconversation.com/leconomie-canadienne-fait-face-a-des-defis-majeurs-et-les-peuples-autochtones-offrent-des-solutions-261710