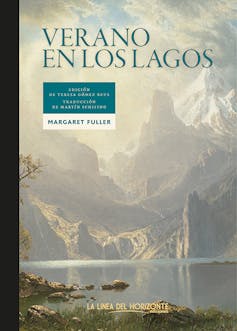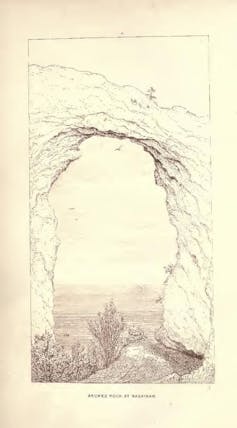Source: The Conversation – in French – By Elisabeth Bourgeois, Économiste, centrée sur les enjeux de climat, d’énergie et de vulnérabilités sociales, Université Savoie Mont Blanc
Pourquoi avons-nous tant de mal à nous adapter au changement climatique ? Quand l’asphalte chauffe, le thermomètre ne suffit pas à guider notre action : c’est notre manière de lire ses chiffres qui va décider de nos gestes. Perceptions, émotions et normes sociales forment un récit qui guide nos comportements – et qui façonne nos vulnérabilités face aux chaleurs extrêmes.
Il est 13 heures pile à l’école Joliot‑Curie dans une ville du Val‑de‑Marne. Un élève braque un thermomètre infrarouge sur la dalle : 52 °C. Trois pas plus loin, sous le paillis d’un jeune tilleul planté dans le cadre du programme européen OASIS – présenté comme étude de cas sur le portail Climate‑ADAPT de l’Agence européenne de l’environnement – le thermomètre tombe à 38 °C. Les enfants, médusés, rebaptisent la zone « four » et déplacent leur ballon vers l’ombre : en quelques secondes, la température devient un récit collectif qui reprogramme des gestes.
Pour réussir l’adaptation au changement climatique, à l’image de ces écoliers, nous devons voir les vagues de chaleur comme un récit partagé, avec des actions modulables. À cet égard, on dispose déjà d’une décennie de recherche internationale – et de l’expérience de quelques villes qui ont déjà mis ces travaux au service de la fraîcheur.
Les personnes en bonne santé plus susceptibles d’ignorer les risques de la chaleur
Au printemps 2025, nous avons publié une enquête, avec deux collègues économistes de l’énergie, dans la revue scientifique Climate Policy. Trois cents Français de plus de 55 ans, issus de 13 régions, étaient appelés à réagir à deux scénarios : l’un de cinq jours annoncés à 33 °C et, le deuxième, de cinq jours à 36 °C.
Ils devaient cocher, parmi une liste de cinq gestes protecteurs (boire plus d’eau, adapter sa tenue vestimentaire, prendre des mesures pour réguler au mieux la température de son logement, solliciter une aide extérieure et chercher un lieu frais), ceux qu’ils prévoyaient de réaliser.
Leurs réponses nous ont permis d’évaluer leurs croyances dans la probabilité d’une canicule et sa gravité pour leur santé, ainsi que la nature de leurs émotions face à ces scénarios.
De fait, les participants se disant « en pleine forme » passaient en moyenne de 3,6 gestes envisagés à 33 °C à 1,8 geste à 36 °C : près de deux fois moins. Ceux qui se déclaraient « un peu inquiets » suivaient le mouvement inverse : de 2,9 gestes à 4,4 (+ 52 %).
Certes, l’exercice reste déclaratif : il mesure l’intention et pas l’action. Mais des synthèses de psychologie sociale montrent qu’environ 40 % des comportements observés s’éclairent par les intentions déclarées. Dit autrement : quand l’intention augmente, le comportement suit souvent – pas toujours, mais suffisamment pour orienter à bon escient l’action publique.
Il suffit de trois degrés de plus pour que la vigilance change de camp et que la lecture de la situation change du tout au tout. Ces résultats prolongent ceux d’une méta‑analyse publiée dans Nature Climate Change. Notre perception du risque, notre sentiment d’efficacité et nos émotions expliquent près d’un tiers des conduites d’adaptation individuelles, davantage encore que l’âge ou la prise de médicaments comme des bêta-bloquants !
Le cerveau, pour le dire vite, règle le thermostat du corps. C’est notre « état intérieur » qui dicte pour beaucoup notre aptitude à nous adapter – et donc, notre vulnérabilité face aux chaleurs extrêmes.
Environnement, individu et comportement : un triptyque indissociable
Comme cela a été mis en évidence par une vaste revue de littérature publiée en 2019, les comportements face à la chaleur résultent toujours de la conjonction de trois types de facteur :
-
un facteur environnemental (géométrie urbaine, albédo – la capacité d’une surface à réfléchir la lumière –, circulation d’air…),
-
un facteur personnel (âge, santé, attentes, croyances…),
-
et, enfin, un facteur comportemental (type d’activité, normes sociales…).
Ces trois piliers sont indispensables pour prendre en compte la diversité des situations individuelles.

CC BY-NC-SA
Des indicateurs couramment utilisés pour évaluer le confort thermique, le Predicted Mean Vote (PMV) et le Physiologically Equivalent Temperature (PET) l’illustrent bien : le premier estime le « vote thermique moyen » d’un groupe assis dans un bureau climatisé et le second traduit l’état thermique équivalent pour un individu immobile.
Parfaits en intérieur, ces outils montrent leurs limites lorsqu’on les applique à un joggeur, à un ouvrier ou à des enfants dans une cour d’école. Autant dire que prédire la sensation d’un joggeur marseillais avec un modèle mis au point dans une chambre climatique danoise équivaudrait à calibrer un sous‑marin avec un altimètre.
À lire aussi :
Végétaliser les cours de récréation pour encourager la curiosité des enfants
Pourquoi et comment s’adapter au changement climatique
Les chiffres sont têtus et l’impact des vagues de chaleur difficile à ignorer. Par exemple :
-
dans les écoles états-uniennes, chaque journée au‑delà de 32 °C à l’intérieur fait perdre environ 1 % du programme scolaire annuel, ce qui se répercute sur les résultats en lecture et en mathématique.
-
En Californie, des études ont montré que la productivité horaire recule d’environ 5 % quand la température maximale dépasse 30 °C, puis de plus de 11 % au‑delà de 38 °C.
-
Inversement, la présence d’un parc en ville va abaisser la température de l’air ambiant d’environ 1 °C en moyenne – davantage encore la nuit si la canopée est dense.
-
À Phoenix (Arizona), une étude a fait état d’un écart nocturne de 3 à 5 °C entre quartiers aisés et défavorisés.
L’adaptation n’a donc de sens que si l’on agit, en même temps, sur la façon dont les habitants lisent, ressentent et anticipent les degrés supplémentaires. Un espace vert ou un refuge climatisé ne suffisent pas : encore faut‑il que chacun sache où ils sont, quand ils ouvrent, ce qu’on y trouve et qu’on s’y sente légitime. C’est le rôle des récits collectifs.
Le retour d’expérience des villes pionnières montre que c’est possible :

Barcelona for Climate
-
À Barcelone (Espagne), plus de 400 refugis climàtics (parcs ombragés, bibliothèques, musées, centres civiques) ont été déployés pour être accessibles à moins de dix minutes à pied pour plus de 90 % de la population.
-
À Valence (Espagne également), un réseau s’active lors des alertes, avec messages indiquant le lieu le plus proche et les services disponibles (eau, horaires) – une page officielle recense 18 refuges avec adresses et horaires.
-
Malmö (Suède), de son côté, a inscrit l’augmentation des espaces verts et la prise en compte des vulnérabilités dans sa stratégie d’adaptation.
Mais les infrastructures ne suffisent pas. Elles rendent possible le geste (se déplacer, s’abriter, ralentir…), mais c’est d’abord le message ciblé qui fournira la clé cognitive pour le faire (« Je suis concerné », « Je sais quoi faire », « Je peux effectivement le faire »).
Adaptation et action publique : comment débusquer le biais d’invulnérabilité
Il est donc essentiel de tenir compte des éléments de psychologie et des biais de perception, mentionnés plus haut, pour améliorer l’adaptation climatique, et, en particulier, l’action publique dans ce domaine.
Réécrire les alertes est la première évidence. Ainsi, des messages d’ordre général comme « Buvez de l’eau » glisseront sur les profils les plus optimistes. Au contraire, un SMS nominatif rappelant, par exemple, qu’un traitement diurétique triple le risque de déshydratation va augmenter significativement l’adoption de gestes de protection et réduire le risque de stress thermique chez les personnes âgées.
En Finlande, par exemple, le service météorologique publie des avertissements relatifs aux températures et l’institut finnois pour la santé et le bien-être (THL) publie des guides spécifiques pour les crèches et écoles. La Ville d’Helsinki a d’ailleurs évalué l’adaptation au climat de ses écoles et de ses garderies.
Reste le cas des « invincibles volontaires » – ceux qui ont décidé qu’ils supporteront la chaleur. Là, l’outil le plus efficace n’est pas le gobelet d’eau mais l’autodiagnostic.
Un quiz de deux minutes, intégré à une appli de running par exemple, pourrait faire virer l’écran au rouge dès que l’humidex – indice combinant température et humidité – tutoie le seuil de danger. La liberté d’aller courir demeure, mais le sportif ne peut plus ignorer les risques.
Planter des arbres, enfin, est utile en ville pour limiter l’effet îlot de chaleur urbain (ICU), mais doit être fait avec discernement. Selon la Commission européenne, couvrir 30 % de la surface urbaine par le feuillage des arbres (canopée) permettrait d’éviter plus de 2 500 décès prématurés en Europe chaque été. Mais si un tilleul avenue Montaigne (Paris) va simplement flatter Instagram, le même tilleul à Clichy‑sous‑Bois (Seine-Saint-Denis) devient un acte de santé publique.
Ces enseignements ne suffiront probablement pas à dompter l’été 2050. Ils rappellent cependant que la chaleur meurtrière n’est pas qu’une donnée météorologique, mais avant tout un récit à réécrire sans cesse – avec des SMS, des cours, des QR codes sur les abribus et des arbres là où ils comptent.
Retour à Joliot‑Curie. Les élèves ont rangé le thermomètre et filent sous l’ombre maigre mais tangible du jeune tilleul. Le thermomètre ment rarement, mais nos certitudes, elles, peuvent tuer. Les tempérer – par un message bien tourné, un tilleul bien placé, un voisin bien informé – est tout aussi important que de faire tomber la température.
![]()
Elisabeth Bourgeois a reçu des financements de l’ANR (ANR‑18‑EURE‑0016 – Solar Academy) et de la Public Trust in Health Chair (Grenoble École de Management). Aucun autre intérêt déclaré.
– ref. Lors des canicules, notre cerveau ne s’aligne pas toujours avec le thermomètre et peut nous mettre en danger – https://theconversation.com/lors-des-canicules-notre-cerveau-ne-saligne-pas-toujours-avec-le-thermometre-et-peut-nous-mettre-en-danger-261012