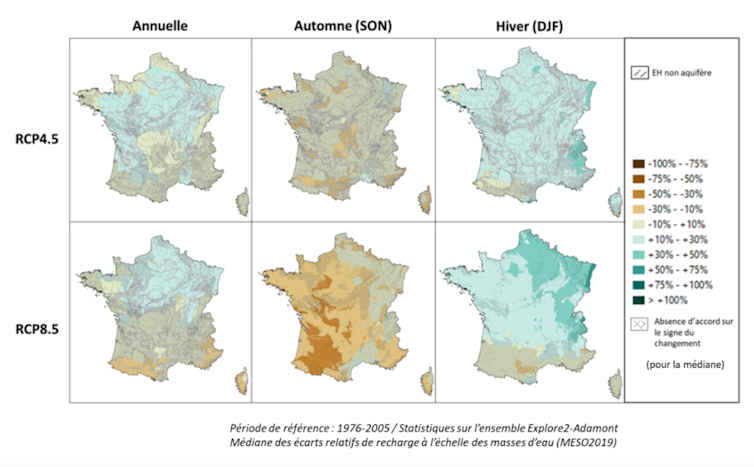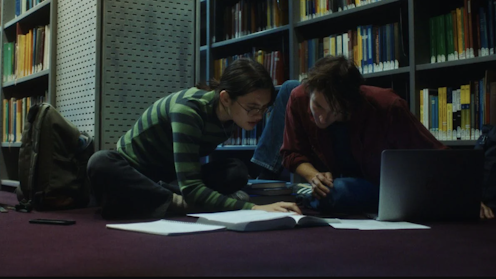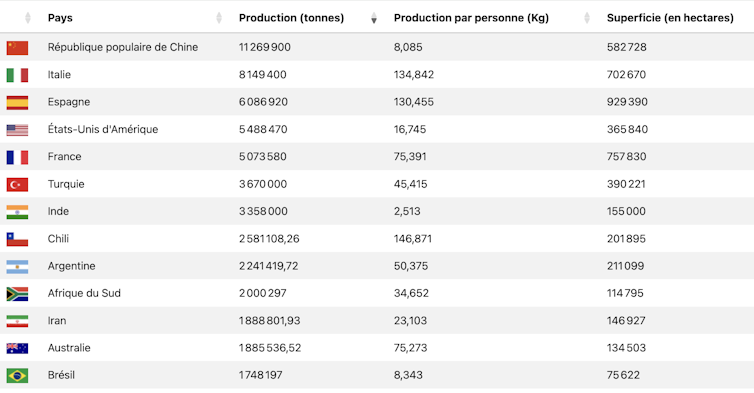Source: The Conversation – Indonesia – By Sébastien Ibanez, Maître de conférences en biologie, Université Savoie Mont Blanc (USMB), Université Savoie Mont Blanc

Comment la recherche et les scientifiques peuvent-ils intervenir dans le débat public, surtout lorsqu’il s’agit de questionner des choix de société ? Dans les mouvements écologistes, cet engagement peut prendre plusieurs formes, entre expert en retrait et militant engagé. L’exemple du projet d’extension du téléphérique de La Grave (Hautes-Alpes), au pied du massif de la Meije, illustre bien cette difficulté. Ce chantier menace notamment une plante protégée, ce qui a contribué à l’installation de la plus haute ZAD d’Europe.
Construit en 1976 et 1977, le téléphérique relie le village de La Grave (Hautes-Alpes) à 1 400 mètres et le glacier de la Girose à 3 200 mètres. Lors de la reprise de la gestion du téléphérique par la Société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez (Sata) en 2017, il est prévu d’étendre le téléphérique par un troisième tronçon atteignant le Dôme de la Lauze à plus de 3 500 mètres, pour remplacer l’usage d’un téléski désormais obsolète. Cela déclenche une controverse à différentes échelles, locale et nationale, portant sur la pertinence économique, sociale et environnementale du projet.

Michel Boutin, Fourni par l’auteur
Étant écologue, je vais concentrer l’analyse sur les manières dont ma discipline peut participer à la controverse.
La haute montagne est pleine de vie : la neige recouvrant les glaciers et les plantes poussant dans les fissures hébergent des écosystèmes riches en espèces souvent méconnues. Par exemple, trois nouvelles espèces d’androsaces, de petites fleurs de haute montagne, ont été découvertes en 2021 grâce à l’analyse de leur ADN.
Une espèce de fleur endémique du massif découverte en 2021
On sait depuis Horace Bénédict de Saussure, naturaliste du XVIIIe siècle, que ces plantes existent, mais elles étaient alors confondues avec d’autres auxquelles elles ressemblent. L’une d’elles, l’androsace du Dauphiné, est endémique du massif des Écrins et d’autres massifs avoisinants. On la prenait auparavant pour l’une de ses cousines, l’androsace pubescente, qui bénéficie d’une protection nationale depuis 1982.
Il est encore trop tôt pour que le statut de protection de l’androsace du Dauphiné soit défini par la loi. En toute logique, elle devrait hériter de la protection nationale dont bénéficie l’androsace pubescente, puisque son aire de répartition est encore plus réduite. Elle occupe notamment un petit rognon rocheux émergeant du glacier de la Girose, sur lequel l’un des piliers du téléphérique doit être implanté.
À cet endroit, l’androsace du Dauphiné n’a pas été détectée par le bureau chargé de l’étude d’impact, mais elle a été repérée, en 2022, par un guide de haute montagne local. Comme cela n’a pas convaincu le commissaire chargé de l’enquête publique, une équipe de chercheurs accompagnée par une agente assermentée de l’Office français de la biodiversité (OFB) a confirmé les premières observations, en 2023.

Sébastien Lavergne/CNRS, Fourni par l’auteur
De nombreuses autres espèces d’androsaces poussent à plus faible altitude et possèdent une rosette de feuilles surmontée d’une tige dressée portant des fleurs. Celles de haute montagne, comme l’androsace du Dauphiné, ont un port compact rappelant un coussin. Les petites fleurs blanches à gorge jaune dépassent à peine des feuilles duveteuses. Dans cet environnement très difficile, leur croissance est très lente. Les plantes formant des coussins peuvent avoir plusieurs dizaines d’années, voire bien plus. Bien que très discrètes, elles forment les forêts des glaciers.
Peu de protections accordées pendant le chantier
Les travaux prévus présentent-ils un risque pour l’androsace ?
Le préfet des Hautes-Alpes a jugé que ce n’était pas le cas, en refusant d’enjoindre à la Sata de déposer une demande de dérogation en vue de la destruction d’une espèce protégée, comme cela est prévu par l’article L411-2 du Code de l’environnement. Il considère donc qu’installer quelques dispositifs de protection autour des individus existants serait assez. En réalité, rien ne garantit que cela suffise, car plusieurs de ces plantes poussent à moins de 15 mètres en contrebas de l’emplacement du pylône, comme l’indique le rapport d’expertise, dans des fissures rocheuses dont l’alimentation en eau risque d’être irrémédiablement perturbée.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Surtout, les travaux de terrassement peuvent anéantir des graines prêtes à germer ou de minuscules jeunes pousses très difficiles à détecter au milieu des rochers. La viabilité écologique d’une population ne dépend pas que de la survie des individus les plus âgés, mais aussi du taux de survie des plus jeunes. Cependant, il n’existe à l’échelle mondiale que très peu de connaissances sur la dynamique des populations et la reproduction des plantes formant des coussins.

Angela Bolis, Fourni par l’auteur
On peut donc difficilement quantifier la probabilité que la population d’androsaces présente sur le rognon de la Girose s’éteigne à cause des travaux. On peut malgré tout affirmer que la survie de la population sera très probablement menacée par les travaux, même si cette conclusion n’a pas le même degré de certitude que l’observation de la présence de l’espèce.
Quelle posture pour le scientifique ?
Comment se positionner sur cette question en tant que scientifique ?
Une première solution serait de céder à la double injonction de neutralité (ne pas exprimer ses opinions) et d’objectivité (se baser uniquement sur des faits), pour se limiter au signalement de la présence de l’espèce. Mais cette négation aveugle de l’engagement laisse aux autorités, qui ne sont bien sûr ni neutres ni objectives, le soin de décider comment protéger l’androsace. La neutralité devient ainsi une illusion qui favorise l’action des forces dominantes.
Une deuxième option diamétralement opposée serait d’utiliser la qualité de scientifique pour asseoir son autorité : l’androsace étant protégée et menacée par les travaux, il faut abandonner le projet, point. Cet argument technocratique paraît surprenant dans ce contexte, mais c’est une pratique courante dans la sphère économique lorsque des experts présentent des choix de société comme inévitables, avec pour grave conséquence d’évacuer le débat politique. Dans le cas de la Girose, les enjeux environnementaux s’entremêlent avec les choix portant sur le modèle de développement touristique. La controverse ne peut être résolue qu’au moyen d’une réflexion associant tous les acteurs.
Une troisième voie consisterait à distinguer deux modes d’intervention, l’un en tant que scientifique et l’autre en tant que militant, de manière à « maximiser l’objectivité et minimiser la neutralité ». Dix-huit scientifiques formant le collectif Rimaye, dont je fais partie, ont publié en 2024 un ouvrage intitulé Glacier de la Girose, versant sensible, qui mêle les savoirs et les émotions liées à ce territoire de montagne. Les contributions de sciences humaines interrogent les trajectoires passées et à venir pour le territoire, tandis que les sciences de la Terre et de la vie invitent le lecteur autant à découvrir qu’à aimer les roches, les glaces et les êtres qui peuplent la haute montagne.
Une science amorale et apolitique ?
Partant du constat que la seule description scientifique ne suffit pas, plusieurs contributions revendiquent une approche sensible. La recherche permet aussi d’aimer les plantes en coussins et les minuscules écosystèmes qu’elles hébergent. Les sciences de la nature n’ont pas nécessairement une application technique immédiate au service d’un projet de domination. Elles peuvent encourager la protection de l’environnement par le biais de l’attachement aux objets de connaissance et se révéler porteuses, comme les sciences humaines, d’un projet émancipateur où tous les êtres vivants, et même les êtres non vivants comme les glaciers, seraient libres de toute destruction et d’exploitation.
Cependant, cette troisième voie suppose qu’il est possible d’isoler la démarche scientifique de valeurs morales ou politiques. Certes, les valeurs peuvent influencer les scientifiques avant le processus de recherche (lors du choix de l’androsace comme objet d’étude), pendant (en évitant d’abîmer les plantes étudiées) et après (en déterminant le message accompagnant la diffusion des résultats). Malgré tout, selon cette approche, le processus de la recherche reste généralement imperméable aux valeurs.
Cet idéal est aujourd’hui largement contesté en philosophie des sciences, ce qui ouvre le champ à une quatrième voie venant compléter la précédente. Concentrons-nous ici sur un seul argument : tirer une conclusion scientifique nécessite de faire un choix qui, en l’absence de certitude absolue, devient sensible aux valeurs.
Choisir à quelle erreur s’exposer
Dans le cas de l’androsace, il faut décider si l’implantation du pylône met ou pas la population en danger.
On peut distinguer deux manières de se tromper : soit on détecte un danger inexistant, soit on ne parvient pas à discerner un véritable danger. La porte d’entrée des valeurs devient apparente. Du point de vue de la Sata, il faudrait éviter la première erreur, tandis que pour les amoureux de l’androsace, c’est la seconde qui pose problème. Idéalement, on aimerait minimiser les taux de ces deux erreurs, mais un résultat bientôt centenaire en statistiques nous apprend que l’un augmente lorsque l’autre diminue. Un certain risque d’erreur peut ainsi paraître plus ou moins acceptable en fonction de nos valeurs.
Si objectivité et neutralité sont illusoires, il serait préférable de rendre apparente l’intrication entre valeurs et recherche scientifique afin de distinguer les influences illégitimes, comme la promotion d’intérêts personnels ou marchands, de celles orientées vers la protection de biens communs. D’autant plus que les enjeux autour du téléphérique dépassent largement le sort de l’androsace, mais concernent aussi la vie économique de la vallée.

Michel Boutin, Fourni par l’auteur
Pour trancher la question de l’aménagement de la haute montagne, il devrait exister un espace de discussion regroupant habitantes et habitants des vallées, pratiquants de la montagne et scientifiques. Des initiatives ont été prises dans ce sens, que ce soit à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), à Grenoble (Isère), au jardin alpin du Lautaret (Hautes-Alpes) ou à La Grave.
Pour que ces rencontres soient suivies d’effet, il faut qu’elles puissent nourrir les mobilisations, comme tente de le faire le collectif Les Naturalistes des terres, ou qu’elles se traduisent dans les politiques publiques. Cependant, la récente proposition de loi Duplomb sur l’agriculture illustre que les alertes des scientifiques sont souvent ignorées.
En attendant, les travaux du téléphérique pourraient reprendre cette année à la Girose, sans que la question de la protection des glaciers et des écosystèmes qui les entourent ait trouvé de réponse.
![]()
Sébastien Ibanez a reçu des financements de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG).
– ref. À La Grave dans les Alpes, une fleur face aux pelleteuses : la science entre neutralité et engagement – https://theconversation.com/a-la-grave-dans-les-alpes-une-fleur-face-aux-pelleteuses-la-science-entre-neutralite-et-engagement-257599