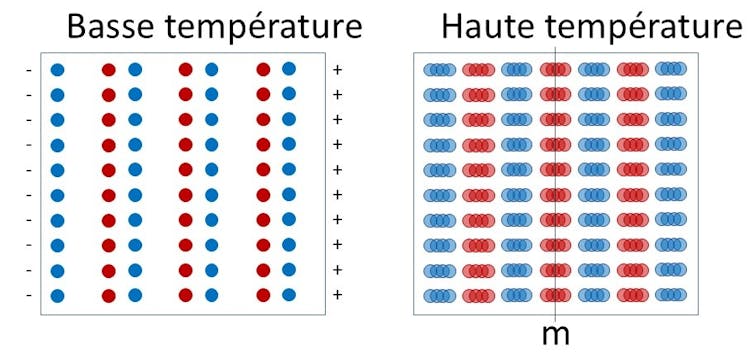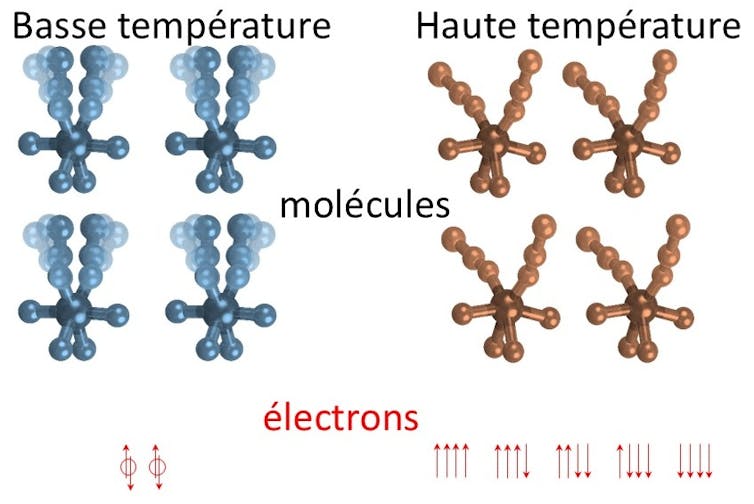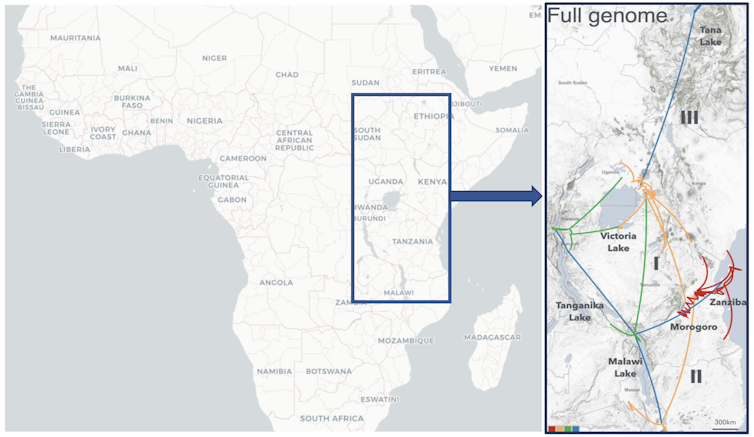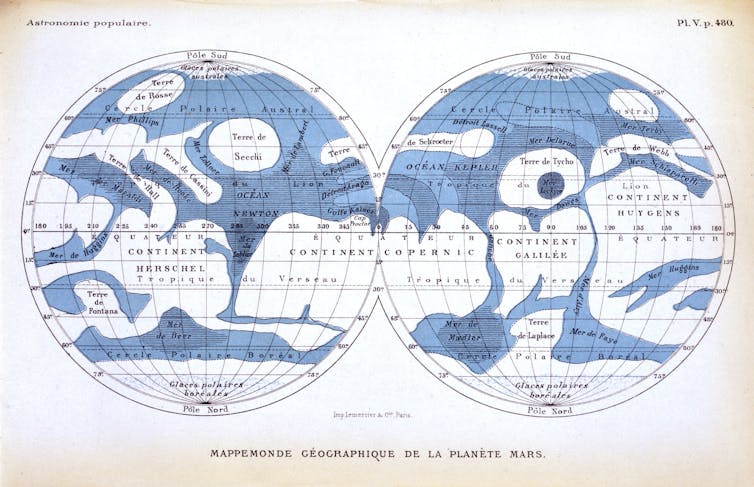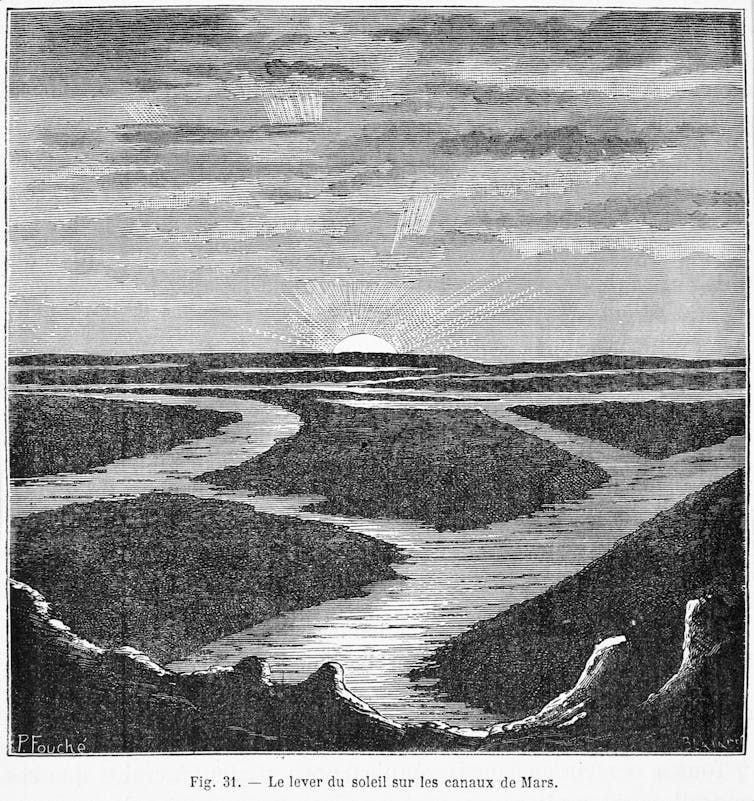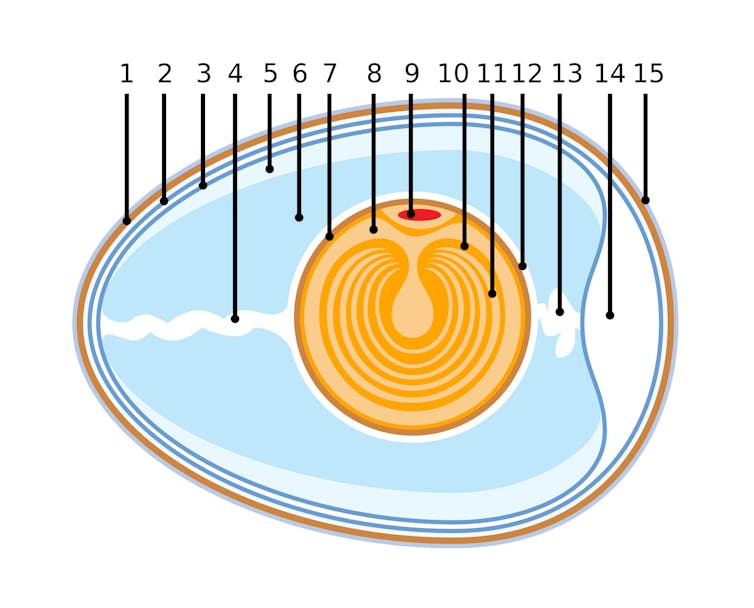Source: – By Fanny Parise, Chercheur associé, anthropologie, Institut lémanique de théologie pratique, Université de Lausanne

Paris, capitale française et sixième ville d’Europe où les loyers sont les plus chers, vient de battre un nouveau record : le prix moyen du mètre carré dépasse désormais les 9 000 euros !
Mais Paris est également le théâtre d’un jeu social méconnu qui permet d’objectiver l’incidence du lieu de vie sur la sociabilité et le style de vie d’individus sous contrainte de budget. D’un point de vue socio-anthropologique, ces individus déploient des stratégies sociales afin de rendre plus acceptable leur quotidien : ils mettent en place des pratiques visant non pas à sortir de la précarité, mais à ne pas tomber dans la misère, à rendre acceptables les frustrations qu’engendre la situation socio-économique vis-à-vis de la société de consommation. Ils montrent aussi une volonté de monétariser tout ou partie de l’activité, ou des projets déployés au quotidien.
Assurer sa solvabilité
La solvabilité d’un locataire se traduit par sa sa capacité à honorer le loyer de son logement. Elle se calcule par l’intermédiaire d’un indice : le ratio de solvabilité, correspondant au taux d’effort des locataires. Ce chiffre indique le reste à vivre (RAV) mensuel après paiement du loyer. Il ne doit pas excéder 33,3 % du total des ressources de l’individu. Le RAV varie logiquement en fonction du salaire, du montant du loyer, des dépenses contraintes et secondaires d’un individu. Il est également corrélé à un ensemble de variables socioculturelles où le style de vie et les modes de consommation impactent directement sa gestion. Si un individu estime que son RAV est insuffisant pour le niveau de vie auquel il aspire, opter pour un loyer moins élevé, sur un territoire où l’immobilier est plus abordable, peut sembler être une solution pertinente.
Or, l’« adresse postale » d’un logement représente l’épicentre de stratégies de distinctions sociales, qui confère une dimension symbolique au ratio de solvabilité. D’autres notions conduisent les individus à repenser leur budget afin de s’assurer leur solvabilité face à des « adresses postales » où le prix moyen des loyers est supérieur à leur ratio de solvabilité. Il s’agit notamment des politiques liées aux logements sociaux ou du « capital d’autochtonie », c’est-à-dire l’ensemble des ressources (réelles et symboliques) engendrées par l’appartenance à des réseaux et à des relations de proximité. On attribue un caractère réversible à ce capital : alors que l’entre-soi constitue une force à l’échelle individuelle comme à celle d’un groupe social, il peut se retourner en handicap à l’extérieur de ce réseau. D’un point de vue anthropologique, les individus usent de stratégies afin de conserver ces réseaux de proximité.
Classiquement, la sociologie et la géographie objectivent les disparités de revenus des ménages en fonction des différents quartiers de la ville, mettant en tension l’Est et l’Ouest de la capitale. Or, il semble exister une réalité plus complexe du quotidien, notamment pour une partie de ses habitants qui a, malgré de faibles ressources, décidé de vivre dans les quartiers ou les villes de l’Ouest parisien.
Entre « classe ambitieuse » et « classe aspirante »
La sociologue américaine Elizabeth Currid a publié en 2017 The Sum of Small Things à propos de la « classe ambitieuse », où ces créatifs culturels décident non pas de s’émanciper de la société de consommation, mais de se positionner en transition consumériste. Ils aspirent ainsi à changer le monde tout en participant, souvent malgré eux, à une reproduction des distinctions sociales.
Très visibles dans les grandes villes, ces individus investissent Paris et participent au processus de gentrification amorcé dans les quartiers de l’Est parisien. Cependant, il existerait une autre facette de cette « classe ambitieuse » : la « classe aspirante », qui serait sa part d’ombre. Elle investirait les quartiers historiquement les plus huppés de Paris (Triangle d’Or, par exemple) et déploierait un certain nombre de stratégies faisant office d’amortisseurs de la pauvreté, comme la sociologue Martine Abrous l’a étudié au sujet des professions artistiques.
Ces stratégies renvoient vers une pluralité de desseins : conserver une position sociale, acquérir un logement selon ses ressources (stratégies de gentrification), capitaliser sur les aménités de quartier afin de mieux vivre, ou encore, choisir par défaut (attribution de logements sociaux, hébergement chez des proches).
Stratégies pour choisir son lieu de vie
A priori, il existerait une corrélation entre prix du bâti et ressources des ménages. Or, le croisement de certains indicateurs statistiques montre une autre réalité : on observe un lien entre prix du bâti et nombre de chambres de bonnes ou de « service » à la location (le XVIe arrondissement de Paris concentre près d’un tiers du parc de chambres de bonnes de la capitale), ou encore, entre prix du bâti et diversité des types de logements sociaux, comme en atteste la répartition des logements sociaux par arrondissement :
Cette « classe aspirante » a recours à un certain nombre de stratégies afin de préserver son « ratio de solvabilité » : travail au noir, économie informelle, cumul d’emplois, mobilisation de réseaux d’entraide et de solidarité… Elle invoque différentes justifications à ce choix de vie parfois difficile : vivre dans un quartier privilégié, continuer de résider dans le quartier ou la ville dans laquelle on a grandi, assurer une bonne scolarité à ses enfants, s’intégrer dans des réseaux de sociabilité des classes supérieures, etc.
La mixité sociale peut desservir
Cette forme de mixité sociale peut également engendrer de la non-mixité due aux « effets de quartier » et provoquer des tensions à l’échelle des territoires. Le couple de sociologues Pinçon l’avait évoqué, relatant le cas d’une résidence HLM en bas des Champs-Élysées : la volonté initiale de « mixer » différentes populations s’est retrouvée être contre-intuitive pour les habitants. Il s’agit du phénomène de la « double peine ».
Les habitants ont perdu les bénéfices de leur « capital d’autochtonie » et ne sont pas parvenus à s’intégrer sur ce nouveau territoire, provoquant de l’exclusion et une diminution de la qualité de vie. Cet exemple s’intègre dans un jeu social de différenciation entre les habitants de ces quartiers, provoquant des confusions et des sentiments d’injustice, notamment liés aux liens entre ressources et types de logements sociaux.
En définitive, c’est précisément le poids symbolique et culturel qui va conditionner les stratégies individuelles et collectives des individus dans les pratiques de gestion du « ratio de solvabilité », donnant à voir une réalité plus contrastée de la pauvreté par rapport au lieu de vie.
Les datavisualisations de cet article ont été réalisées par Diane Frances.
![]()
Fanny Parise a reçu des financements de différentes structures, qui ont participé au financement de son travail de thèse.
– ref. Pourquoi vouloir vivre dans les quartiers riches quand on est pauvre ? – https://theconversation.com/pourquoi-vouloir-vivre-dans-les-quartiers-riches-quand-on-est-pauvre-94355