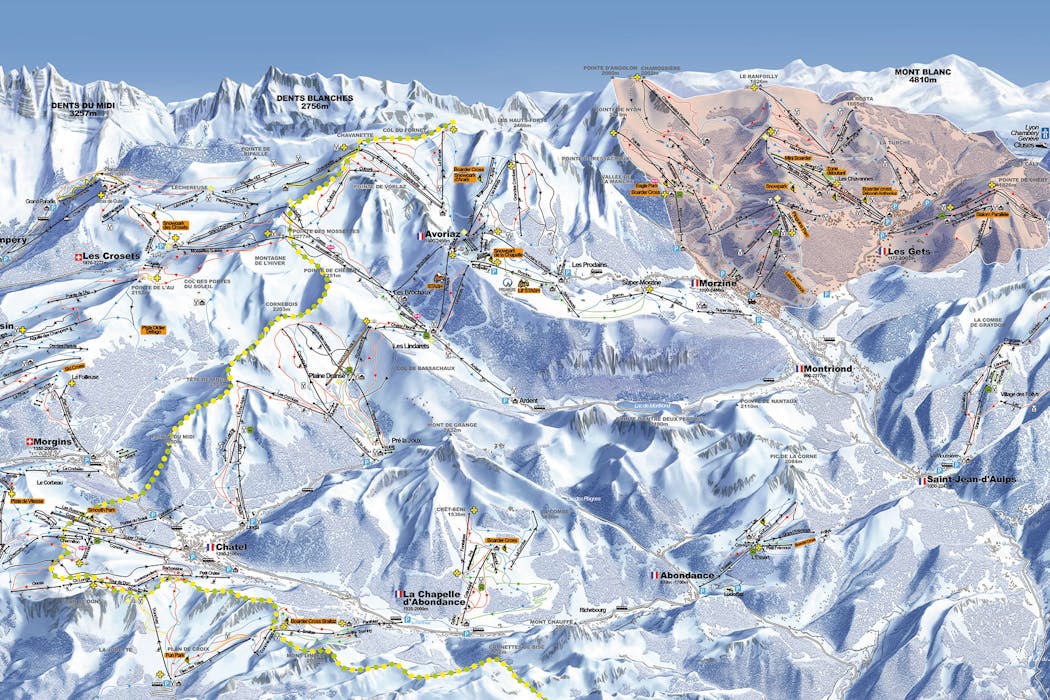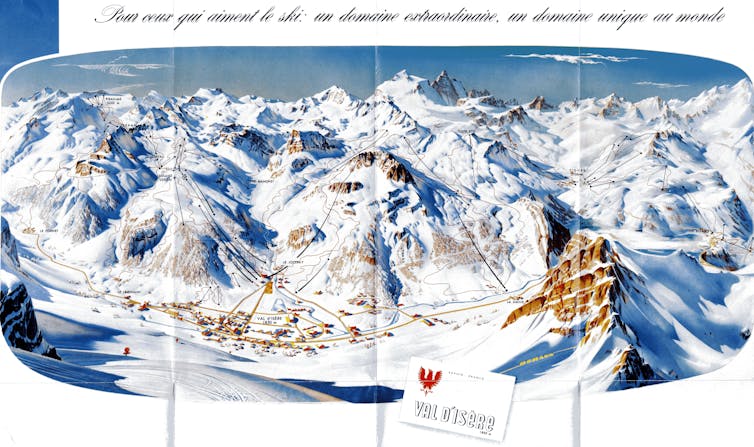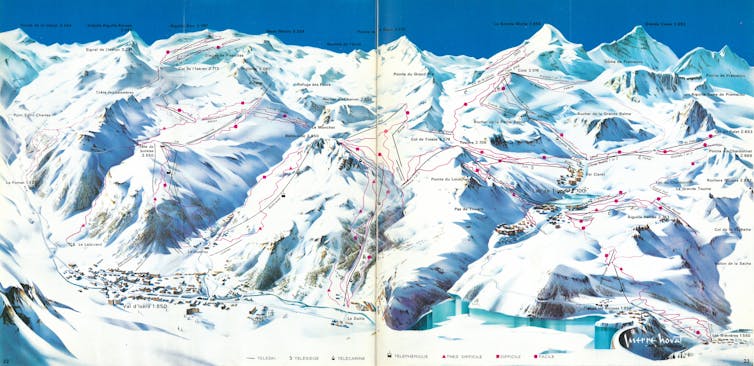Source: The Conversation – in French – By Jérôme Baray, Professeur des universités en sciences de gestion, Le Mans Université

Une grande partie des activités économiques dépendent de financements publics en France. La frontière entre public et privé s’efface. 25 et 30 millions de personnes ont un revenu qui dépend directement de l’État. Alors, les Français et Françaises seraient-ils tous fonctionnaires ?
On continue volontiers d’opposer les fonctionnaires, censés vivre de l’impôt, et les salariés du privé, qui relèveraient de l’économie réelle.
Pourtant, si l’on parle non plus des statuts, mais des flux d’argent public, le paysage change nettement. Une proportion importante des revenus considérés comme privés dépend en réalité de décisions publiques : remboursements d’assurance maladie, aides agricoles, marchés publics, subventions culturelles, crédits d’impôt, garanties accordées au secteur financier, contrats financés par l’État ou par les collectivités.
Selon définition classique retenue par les administrations, 30,9 millions d’actifs travaillent pour le privé.
La fonction publique, au sens strict, rassemble environ 5,8 millions d’agents en 2023, soit près d’un emploi sur cinq. Si l’on ajoute les salariés du monde associatif, les professions libérales de santé, certains salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP), les agriculteurs financés par la Politique agricole commune (PAC), les secteurs régulés comme l’énergie ou encore les services financiers adossés à la dette publique, on arrive rapidement à plusieurs dizaines de millions de personnes dont les revenus dépendent, directement ou plus indirectement, de financements publics.
L’objectif ici n’est pas d’être exhaustif. Presque tous les secteurs, à des degrés divers, s’appuient sur des mécanismes publics. Mais certains offrent des exemples particulièrement documentés. Cet article se concentre sur quelques cas emblématiques.
Secteurs dépendants de l’État
Il est utile de visualiser l’ensemble du paysage économique français à travers un tableau synthétique. Celui-ci montre comment se répartissent, secteur par secteur, les personnes vivant (directement ou indirectement) de fonds publics – et celles dont l’activité relève réellement d’un marché privé pur.
Nous avons utilisé les données de l’Insee – Fonction publique et emploi, l’Insee – Population active, l’INJEP – Emploi associatif, du ministère de la Culture – Chiffres clés culture, de la direction de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES) – Chômage indemnisé, de France Travail, du ministère de l’Économie – Commande publique, MSA, du ministère de l’Agriculture et de la PAC, de la Fédération bancaire française, de France Assureurs, de l’UNÉDIC – Assurance chômage, de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) – Retraites et France Digitale.
Le tableau ci-dessus n’inclut pas les 6 à 7 millions d’adultes inactifs non répertoriés dans ces catégories (personnes vivant du revenu du ménage, du patrimoine, ou en inactivité hors dispositifs sociaux). Cela explique l’écart avec la population adulte totale.
L’État structure le marché privé
L’idée d’un secteur autonome, évoluant hors de l’État, ne résiste pas longtemps à l’analyse. Dans de nombreux métiers, les revenus dépendent de tarifs publics, de mécanismes de remboursement, de subventions, de régulations ou encore de commandes publiques.
Plusieurs travaux d’économie publique de Mariana Mazzucato, de Michel Aglietta ou encore de Pierre-Noël Giraud ont montré combien les États structurent les marchés, souvent davantage qu’on ne le reconnaît dans le débat public.
Cette question de l’imbrication entre décisions publiques et activités privées traverse également mes propres travaux sur la figure de l’entrepreneur, qu’il s’agisse d’analyser comment les politiques publiques structurent les comportements de marché ou d’examiner l’effet des cadres réglementaires sur l’allocation des ressources.
L’État, premier client du pays
Une façon d’être dépendant de l’État, c’est tout simplement la commande publique. Autrement dit, tous les contrats payés par l’État, les mairies, les départements, les hôpitaux, les boîtes publiques comme la SNCF ou la RATP, et même par l’Union européenne.
Selon les données officielles du ministère de l’Économie, ces marchés pèsent presque 8 % du PIB. Ce poids est significatif à l’échelle de l’économie nationale. Concrètement, les marchés publics pèsent 80 milliards d’euros par an, les concessions, comme celle des autoroutes, représentent 120 milliards d’euros par an.
Historiquement, cette dépendance s’explique par le rôle central de l’État, depuis les années 1960, dans le financement et la planification des grands équipements collectifs comme les autoroutes, les chemins de fer, les hôpitaux ou les infrastructures énergétiques.
Ces projets nécessitent des investissements lourds et peu compatibles avec un financement purement privé. Dans les travaux publics, la dépendance à la commande publique est bien documentée. Selon la Fédération nationale des Travaux publics, les maîtres d’ouvrage privés ne représentent qu’un peu plus de 14 milliards d’euros, soit environ un tiers du chiffre d’affaires du secteur. Le reste provenant principalement de clients publics.
Les professionnels de santé, prestataires de service public
Plusieurs professions libérales exercent dans des cadres où l’État intervient fortement : tarifs, remboursements, implantation… Le cœur de leur activité est façonné par des décisions publiques. Ces professionnels sont prestataires d’un service public puisqu’ils fournissent une mission reconnue comme d’intérêt général, financée et régulée par l’État.
C’est particulièrement visible dans le domaine de la santé. Les médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pharmaciens, tirent l’essentiel de leurs revenus de l’assurance maladie obligatoire. Les tarifs sont fixés ou négociés au niveau national et les revalorisations dépendent de décisions gouvernementales.
Certaines rémunérations supplémentaires sont liées à des objectifs de santé publique. Par exemple, le dispositif Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) valorise la prévention, le suivi des pathologies chroniques ou la vaccination.
La justice, une mission de service public
Les acteurs de justice, comme les notaires, les huissiers, les avocats ou les greffiers, travaillent eux aussi dans un cadre largement défini par la puissance publique.
Les tarifs qu’ils appliquent sont fixés par arrêté ministériel. Par exemple, l’acte authentique des notaires leur donne un monopole prévu par la loi. L’installation n’est pas totalement libre non plus. L’État encadre l’ouverture des offices, après l’avis de l’Autorité de la concurrence, ce qui crée une forme de numerus clausus sans le nommer.
À lire aussi :
Quand le cynisme mine l’engagement dans la fonction publique…
Ces professions libérales exercent une mission de service public régulé, plutôt qu’un métier purement concurrentiel.
La start-up nation n’existe pas sans l’État
Même les start-up, qu’on présente souvent comme très indépendantes, bénéficient de nombreux dispositifs publics. Le crédit d’impôt recherche (CIR) réduit le coût des dépenses de recherche et développement (R&D). Il constitue l’un des leviers fiscaux les plus utilisés par les jeunes entreprises technologiques.
De son côté, Bpifrance intervient sous plusieurs formes, comme les garanties de prêts, les co-financements ou les avances remboursables. Elles permettent aux entreprises de lever des fonds ou d’amorcer leur activité dans des conditions qu’elles n’auraient pas obtenues seules.
Les programmes comme France 2030 ou les appels à projets sectoriels complètent cet ensemble, en orientant des financements vers des secteurs jugés stratégiques : petits réacteurs modulaires (SMR), hydrogène vert, véhicules électriques, etc.
Ces soutiens jouent un rôle stabilisateur évident.
Les exploitations agricoles subventionnées
Dans beaucoup d’exploitations agricoles, les aides publiques, qu’elles viennent de la politique agricole commune (PAC) ou de dispositifs nationaux, pèsent lourd dans l’équilibre économique. Les chiffres de l’Insee l’attestent : en 2021, les subventions d’exploitation représentaient en moyenne 38 % de l’excédent brut d’exploitation des fermes qui en bénéficient.
De 2010 à 2022, les aides directes ont couvert jusqu’à 74 % du revenu moyen des exploitations, toutes spécialités confondues.
Certaines filières, comme les grandes cultures ou l’élevage bovin, sont encore plus sensibles à ces soutiens. Sans cet argent, elles seraient dans une situation économique très fragile, comme le confirment plusieurs analyses de l’Insee. L’agriculture française avance donc, selon les années et les filières, quelque part entre marché et subvention, avec des équilibres qui ne reposent jamais entièrement sur les prix de vente.
La culture cofinancée par la puissance publique
D’après le ministère de la Culture, on parle d’environ 739 800 emplois dans le secteur. Une bonne partie de ces emplois existe grâce aux financements publics : théâtres, opéras, musées, festivals, institutions patrimoniales, écoles d’art, associations subventionnées, etc.
Par exemple, le cinéma français fonctionne en grande partie dans un cadre financé ou cofinancé par la puissance publique. Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) publie chaque année le montant des aides versées. En 2023, elles atteindraient 715 millions d’euros pour l’ensemble du secteur – production, distribution, exploitation. À cela s’ajoutent les crédits d’impôt cinéma, les financements des régions, et les obligations imposées aux diffuseurs (chaînes, plates-formes), devant consacrer une part de leur chiffre d’affaires à la création.
Dans les métiers du spectacle – un ensemble qui inclut le spectacle vivant mais aussi le cinéma et l’audiovisuel –, le mécanisme central est celui de l’intermittence. Il s’agit d’un régime d’assurance-chômage adapté aux artistes et techniciens qui alternent périodes d’emploi et de non-emploi. Ce système permet de lisser les revenus et, en pratique, mutualise le risque financier lié à l’irrégularité des projets artistiques – ce que rappelle régulièrement l’Unédic dans ses rapports.
La presse aidée
La presse écrite bénéficie elle aussi d’un ensemble d’aides publiques : subventions directes, TVA réduite à 2,1 %, et dispositifs spécifiques pour soutenir la diffusion. Depuis la loi Bichet de 1947, l’État veille à ce que la diffusion de la presse reste pluraliste et accessible sur tout le territoire. L’objectif est simple : éviter qu’un marché trop étroit ou trop concentré ne fragilise l’indépendance des titres. Les rapports publics consacrés aux aides à la presse rappellent régulièrement ce rôle structurant.
Selon le ministère de la Culture, ces aides à la presse représentent 21,4 % du chiffre d’affaires du secteur en 2021. Les rapports publics sur ces aides soulignent que, sans ce soutien, la situation financière de ces journaux serait encore plus dégradée, avec un risque accru de disparition de certains titres.
25 millions de Français et Françaises ont un revenu dépendant de l’État
Si on regarde uniquement les actifs et qu’on additionne tous les métiers qui dépendent peu ou beaucoup de décisions publiques – fonctionnaires, professions conventionnées, agriculture aidée, secteurs régulés, marchés publics, culture subventionnée, associations, start-up soutenues –, 25 et 30 millions de personnes ont un revenu qui dépend directement de l’État, d’une façon ou d’une autre.
![]()
Jérôme Baray ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. En France, presque tout le monde est fonctionnaire sans le savoir – https://theconversation.com/en-france-presque-tout-le-monde-est-fonctionnaire-sans-le-savoir-270231