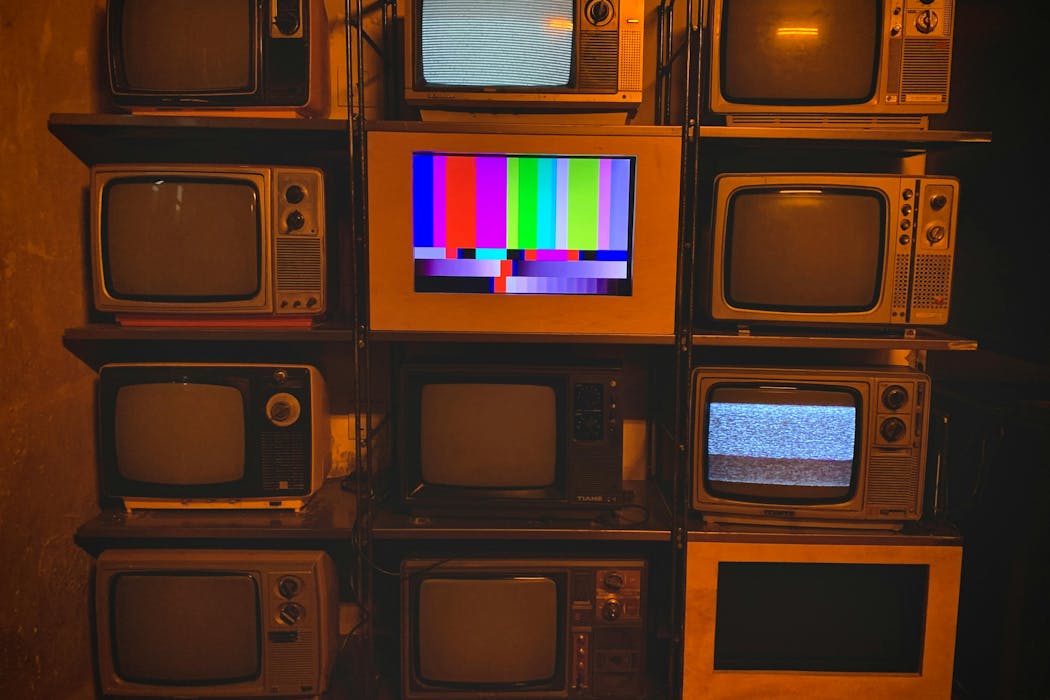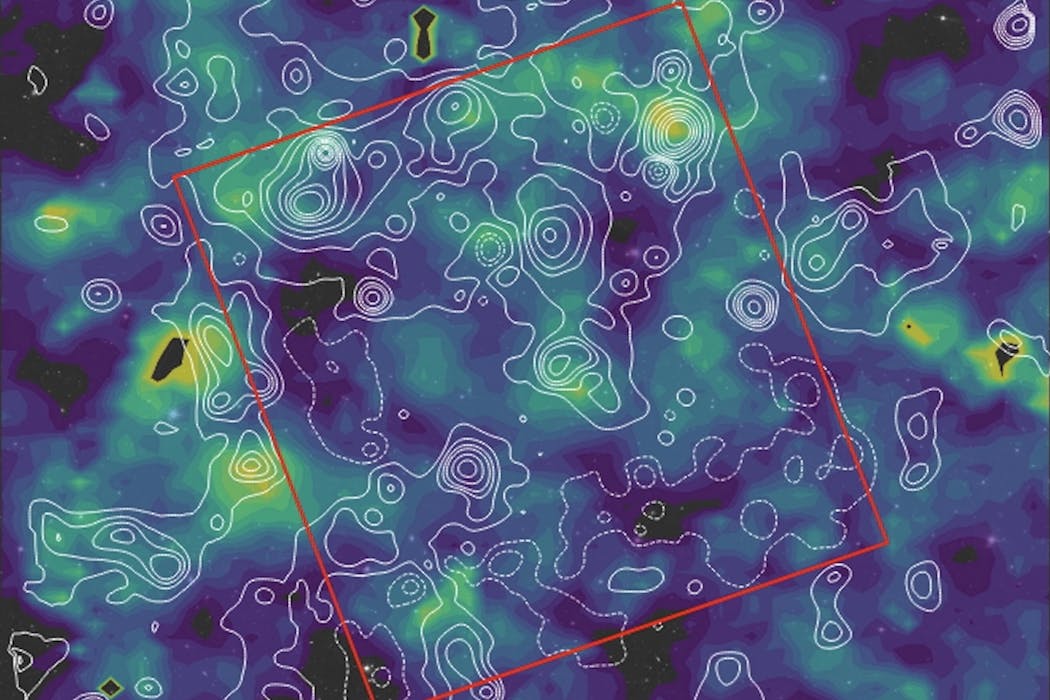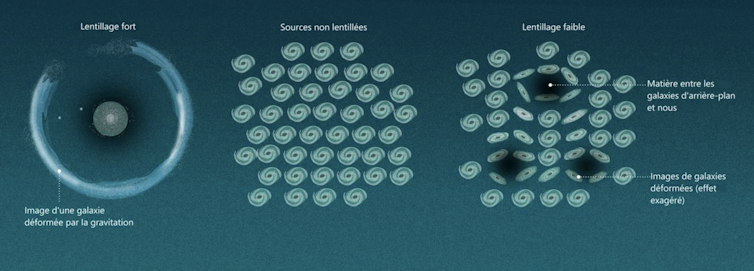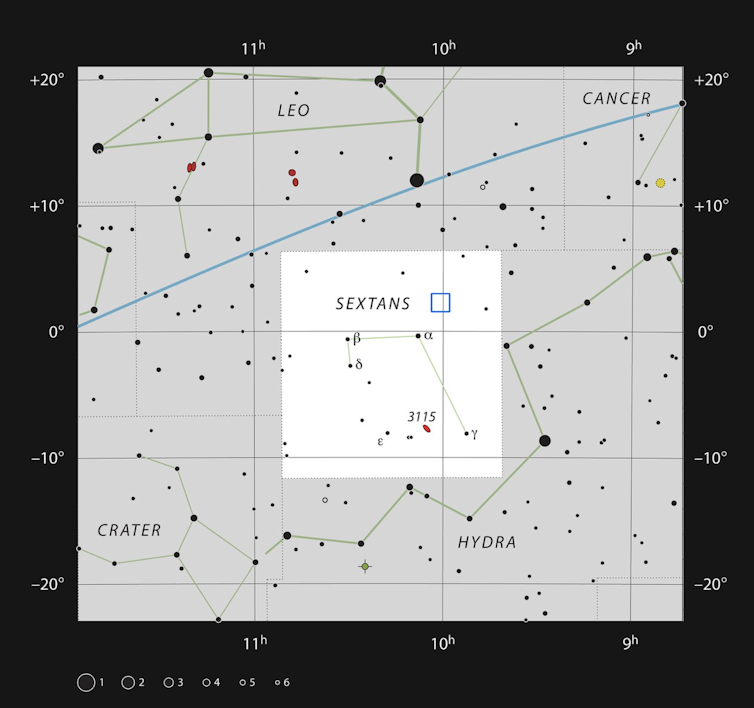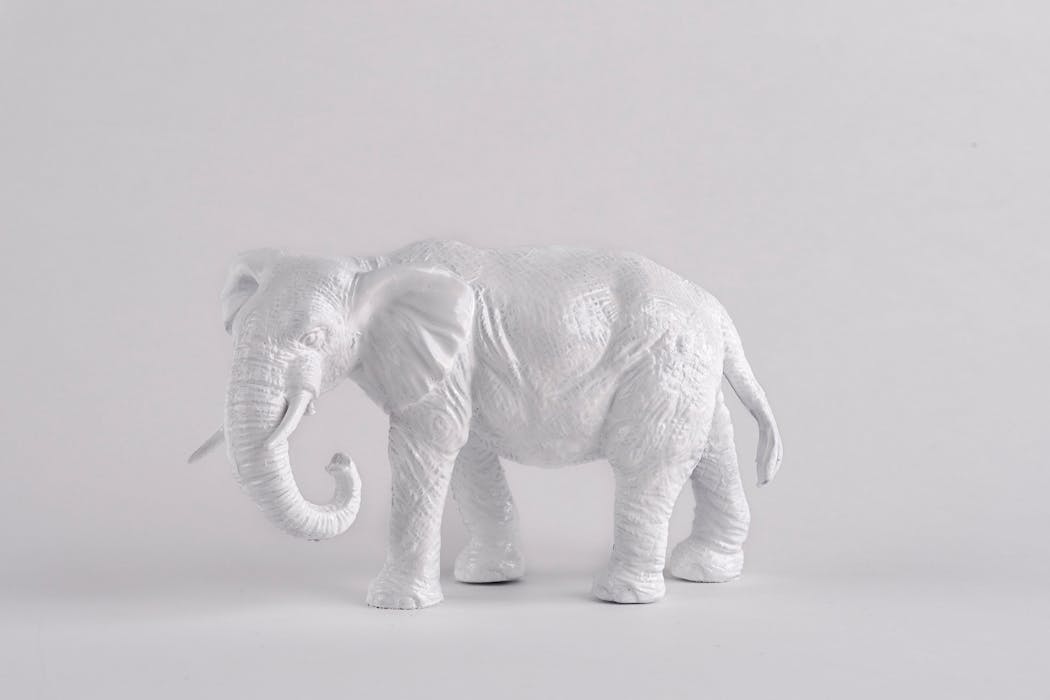Source: The Conversation – in French – By Isaac Nahon-Serfaty, Associate Professor, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Dans un monde de plus en plus façonné par les écrans et les réseaux sociaux, où nos interactions se déroulent à distance, une question fondamentale s’impose : la « masse » humaine s’est-elle dissoute dans le cyberespace, ou bien persiste-t-elle sous de nouvelles formes, numériques et immatérielles ?
Pour répondre à cette question, il convient de revenir au chef-d’œuvre du prix Nobel de Littérature (1981), le Juif séfarade né en Bulgarie Elias Canetti, Masse et Puissance (1960).
Lorsque Canetti rédige cet essai, ses références sont les deux extrêmes des phénomènes de masse du XXe siècle : le nazi-fascisme, vaincu lors de la Seconde Guerre mondiale, et le communisme soviétique, encore bien vivant et puissant à cette époque. De plus, les médias de masse sont en pleine expansion, notamment la télévision, et son effet persuasif, support idéal pour les figures charismatiques, comme l’a démontré le débat entre J. F. Kennedy et Richard Nixon en 1960. On assiste enfin à l’émergence de la culture pop sous l’impulsion d’Elvis Presley et des Beatles.
Professeur titulaire de communication à l’Université d’Ottawa, j’étudie depuis un certain temps comment les réseaux numériques contribuent au façonnement de nos émotions autour des sujets comme la santé, le terrorisme, la politique et la nature. L’Opus Magnus de Canetti m’a aidé à mieux comprendre notre écosystème communicationnel et affectif.
Cet article fait partie de notre série Des livres qui comptent, dans laquelle des experts de différents domaines abordent ou décortiquent les ouvrages qu’ils jugent pertinents. Ces livres sont ceux, parmi tous, qu’ils retiennent lorsque vient le temps de comprendre les transformations et les bouleversements de notre époque.
La densité des foules
La thèse de Canetti ne se contente toutefois pas de traiter d’un problème contemporain. Elle cherche à remonter aux racines du phénomène humain du clan, de la tribu et d’autres manifestations de la vie collective. Son point de départ est le corps. Les premières lignes de Masse et Puissance valent la peine d’être lues :
Il n’est rien que l’homme craigne plus que le contact de l’inconnu […]. L’homme tend toujours à éviter le contact physique avec tout ce qui est étrange. Dans l’obscurité, la peur d’un contact inattendu peut se muer en panique […]. C’est seulement au sein d’une foule que l’homme peut se libérer de cette peur d’être touché. C’est la seule situation dans laquelle la peur se change en son contraire. La foule dont il a besoin est la foule dense, où les corps se pressent les uns contre les autres ; une foule, aussi, dont la constitution psychique est également dense, ou compacte, de sorte qu’il ne remarque plus qui le presse. Dès qu’un homme s’est abandonné à la foule, il cesse de craindre son contact.
La foule à l’ère numérique
Ce contact entre les corps a-t-il une quelconque importance dans les communications virtuelles d’aujourd’hui ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord clarifier ce que nous entendons par le virtuel.
Le philosophe franco-canadien Pierre Lévy, spécialiste des phénomènes collectifs à l’ère d’Internet, affirmait en 2007 qu’il existe un lien indissoluble entre le virtuel et le réel. Selon Lévy, la condition virtuelle renvoie au symbole tandis que le réel renvoie au matériel. Mais il n’y a aucun moyen d’accéder au physique ou au matériel sans se référer au virtuel ou au symbolique.
À lire aussi :
Les réseaux sociaux vous incitent à adopter ces trois comportements primitifs et violents
Cette affirmation sur la prépondérance du symbolique comme médiateur virtuel face au « réel » et même au physique est plus évidente que jamais dans le monde hypermédiatisé dans lequel nous avons tous et toutes à produire et à diffuser des symboles (p.e : les photos, les emojis, les « likes », les textes).
À notre époque de communications virtuelles (toute communication est virtuelle, car elle implique toujours une médiation symbolique), le corps a de nouveau pris une place prépondérante. Son aspect symbolique est plus présent que jamais dans les millions d’images de corps que les gens produisent et consomment via les médias sociaux.
De plus, les conséquences matérielles de ces communications virtuelles se traduisent en actions corporelles, et pas seulement en représentations mentales. Les exemples abondent : manger à partir de la recommandation d’un aliment ou d’une marque sur une plate-forme numérique, avoir des relations sexuelles selon les désirs suscités par des contenus médiatisés, faire de l’exercice en suivant les conseils d’un influencer, ou voyager à partir de l’expérience d’un autre voyageur partagée dans les réseaux numériques.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Mouvement centrifuge et centripète
Canetti établit une distinction entre les foules fermées, celles qui tendent à se limiter, et les foules ouvertes, celles qui cherchent à s’étendre. Les collectifs numériques peuvent également être décrits comme fermés ou ouverts.
Lorsque les membres d’une communauté virtuelle se comportent comme une tribu (un terme que les experts en marketing aiment utiliser), ils activent ce que l’on peut appeler des boucles discursives et imaginaires pour confirmer ou renforcer leurs opinions et leurs comportements. D’un autre côté, les collectifs ouverts dans l’espace numérique cherchent à attirer davantage de corps pour développer des réseaux en expansion, ce qui est typique de Tik Tok ou d’Instagram, qui comptent déjà des milliards d’utilisateurs.
Canetti souligne l’effet réconfortant des corps qui se touchent, créant une entité dans laquelle les corps individuels sont incorporés dans un seul corps collectif plus grand. La masse, qui se présume puissante, n’a pas peur du danger.
C’est justement cette impression de puissance collective, par la multiplication de corps virtuels, qui se reproduit dans les réseaux numériques. Il ne s’agit pas seulement de l’anonymat propre à la communication numérique qui encourage la participation dans ce corps unifié de la multitude (y compris les bots ou robots algorithmiques). C’est l’agrégat de « likes », commentaires et rediffusions qui créent cette entité plus large que l’individu.
À lire aussi :
Active Clubs : le corps comme champ de bataille de l’extrême droite
La masse face à la mort
La force de la masse provient de ce que Canetti appelle le moment de survie, illustré par la situation dans laquelle un clan nomade trouve un cadavre sur la route. La première réaction est le cri déchirant du clan. Ils savent qu’un jour ils mourront tous. Mais, bientôt, les pleurs se transforment en rires, qui s’expriment d’abord avec une certaine réserve, puis résonnent bruyamment. Le clan rit aux éclats, car il sait qu’il est survivant, qu’il vit une victoire momentanée sur la mort.
Relire Masse et Puissance de Canetti à l’heure des multitudes numériques nous aide à mieux comprendre les collectifs virtuels dans lesquels nos corps sont exposés et s’exposent à un large spectre d’émotions, de l’horreur à la sentimentalité kitsch. C’est aussi le réconfort que l’on ressent à être, même virtuellement, parmi tant d’autres afin de sortir d’une solitude de plus en plus répandue. Et il y a, finalement, cette illusion de survie renforcée par la multiplication des images de nos propres corps que l’on décide de partager sur les plates-formes numériques en brisant la distinction entre l’espace privé et l’espace public.
![]()
Isaac Nahon-Serfaty ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Images de nos corps, likes et survie : Le réconfort dans la masse virtuelle – https://theconversation.com/images-de-nos-corps-likes-et-survie-le-reconfort-dans-la-masse-virtuelle-268714