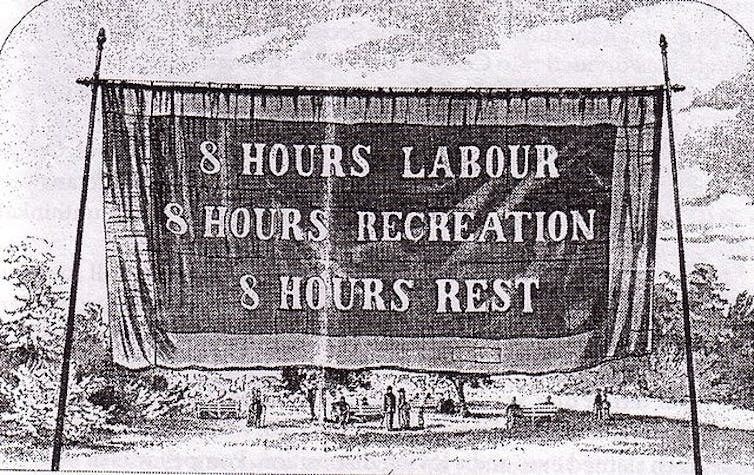Source: – By Tarik Chakor, Maître de conférences en sciences de gestion, Aix-Marseille Université (AMU)

Comment agir efficacement et de manière pérenne pour préserver la santé mentale des individus au travail et prévenir une détérioration de leur qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) ? Un credo : privilégier les petites victoires à une grande défaite. L’acteur clé : le manager de proximité.
La Semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) aura lieu du 16 au 20 juin 2025 sur tout le territoire français. Cette initiative, lancée par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) en 2004 a pour objectif de promouvoir le débat et de favoriser le partage de pratiques en santé au travail, notamment au niveau mental et psychologique.
Bien que présente dans le débat public et scientifique depuis le début des années 2000, notamment avec les travaux de la psychiatre Marie-France Hirigoyen autour du harcèlement moral, puis de la vague de suicides chez France Télécom dès 2006, la question de la santé mentale au travail se pose toujours au sein des organisations. Selon le baromètre Qualisocial-Ipsos 2025 sur la santé mentale au travail, 25 % des salariés estiment avoir une mauvaise santé mentale, avec une population féminine particulièrement touchée – 29 % des femmes, contre 21 % des hommes.
Malgré la succession de quatre plans Santé-Travail, de deux accords nationaux interprofessionnels (ANI) sur la QVT (en 2013 puis en 2020)
ou de multiples rapports officiels, une question semble rester en suspens : comment agir efficacement – et de manière pérenne – pour préserver la santé mentale des individus au travail et prévenir une détérioration de leur QVCT ?
Santé mentale au travail : de quoi parle-t-on ?
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé mentale correspond à « un état de bien-être mental qui nous permet d’affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté ». Elle n’est pas uniquement l’absence de troubles mentaux, mais plutôt un état dynamique pouvant être influencé par de nombreux facteurs. Les causes, mais également les manifestations peuvent varier d’une personne à une autre.
Dans la sphère professionnelle, de nombreux concepts en lien avec la santé mentale ont émergé depuis une vingtaine d’années : stress, risques psychosociaux, burnout, mais également bien-être, qualité de vie au travail (QVT) et QVCT plus récemment, dans une approche plus positive de la santé au travail. La santé mentale au travail concerne tous les niveaux hiérarchiques, tous secteurs d’activité confondus : direction, encadrement, management de proximité, exécutants mais aussi travailleurs indépendants.
« Greatwashing »
Les acteurs tels que l’Anact ou l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), ainsi que de nombreux articles scientifiques, notamment en gestion des ressources humaines, défendent depuis une dizaine d’années une approche spécifique de l’action en santé au travail.
Ils souhaitent débattre collectivement de l’activité réelle de travail, des conditions et du contenu du travail, garantir aux salariés une capacité d’expression et d’action autour de leur travail, co-construire le diagnostic de la situation de travail et proposer des dispositifs adaptés et partagés.
À lire aussi :
Qualité de vie au travail : bienvenue dans l’ère du « greatwashing »
La situation ne semble pas s’améliorer au sein des organisations, elle semble même empirer, notamment au sortir de la crise sanitaire et des épisodes de confinement. De multiples obstacles à la prévention en santé mentale au travail sont apparus :
-
le déni des salariés et/ou de leur encadrement, notamment dans un contexte de crise et d’instabilité économiques ;
-
la difficulté à mettre en mots les maux (pas de liens stricts de cause à effet entre des contextes de travail et des manifestations de dégradation de la santé mentale au travail) ;
-
la forte dimension subjective du vécu du travail et de ses risques.
Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Chaque lundi, des informations utiles pour votre carrière et tout ce qui concerne la vie de l’entreprise (stratégie, RH, marketing, finance…).
Plus largement d’autres obstacles émergent. Certains accords de prévention en entreprise sont scellés a minima. Ils questionnent peu ou pas l’organisation du travail avec des actions plus individualisées (cellules d’écoute, formations, etc.), une déresponsabilisation de l’organisation, privilégiant des actions visibles et sur le court terme, leur permettant de communiquer rapidement, voire d’améliorer leur marque employeur, jusqu’à potentiellement tomber dans le « greatwashing ».
Une autre limite identifiée est en lien avec le taux de rotation des personnels encadrants. Les actions et les résultats de courte durée sont préférés, dans une optique de carrière, plutôt que des actions sur le long terme, dont les résultats sont peu visibles, et donc peu valorisables.
Privilégier les petites victoires à une grande défaite
Nous pensons que, pour être efficace et pérenne, l’action en santé mentale au travail doit reposer sur deux piliers : le pragmatisme managérial et la subsidiarité.
Face aux difficultés telles que l’instrumentalisation de la prévention, les stratégies et rapports de force entre acteurs, la déresponsabilisation de l’organisation et l’individualisation des maux, nous défendons l’idée d’une action modeste, simple, identifiable et identifiée. Elle vise en priorité à agir sur ce qui est possible, faisable, et « au bon niveau », avec les parties prenantes concernées.
Cette stratégie des petits pas et des petits groupes, appliquée au management de la santé au travail, semble lever certains blocages. Elle permettrait aux acteurs de s’entendre plus facilement sur les termes employés, facilitant un diagnostic partagé, situé, dans un périmètre limité – un service, un groupe de travail, une équipe, etc. Cette stratégie faciliterait également l’instauration d’un dialogue et d’une saine conflictualité, ou la rendrait a minima moins complexe et risquée. Le principe de subsidiarité prendrait ici tout son sens, en réglant le problème là où il se pose, par et avec les personnes directement concernées.
Toute ambition démesurée en santé au travail nous semble perdue d’avance, voire contre-productive, la gestion de la santé mentale au travail pouvant paradoxalement dégrader cette dernière.
Le rôle du manager de proximité nous semble décisif : bien que la QVCT soit « l’affaire de toutes et de tous », elle nous semble être particulièrement l’affaire de ces encadrants, positionnés au plus proche du réel, en prise avec sa complexité et pouvant, plus que les autres, mettre en débat l’activité de travail.
![]()
Tarik Chakor ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Mieux accompagner la santé mentale au travail : la stratégie des petits pas – https://theconversation.com/mieux-accompagner-la-sante-mentale-au-travail-la-strategie-des-petits-pas-248922