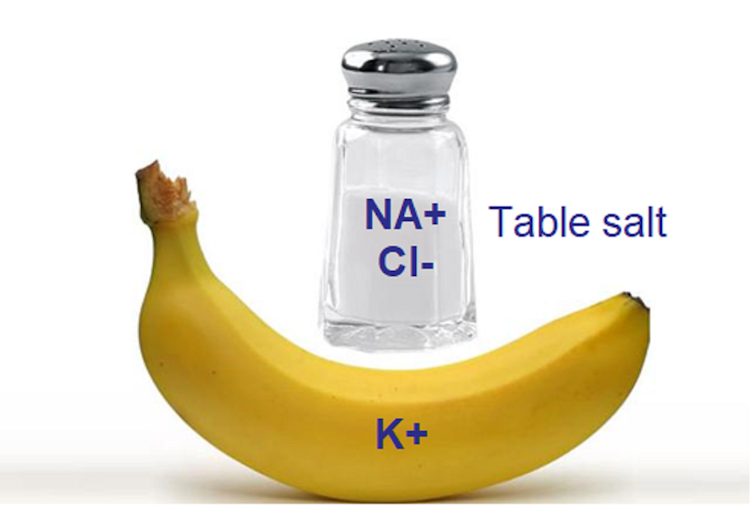Source: The Conversation – Indonesia – By Pauline Bellot, Chercheuse postdoctorale à l’Université du Québec à Montréal (UQAM, laboratoire AVITOX), Université du Québec à Montréal (UQAM)
Moins connus que les insecticides, les fongicides triazolés sont pourtant très présents dans les milieux agricoles. L’un d’eux, le tébuconazole, est suspecté d’affecter la santé des oiseaux. Notre étude expérimentale met en effet en évidence des altérations du métabolisme, de la reproduction et de la survie chez les jeunes moineaux.
Depuis 1900, la population mondiale a quintuplé, ce qui a posé un défi de taille : nourrir toujours plus d’humains. Dans les années 1950-1960, la « révolution verte » a permis d’augmenter considérablement les rendements agricoles grâce à la modernisation et à l’intensification des pratiques agricoles. Cette mutation s’est appuyée en partie sur l’usage massif d’engrais et de pesticides, dont l’utilisation n’a cessé de croître au fil des décennies.
Les triazoles, des fongicides omniprésents
Parmi les pesticides, on trouve trois grandes catégories : les herbicides qui tuent les végétaux considérés comme indésirables, les insecticides qui s’attaquent aux insectes considérés comme nuisibles, et les fongicides. Ces derniers, destinés à lutter contre les champignons pathogènes des plantes, représentent en France près de 42 % des ventes totales de pesticides, soit une part bien supérieure à la moyenne mondiale.
Cette proportion élevée s’explique notamment par le poids de la viticulture dans l’agriculture française, les vignes étant particulièrement vulnérables aux maladies fongiques comme le mildiou.

Fourni par l’auteur
Parmi les fongicides, une famille se distingue : celle des triazoles. Très prisés pour leur efficacité contre un éventail de maladies fongiques, ces composés sont utilisés sur des cultures aussi variées que les céréales, les fruits ou la vigne. Aujourd’hui, les triazoles représenteraient à eux seuls environ un quart des ventes mondiales de fongicides.
Aux États-Unis, leur utilisation a augmenté de 400 % en seulement dix ans, entre 2006 et 2016.
Les oiseaux, sentinelles des milieux agricoles
Mais cet usage massif soulève des inquiétudes. Les triazoles sont suspectés d’être des perturbateurs endocriniens, c’est-à-dire d’interférer avec le système hormonal des êtres vivants, et d’impacter des espèces non ciblées. En la matière, les oiseaux sont dangereusement vulnérables. En effet, nombre d’entre eux, l’alouette des champs, le busard cendré ou le merle noir par exemple, accomplissent tout ou une partie de leur cycle de vie dans les milieux cultivés, c’est-à-dire des territoires où les fongicides triazolés peuvent se retrouver dans les sols, l’eau ou l’air, et contaminer la faune par l’intermédiaire des graines ou des insectes consommés par de nombreux oiseaux.
Une étude récente a ainsi révélé des concentrations particulièrement élevées de triazoles dans le sang de merles noirs vivant dans des zones viticoles intensives.
Cette exposition, qu’elle soit directe ou indirecte, pourrait nuire à leur santé, à leur reproduction ou au bon fonctionnement de leur organisme. Les oiseaux sont depuis longtemps considérés comme de bons indicateurs biologiques : leur présence, leur comportement ou leur état de santé donnent des indices de la qualité de l’environnement. En particulier dans les zones agricoles, leur déclin peut révéler des problèmes comme la pollution ou la dégradation des habitats. Et les tendances sont alarmantes : depuis 1980, 60 % des oiseaux des terres agricoles ont disparu en Europe.
Comprendre les causes pour mieux agir : l’enjeu d’une approche ciblée
Si les pesticides, triazoles inclus, participent potentiellement à ce déclin, ils ne sont pas les seuls en cause. La perte d’habitats naturels, l’intensification des pratiques agricoles, la mécanisation et le changement climatique exercent également une pression croissante sur la biodiversité.
Face à cette dégradation multifactorielle, les oiseaux nous envoient un signal d’alarme. Il est plus que jamais nécessaire de comprendre quelle pression exerce quels effets, et dans quelle mesure. Cela suppose de pouvoir isoler l’impact propre de chaque facteur, en particulier celui des contaminants chimiques, afin d’identifier précisément leur rôle dans les déclins observés et ainsi mieux orienter les mesures de conservation et de réglementation.
Pour cela, il est nécessaire de les étudier isolément, dans des conditions contrôlées. C’est pourquoi nous avons choisi de nous pencher sur un fongicide triazolé en particulier : le tébuconazole.
Il s’agit du fongicide que nous avons le plus fréquemment détecté chez les oiseaux vivant en zone viticole, et également de l’un des plus utilisés dans le monde.
Pour en évaluer les effets, nous avons mené une étude en conditions contrôlées sur des moineaux domestiques, une espèce typique des milieux agricoles, aujourd’hui en déclin. Faciles à maintenir en captivité, y compris pour la reproduction, les moineaux domestiques constituent un modèle biologique pertinent pour explorer les effets du tébuconazole en conditions expérimentales.
Les individus ont été répartis aléatoirement dans six volières expérimentales : trois recevaient une eau non contaminée et les trois autres une eau contenant du tébuconazole à des concentrations réalistes, comparables à celles mesurées chez des oiseaux vivant en milieu viticole intensif.

Abonnez-vous dès aujourd’hui.
Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ».
Des effets sur le métabolisme et la survie des juvéniles
Après plusieurs mois d’exposition, nous avons analysé divers paramètres de santé chez les adultes, notamment le métabolisme, les hormones thyroïdiennes et l’immunité. Nous avons aussi suivi la reproduction, la croissance des poussins, leur survie, ainsi que plusieurs indicateurs de succès reproducteur.

Fourni par l’auteur
Pour la première fois, nos recherches ont montré que le tébuconazole, un fongicide largement utilisé en agriculture, peut perturber de manière significative la physiologie et la reproduction des oiseaux.
Chez les moineaux adultes exposés pendant plusieurs mois, nous avons observé une dérégulation des hormones thyroïdiennes, essentielles à la croissance, au métabolisme et à la mue. Bien que nous n’ayons pas trouvé d’effet sur l’immunité, le métabolisme des oiseaux était réduit.
Une diminution du métabolisme signifie que les oiseaux dépensent moins d’énergie pour assurer leurs fonctions vitales, ce qui peut réduire leur niveau d’activité, limiter leur capacité à maintenir leur température corporelle et ralentir des processus essentiels comme le fonctionnement cérébral ou la réparation des tissus.
De plus, la qualité de leur plumage était diminuée avec des plumes moins denses, ce qui pourrait altérer leur isolation thermique et leur efficacité en vol par exemple. Nous avons également obtenu des résultats notables du côté de la reproduction. Le tébuconazole a été transféré de la mère à ses œufs, exposant ainsi les poussins dès les premiers stades de leur développement. Ce transfert maternel s’est accompagné d’effets marqués : les poussins issus de parents exposés au tébuconazole présentaient une anomalie de croissance, environ 10 % plus petits en fin de développement, ainsi qu’une mortalité accrue.
Ces effets étaient particulièrement prononcés chez les femelles : leur taux de mortalité atteignait 65 % dans le groupe exposé, contre seulement 7 % dans le groupe témoin. Ces résultats suggèrent une sensibilité accrue au fongicide selon le sexe, et soulèvent des questions quant à la survie des jeunes dans les milieux contaminés.
Vers une meilleure régulation des usages ?
Ainsi, le tébuconazole pourrait représenter l’un des facteurs contribuant au déclin des oiseaux, en particulier dans les paysages agricoles intensifs.
Fait notable : ces effets sont survenus à une concentration environ 36 fois inférieure au seuil actuellement utilisé pour évaluer la toxicité reproductive chez les oiseaux. Bien que notre étude porte sur une seule molécule, elle met en lumière un angle mort persistant : la toxicité des fongicides reste encore largement sous-estimée, au profit d’une attention historique portée aux insecticides.
Or, dans les milieux cultivés, les espèces sont exposées à des mélanges complexes de pesticides, aux effets potentiellement cumulatifs ou synergiques. Mieux comprendre ces interactions ouvre de nouvelles pistes de recherche pour affiner l’évaluation des risques et repenser les pratiques agricoles dans une perspective plus durable et respectueuse de la biodiversité.

![]()
Cette recherche a été financée par l’Agence Nationale de la Recherche (projet ANR VITIBIRD attribué à F.A.), par la Région Nouvelle-Aquitaine (projet MULTISTRESS), par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (projet ANSES BiodiTox attribué à F.B.), par le Centre National de la Recherche Scientifique ainsi que par MITI-PEPSAN (mission pour les initiatives transversales et interdisciplinaires, attribuée à C.F.).
Ce travail a également été soutenu par le partenariat PARC (WP4), financé par l’Union européenne dans le cadre de la subvention 101057014. Les points de vue et opinions exprimés n’engagent toutefois que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour la recherche ; ni l’Union européenne ni l’autorité de financement ne peuvent en être tenues responsables.
Frédéric Angelier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Comment l’un des pesticides les plus répandus en France menace les moineaux – https://theconversation.com/comment-lun-des-pesticides-les-plus-repandus-en-france-menace-les-moineaux-257032