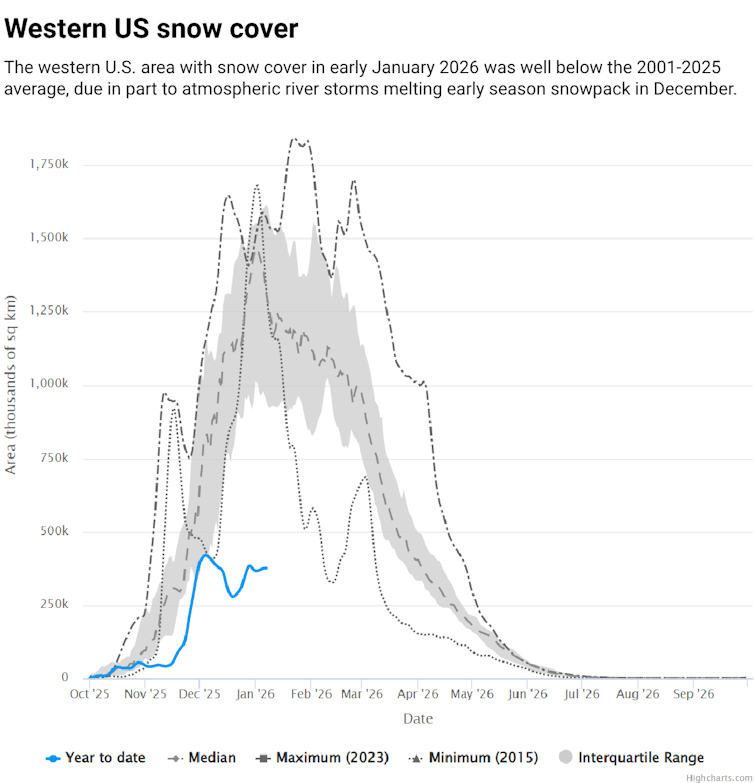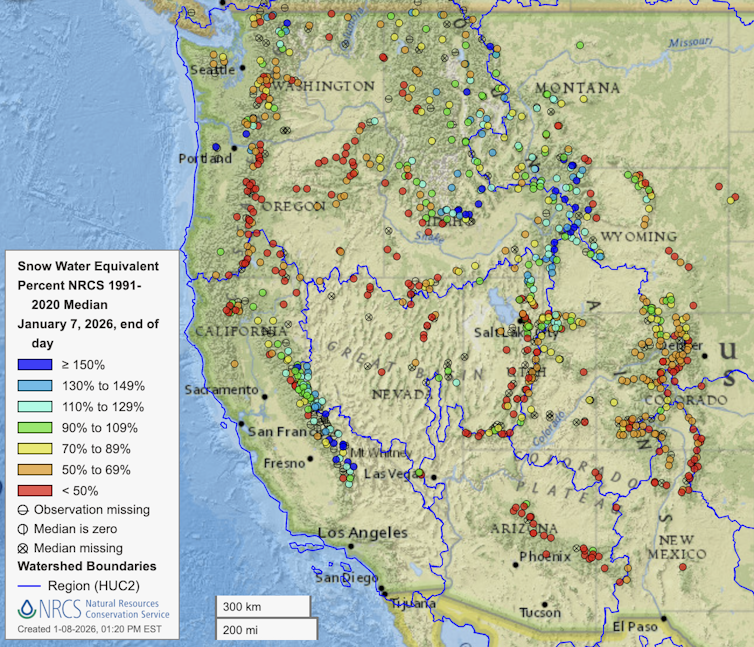Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ana Belén Soto, Profesora de Filología Francesa, Universidad Autónoma de Madrid
“Hoy murió mamá. O quizás ayer, no lo sé”.
Con estas palabras constituía el escritor Albert Camus, nacido en la Argelia francesa, uno de los inicios más reconocidos y recordados de la literatura dando vida a El extranjero. El éxito de esta novela se hizo sentir desde su primera publicación en 1942 en la editorial Gallimard con la venta 360 000 ejemplares. En la actualidad, sigue figurando entre los tres libros de bolsillo más vendidos en Francia y ha sido traducido a más de cuarenta de idiomas. En español, la versión más reciente es la realizada en 2025 por María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego para la editorial Random House.
Tal y como recuerda la experta en literatura francesa Alice Kaplan en su libro Enquête de l’Étranger, la fascinación que provoca esta novela se basa en la complejidad de un razonamiento poliédrico que abarca desde la alegoría colonial y la filosofía del absurdo hasta el cuestionamiento de la moral tradicional, la desconexión personal o la pena de muerte.
Más allá de su indiscutible valor literario, su resonancia cultural y su actualidad han propiciado una adaptación cinematográfica por uno de los cineastas franceses más aclamados del siglo XXI: François Ozon. Es la segunda versión en la gran pantalla de una novela cuya complejidad técnica radica en la esencia misma de la narración: ¿cómo trasladar al cine la subjetividad intrínseca al monólogo interior de un personaje caracterizado por la indiferencia?
Las imágenes y la voz en off
En la adaptación de 1967, dirigida por Luchino Visconti y protagonizada por Marcello Mastroianni, predominaba la voz en off para expresar la introspección del protagonista. Ozon, sin embargo, opta por una puesta en escena minimalista marcada por el silencio y la música clásica para enfatizar la neutralidad emocional del personaje.
Así, utiliza el principio narrativo de “mostrar, no contar” para sustituir la psicología verbal por una visual que expresa la indiferencia del protagonista, Mersault, y la reacción social ante la misma. Al mismo tiempo refuerza la mirada desnuda de un observador que funciona como metáfora de la filosofía del absurdo. La apatía de Meursault revela una reflexión profunda sobre el vacío ontológico de la condición humana ante un mundo desprovisto de sentido. Esto resulta especialmente interesante porque la imagen expone al espectador al propio vacío del personaje. Se da entonces un lenguaje híbrido entre la literatura y el cine que despierta la voz en off en la mente de la audiencia.
La elección estética del blanco y negro en el filme resulta también interesante, dado que privilegia la ambivalencia existente entre la luz y la sombra, la claridad y la oscuridad, el calor y el frío. Las sensaciones se convierten así en el motor de la narrativa audiovisual.
De igual modo, la opción cromática enfatiza la sensación de atemporalidad de la película y nos transporta, según el propio cineasta, a las imágenes de archivo que tenemos de la Argelia francesa, respondiendo así a su adscripción en el imaginario colectivo. De hecho, en la película existe una introducción a la Argelia de los años 30 que contextualiza el pasado colonial francés en ese espacio en el que coexistían dos comunidades –la francesa y la árabe– sin llegar a convivir. Así lo recuerda el propio Ozon cuando explica la falta de interacción entre los unos y los otros, a la vez que enfatiza la mirada consciente del propio Camus sobre estas tensiones.
Un continuo flashback
La perspectiva tomada por el cineasta también importa. Lejos de reproducir la cronología literaria, levanta el telón de la representación con Benjamin Voisin, el actor que interpreta a Mersault, afirmando en una celda colectiva: “He matado a un árabe”. La mirada del conjunto de reclusos, árabes en su aparente totalidad, se fija en él, reina el silencio y se hace la noche.
El sueño representa una estructura simbólica que traduce visualmente el flashback de la intrahistoria. La atmósfera onírica se encuentra, además, potenciada por dos referencias intertextuales que se suceden en sendos planos consecutivos. En primer lugar, una rata recorre la celda haciendo un guiño a La peste, otra de las novelas que elevaron la figura de Camus al Premio Nobel de Literatura en 1957. Seguidamente, Meursault ve una cucaracha al mirarse la mano, lo que supone otra licencia del director que, más allá de la simbología repulsiva de este insecto socialmente despreciado, evoca la representación simbólica del icono kafkiano por excelencia: el insecto en el que Gregorio Samsa se transforma en La metamorfosis. Ambas alusiones enfatizan la deshumanización, la otredad, la alienación y el absurdo.

BTeam Pictures
El papel de los indígenas
Otra de las licencias cinematográficas es la nominalización de los personajes árabes que articulan el relato. El árabe asesinado y su hermana se llaman Moussa Hamdani y Dejmila, respectivamente. Son nombres cargados de significado, dado que Moussa es la forma árabe de Moisés –profeta del exilio– y Djemila evoca a Djamila Bouhired, activista del Frente de Liberación Nacional e icónica figura de la resistencia argelina.
Ozon otorga, además, un patronímico a estos dos personajes, marcando así la pertenencia a un linaje culturalmente reconocible. Con ello, se subraya la dimensión humana de estos indígenas, excluidos de la consideración de ciudadanos franceses según el Decreto Crémieux (1870). Además, se inscribe en una reflexión cultural y política planteada desde la crítica poscolonial. El nombre de Djémila también evoca la intertextualidad literaria, dado que en la antigua ciudad romana del mismo nombre se desarrolla el segundo relato de Bodas, la primera publicación de Camus.
Se trata, en resumen, de una adaptación que sublima en la imagen la sensibilidad filosófica y estética de Camus a la vez que introduce una lectura crítica que dialoga con las interpretaciones contemporáneas. Ozon asume así el desafío de trasladar al lenguaje audiovisual una novela que ya existe en la imaginación de millones de lectores para subrayar la vigencia de un texto que se interesa por lo íntimo y lo cotidiano, por las tensiones profundas de las dinámicas personales y que cuestiona las normas sociales.
![]()
Ana Belén Soto no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. François Ozon traslada a la gran pantalla el monólogo interior de ‘El extranjero’, de Albert Camus – https://theconversation.com/francois-ozon-traslada-a-la-gran-pantalla-el-monologo-interior-de-el-extranjero-de-albert-camus-270240