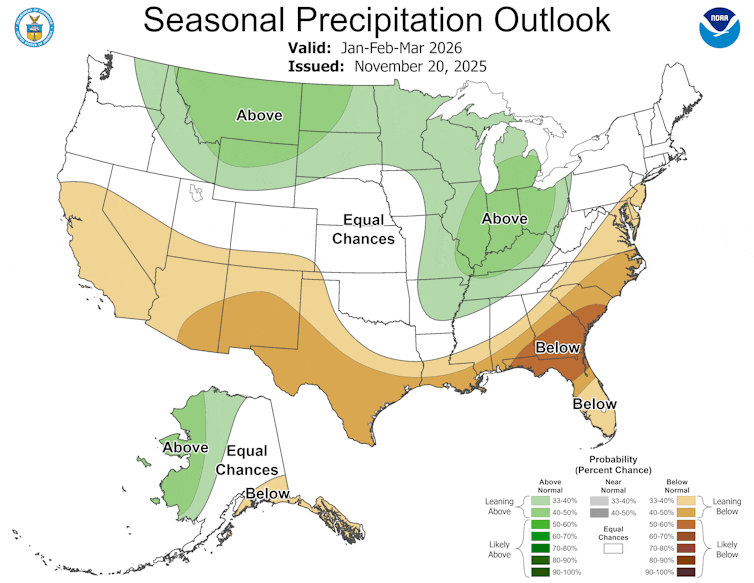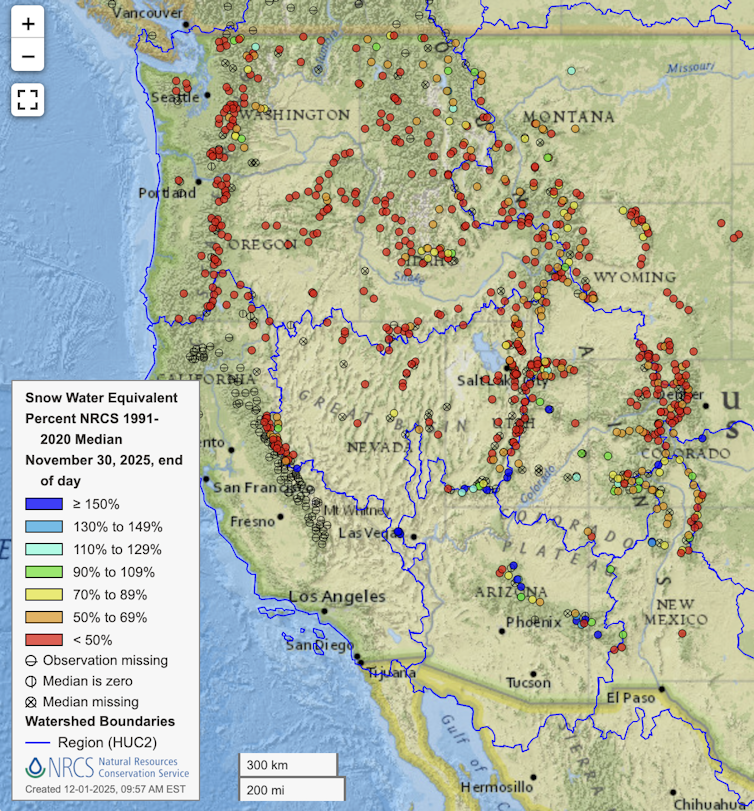Source: The Conversation – in French – By Samer Kayal, Professeur des Universités- Praticien Hospitalier (Microbiologie), Université de Rennes 1 – Université de Rennes
L’équipe du Pr Samer Kayal a effectué, auprès de patients du CHU de Rennes, en Ille-et-Vilaine, un travail pionnier de collecte de « Streptococcus pyogenes », un pathogène responsable de 500 000 décès par an dans le monde, et d’une autre bactérie génétiquement proche (« Streptococcus dysgalactiae sous-espèce equisimilis ») réputée moins dangereuse. Dans le cadre d’une collaboration transatlantique, la perte de sensibilité de « S. pyogenes » aux antibiotiques a été découverte et le séquençage de l’ensemble des souches bretonnes ont été mises à la disposition de l’ensemble de la communauté des chercheurs.
En 1847, près de quinze ans avant la preuve de l’existence des microbes apportée par Louis Pasteur, un médecin du nom d’Ignace Semmelweis avait déjà eu une intuition : il pensait qu’un agent invisible, sans doute transmis par les mains des médecins, pouvait être responsable des infections graves chez les femmes après l’accouchement.
De cet agent, on sait aujourd’hui qu’il s’agissait d’une bactérie appelée Streptococcus pyogenes.
« Streptococcus pyogenes », c’est 500 000 décès par an dans le monde
Cette espèce bactérienne vit uniquement chez l’être humain. Elle peut se trouver dans la gorge ou sur la peau, sans forcément provoquer une infection. Mais parfois, elle cause des maladies bénignes, comme une angine (mal de gorge d’origine bactérienne), ou des infections graves, qui peuvent être mortelles si elles ne sont pas soignées à temps.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que, chaque année, dans le monde, 700 millions d’infections sont provoquées par cette bactérie, dont 600 millions rien que pour la gorge. Et malheureusement, environ 500 000 personnes en meurent chaque année, ce qui en fait l’une des dix causes majeures de décès.
Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique. Malgré les recherches, il n’existe toujours pas de vaccin efficace contre cette bactérie. Heureusement, elle reste généralement sensible aux antibiotiques, en particulier aux pénicillines, qui font partie de la grande famille des bêta-lactamines.
Une sensibilité aux pénicillines qui risque de ne pas durer
Les bêta-lactamines agissent comme des verrous qui viennent bloquer des éléments essentiels pour la survie de la bactérie, l’empêchant de se multiplier et finissant par la tuer. Leur cible est une protéine spécifique (appelée PLP, pour « protéine liant la pénicilline »), indispensable à la construction de la paroi protectrice de la bactérie.
Schématiquement, quand l’antibiotique se fixe à la PLP, celle-ci n’est plus active et la bactérie meurt. Cependant, si la PLP est altérée du fait de mutations de son gène, il résulte une réduction de l’efficacité de la liaison des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines à la PLP : la bactérie devient moins sensible à l’antibiotique, voire franchement résistante, comme c’est le cas pour d’autres espèces de streptocoques, notamment Streptococcus pneumoniae.
Streptococcus pyogenes est classiquement sensible aux bêta-lactamines. Par conséquent, les tests de sensibilité (antibiogrammes), qui sont réalisés afin de vérifier que ces antibiotiques seront efficaces pour soigner l’infection, ne sont pas toujours effectués avant de traiter les patients.
Pourtant certains laboratoires ont récemment [rapporté] une diminution de la sensibilité de la sensibilité de certaines souches de Streptococcus pyogenes aux bêta-lactamines par un mécanisme similaire : on aurait affaire à des mutations de la protéine PLP de la bactérie, qui seraient sans doute favorisées par un traitement mal adapté (dosages d’antibiotiques insuffisants, ou traitement mal suivi par les patients).
Une collecte de streptocoques auprès de patients du CHU de Rennes
Au CHU Ponchaillou-Université de Rennes, dès 2009, notre équipe de recherche a eu la clairvoyance de commencer à collecter tous les échantillons de cette bactérie parallèlement à ceux d’une autre espèce très proche génétiquement, appelée Streptococcus dysgalactiae sous-espèce equisimilis (SDSE). Ces échantillons provenaient de patients du département d’Ille-et-Vilaine, hospitalisés au CHU de Rennes.
Grâce à l’importance de cette collecte systématique, il a été possible de décrire en détail l’évolution des infections causées par cette bactérie au sein de la population de la région, sur une période d’une dizaine d’années. Ce travail a permis d’instaurer une étroite collaboration avec le Pr James Musser, un expert mondial de Streptococcus pyogenes basé à Houston, aux États-Unis.
L’analyse des gènes de toutes ces souches a montré que la bactérie Streptococcus pyogenes intégrait fréquemment des morceaux d’ADN provenant de SDSE (cette sous-espèce de bactérie proche génétiquement, ndlr). Plus préoccupant, ces recherches montraient pour la première fois, que ces échanges génétiques modifiaient considérablement la protéine PLP de S. pyogenes, [ce qui rendait la bactérie moins sensible] à de nombreux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines.
Cette découverte importante tire une sonnette d’alarme : elle montre que la résistance de Streptococcus pyogenes aux antibiotiques de première ligne est probablement sous-estimée et qu’elle pourrait se propager.
Il est donc primordial de maintenir une surveillance permanente pour déceler rapidement l’apparition de bactéries résistantes et éviter qu’elles ne deviennent une menace pour la santé publique.
SDSE, une espèce bactérienne méconnue à ne pas sous-estimer
L’intérêt des scientifiques et des médecins s’est rapidement porté sur l’analyse des échantillons de bactérie SDSE recueillis pendant la même période que ceux de Streptococcus pyogenes.
Depuis quelques années, de nombreuses équipes à travers le monde signalent en effet une augmentation surprenante des infections graves à SDSE, correspondant probablement à la diffusion d’une souche particulière de SDSE (appelée « stG62647 »). Jusqu’alors, cette espèce bactérienne était très peu étudiée car on la considérait surtout comme un simple « résident » inoffensif de la peau ou de la gorge, rarement responsable d’infections sévères.
Grâce à la collaboration transatlantique des équipes rennaise et états-unienne, l’analyse génétique d’environ 500 échantillons collectés à Rennes a permis de dater précisément la première détection de cette souche particulière stG62647 : elle serait apparue en 2013 et se serait rapidement répandue dans la région de l’Ille-et-Vilaine. Il s’agit d’une souche très homogène génétiquement, ce qui signifie qu’elle descend récemment d’un « ancêtre » commun particulièrement bien adapté à son hôte, l’être humain.
La sévérité de l’infection liée aux caractéristiques du malade
Un travail effectué en laboratoire afin de mieux comprendre les différentes étapes du processus infectieux par SDSE a permis aux chercheurs de prendre conscience de la complexité des mécanismes de virulence. Ils ont également soulevé un paradoxe : malgré leur grande similitude génétique, les SDSE présentent des niveaux de dangerosité (virulence) très variables.
Cette découverte suggère que la gravité des infections dépend de mécanismes de régulation complexes de la bactérie, qui sont liés à la manière dont elle interagit avec la personne qu’elle infecte.
En d’autres termes, la sévérité de l’infection ne dépend pas seulement de la bactérie elle-même, mais aussi des caractéristiques propres à chaque personne infectée. C’est ce que les chercheurs ont décrypté dans leur dernière publication sur le sujet.
Des implications importantes pour la santé publique
Riches de l’expérience acquise sur S. pyogenes, ces travaux pionniers sur cette autre bactérie SDSE révèlent que de nombreux secrets restent à découvrir pour les deux bactéries. Mais d’ores et déjà, les implications de ces résultats sont importantes pour :
-
le diagnostic et la surveillance de la résistance aux antibiotiques, car les laboratoires doivent désormais être plus vigilants pour détecter les souches résistantes ;
-
la surveillance continue des infections pour prévenir l’émergence de nouveaux clones bactériens virulents ;
-
le développement de nouveaux traitements, car la compréhension des mécanismes de virulence ouvre la voie à de nouvelles cibles thérapeutiques et à d’éventuelles nouvelles approches vaccinales.
Un modèle de recherche collaborative efficace pour la santé
Cette collaboration franco-états-unienne illustre l’importance de combiner différentes approches : surveillance de terrain, analyse génétique, étude de l’expression des gènes et tests sur les organismes.
Les chercheurs ont ainsi mis à disposition de la communauté scientifique internationale l’ensemble des données génétiques des souches bretonnes, ce qui va faciliter les recherches futures sur ces bactéries d’intérêt croissant en santé publique.
Cette recherche dite « translationnelle » – qui va du laboratoire au patient (from bench to bedside, en anglais) – est très efficace pour mieux anticiper les crises infectieuses futures. Elle permet d’adapter nos stratégies de prévention et de traitement face à l’évolution constante des agents pathogènes.
![]()
Samer Kayal ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Des souches bretonnes de streptocoques étudiées aux États-Unis et dans le monde pour mieux lutter contre ces bactéries virulentes – https://theconversation.com/des-souches-bretonnes-de-streptocoques-etudiees-aux-etats-unis-et-dans-le-monde-pour-mieux-lutter-contre-ces-bacteries-virulentes-265808