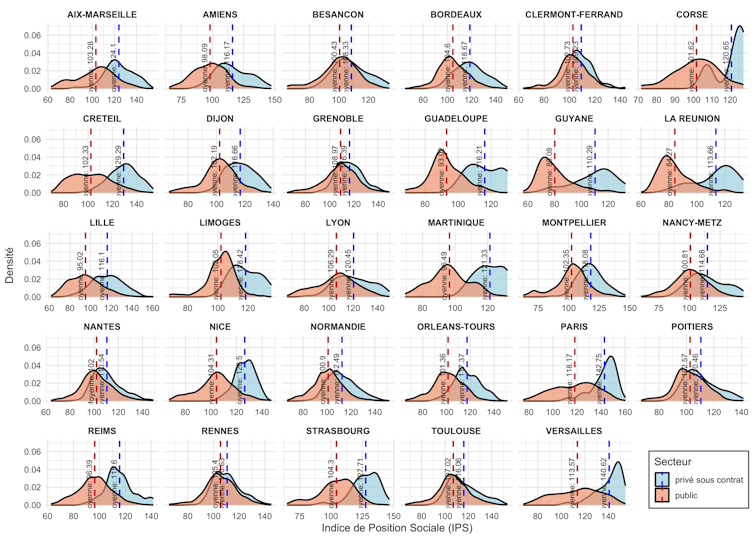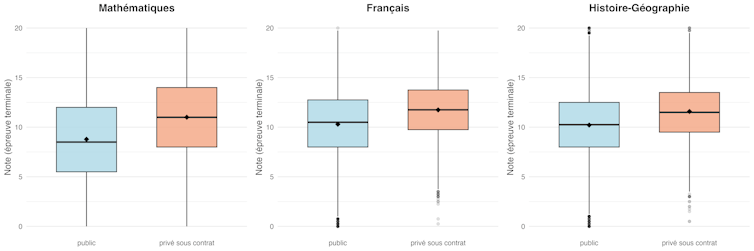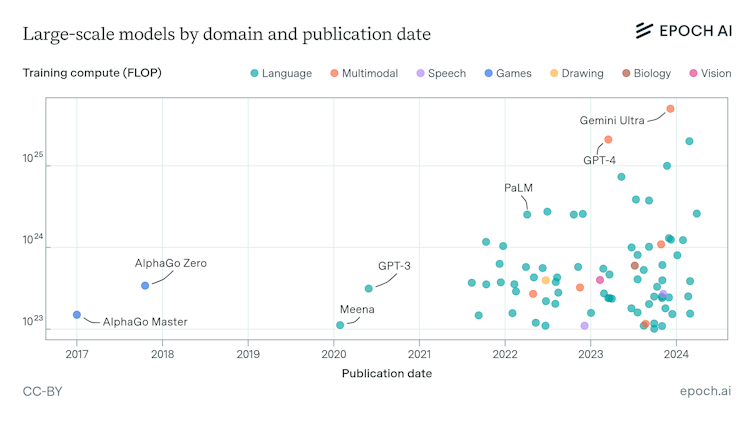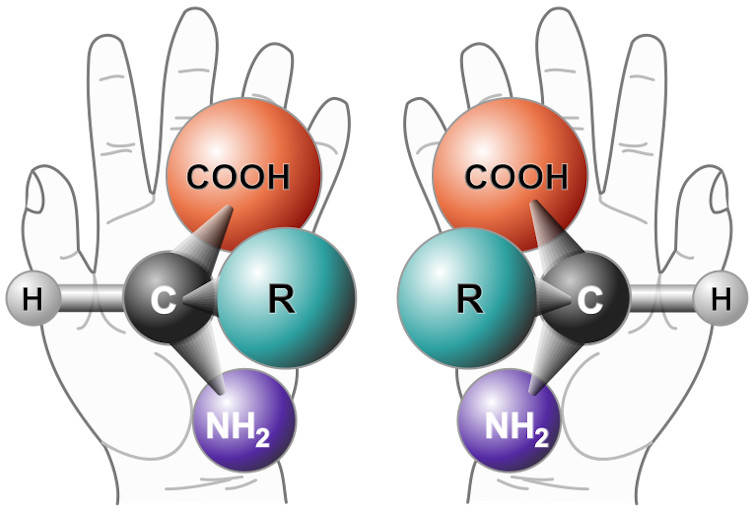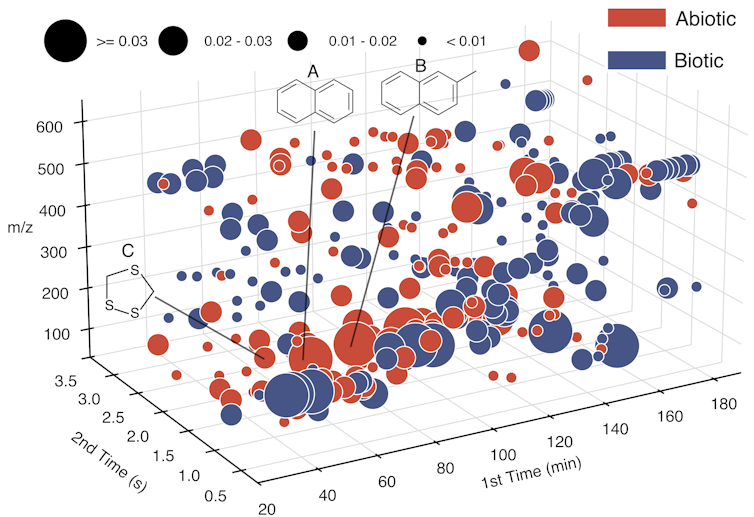Source: The Conversation – France (in French) – By Giada Pizzoni, Marie Curie Research Fellow, Department of History, European University Institute
Blagues obscènes, questions intrusives, gestes déplacés : les archives inquisitoriales du Vatican montrent que le harcèlement sexuel au confessionnal était une réalité pour de nombreuses femmes dans l’Italie du XVIIIᵉ siècle – et que certaines ont osé le signaler.
L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes définit le harcèlement sexuel comme « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Les agissements sexistes découlent du pouvoir et visent à exercer un contrôle psychologique ou sexuel. Dans les deux cas, les victimes se sentent souvent confuses, seules, et se croient parfois responsables des abus subis.
En tant qu’historienne, je cherche à comprendre comment les femmes ont vécu et affronté ces comportements intimidants. Je m’intéresse en particulier au harcèlement pendant la confession dans l’Italie du XVIIIe siècle. Les femmes catholiques se rendaient au confessionnal pour partager leurs doutes et leurs espoirs sur des sujets allant de la reproduction aux menstruations, mais elles étaient parfois confrontées à des remarques méprisantes ou déplacées qui les déstabilisaient.
Un déséquilibre des pouvoirs
Les archives du Vatican nous montrent que certains des hommes qui ont tenu ces propos avaient tendance à en minimiser la portée, les qualifiant de simples marques de camaraderie ou de curiosité, voire de vantardise. Ils ont pourtant rabaissé les femmes qui, après ces échanges, étaient bouleversées ou en colère. Ces femmes étaient souvent plus jeunes que leurs confesseurs, elles avaient moins de pouvoir et pouvaient subir des menaces les contraignant à se taire. Pourtant, les archives nous montrent également que certaines, jugeant ces échanges inappropriés, se sont opposées à ces abus.
Les archives contiennent les procès-verbaux des tribunaux de l’Inquisition, qui, dans toute la péninsule italienne, traitaient les signalements de harcèlement et d’abus dans les confessionnaux. Pour les femmes, la confession était primordiale car elle dictait la moralité. Le devoir d’un prêtre était de demander aux femmes si elles étaient de bonnes chrétiennes, et la moralité d’une femme était liée à sa sexualité. Les canons de l’Église enseignaient que le sexe devait être uniquement hétérosexuel, génital et se dérouler dans le cadre du mariage.
Mais si la sexualité était encadrée par un code moral de péché et de honte, les femmes étaient des agents sexuels actifs, apprenant par l’expérience et l’observation. Le fonctionnement interne du corps féminin était mystérieux pour elles, mais le sexe ne l’était pas. Alors que les hommes lettrés avaient accès à des traités médicaux, les femmes apprenaient grâce aux connaissances échangées au sein de la famille et avec les autres femmes. Cependant, au-delà de leur cercle quotidien, certaines femmes considéraient le confessionnal comme un espace sûr où elles pouvaient se confier, remettre en question leurs expériences et demander des conseils sur le thème de la sexualité. Les ecclésiastiques agissaient alors comme des guides spirituels, des figures semi-divines capables d’apporter du réconfort, ce qui créait un déséquilibre de pouvoir pouvant conduire à du harcèlement et des abus.
Signaler les cas de harcèlement
Certaines femmes victimes d’abus dans le confessionnal l’ont signalé à l’Inquisition, et les autorités religieuses les ont écoutées. Dans les tribunaux, les notaires ont consigné les dépositions et les accusés ont été convoqués. Au cours des procès, les témoins ont été contre-interrogés afin de corroborer leurs déclarations. Les condamnations variaient : un ecclésiastique pouvait être condamné à jeûner ou à faire des exercices spirituels, à être suspendu, exilé ou envoyé aux galères (travaux forcés).
Les archives montrent qu’au XVIIIe siècle en Italie, les femmes catholiques comprenaient parfaitement les blagues grivoises, les métaphores et les allusions qui leur étaient adressées. En 1736 à Pise, par exemple, Rosa alla trouver son confesseur pour lui demander de l’aide, inquiète que son mari ne l’aime pas, et il lui conseilla « d’utiliser ses doigts sur elle-même » pour éveiller son désir. Elle fut embarrassée et rapporta cet échange inapproprié. Les documents d’archives montrent fréquemment que les femmes étaient interrogées si leur mariage ne produisait pas d’enfants : on leur demandait si elles vérifiaient que leur mari « consommait par derrière », dans le même « vase naturel », ou si le sperme tombait à l’extérieur.
En 1779, à Onano, Colomba a rapporté que son confesseur lui avait demandé si elle savait que pour avoir un bébé, son mari devait insérer son pénis dans ses « parties honteuses ». En 1739, à Sienne, une femme de 40 ans sans enfant, Lucia, s’est sentie rabaissée lorsqu’un confesseur lui a proposé de l’examiner, affirmant que les femmes « avaient des ovaires comme les poules » et que sa situation était étrange, car il suffisait à une femme « de retirer son chapeau pour tomber enceinte ». Elle a signalé cet échange comme une ingérence inappropriée dans sa vie intime.
Les archives du confessionnal montrent des exemples de femmes à qui l’on disait : « J’aimerais te faire un trou » ; qui voyaient un prêtre frotter des anneaux de haut en bas sur ses doigts pour imiter des actes sexuels ; et à qui l’on posait la question suggestive de savoir si elles avaient « pris cela dans leurs mains » – et chacune de ces femmes comprenait ce qui était insinué. Elles comprenaient aussi que ces comportements relevaient du harcèlement. Autant d’actes et de paroles que les confesseurs considéraient, eux, comme du flirt – comme lorsqu’un prêtre invita Alessandra à le rejoindre dans le vignoble en 1659 – étaient jugés révoltants par les femmes qui rapportaient ces événements (Vatican, Archivio Dicastero della Fede, Processi vol. 42).
L’effet déconcertant des abus
À cette époque, le stéréotype selon lequel les femmes plus âgées n’avaient plus de sexualité était très répandu. En effet, on croyait que les femmes dans la quarantaine ou la cinquantaine n’étaient plus physiquement aptes à avoir des rapports sexuels, et leur libido était ridiculisée par la littérature populaire. En 1721, Elisabetta Neri, une femme de 29 ans qui cherchait des conseils pour soulager ses bouffées de chaleur qui la mettaient hors d’état de fonctionner, s’est entendu dire qu’à partir de 36 ans, les femmes n’avaient plus besoin de se toucher, mais que cela pouvait l’aider à se détendre et à soulager son état.
Les femmes étaient également interrogées de manière fréquente et répétée sur leur plaisir : se touchaient-elles lorsqu’elles étaient seules ? Touchaient-elles d’autres femmes, des garçons ou même des animaux ? Regardaient-elles les « parties honteuses » de leurs amies pour comparer qui « avait la nature la plus grande ou la plus serrée, avec ou sans poils » (ADDF, CAUSE 1732 f.516) ? Pour les femmes, ces commentaires représentaient des intrusions inappropriées dans leur intimité. D’après les harceleurs masculins, il s’agissait d’une forme de curiosité excitante et une façon de donner des conseils : un frère franciscain, en 1715, a ainsi démenti avoir fait des commentaires intrusifs sur la vie sexuelle d’une femme (ADDF, Stanza Storica, M7 R, procès 3).
En quête de conseils avisés, les femmes confiaient leurs secrets les plus intimes à ces érudits, et elles pouvaient être déconcertées par l’attitude que leurs confesseurs affichaient souvent. En 1633, Angiola affirmait avoir « tremblé pendant trois mois » après avoir subi des violences verbales (ADDF, vol. 31, Processi). Les remarques déplacées et les attouchements non désirés choquaient celles qui en étaient victimes.
Le courage de s’exprimer
Il est indéniable que la sexualité est un objet culturel, encadré par des codes moraux et des agendas politiques qui font l’objet de négociations constantes. Les femmes ont été sans cesse surveillées, leur corps et leur comportement étant soumis à un contrôle permanent. Cependant, l’histoire nous enseigne que les femmes pouvaient être conscientes de leur corps et de leurs expériences sexuelles. Elles discutaient de leurs doutes, et certaines se sont ouvertement opposées au harcèlement ou aux relations abusives.
Au XVIIIe siècle en Italie, les femmes catholiques n’avaient pas toujours les mots pour qualifier les abus dont elles étaient victimes, mais elles savaient reconnaître qu’elles ne vivaient pas toujours un échange « honnête » dans le confessionnal, et parfois elles ne l’acceptaient pas. Elles ne pouvaient pas y échapper, mais elles avaient le courage d’agir contre un tel abus.
Une culture d’abus sexuels est difficile à éradiquer, mais les femmes peuvent s’exprimer et obtenir justice. Les événements des siècles passés montrent qu’il est toujours possible de dénoncer, comme c’est encore le cas aujourd’hui.
Note de l’auteur : les références entre parenthèses dans le texte renvoient à des documents consultables conservés dans les archives du Vatican.
![]()
Giada Pizzoni a reçu une bourse Marie Skłodowska-Curie de la Commission européenne.
– ref. Dans l’Italie du XVIIIe siècle, les femmes s’insurgeaient contre le harcèlement sexiste et sexuel subi dans les confessionnaux – https://theconversation.com/dans-litalie-du-xviii-sup-e-sup-siecle-les-femmes-sinsurgeaient-contre-le-harcelement-sexiste-et-sexuel-subi-dans-les-confessionnaux-271118