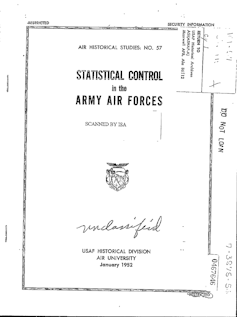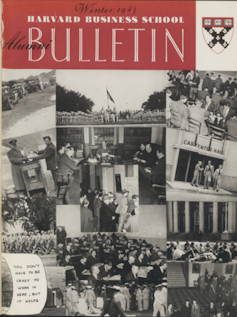Source: The Conversation – (in Spanish) – By Greg Barton, Chair in Global Islamic Politics, Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalisation, Deakin University
Con 15 civiles y un hombre armado muertos hasta el momento, y otras 40 personas heridas, Australia se recupera del peor acto terrorista cometido en su territorio. Dos hombres armados abrieron fuego contra una comunidad judía que se había reunido para celebrar la primera noche de Hanukkah en Archer Park, en la famosa playa Bondi Beach de Sídney.
La policía ha confirmado que los dos presuntos atacantes eran padre e hijo, de 50 y 24 años. El padre, Sajid Akram, que tenía licencia para poseer seis armas de fuego, fue abatido por la policía. El hijo, Naveed Akram, permanece bajo custodia policial en el hospital.
Dado que se trataba claramente de un ataque antisemita, las autoridades lo declararon poco después como un acto de terrorismo, es decir, un acto de violencia por motivos políticos. Esta calificación también proporciona a las autoridades recursos adicionales para responder y llevar a los responsables ante la justicia.
Mientras los australianos tratan de asimilar su conmoción y su dolor, ha surgido cierta indignación en la comunidad por la falta de medidas suficientes para proteger a los judíos australianos del creciente antisemitismo evidente desde el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 y la consiguiente guerra de Gaza.
Lo que sabemos sobre los presuntos atacantes
El director general de la ASIO (Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad), Mike Burgess, ha dicho que uno de los presuntos atacantes era “conocido” por la ASIO, aunque no especificó cuál. Ser “conocido” por las autoridades puede significar simplemente que alguien ha estado asociado con redes y comunicaciones que han causado preocupación a las autoridades. La televisión pública australiana ABC ha informado de que Naveed Akram llamó la atención de las autoridades tras la detención del líder de la célula del Estado Islámico en Sídney, Isaac El Matari, en julio de 2019.
Sin embargo, hay cientos de personas que llaman la atención de las autoridades por su contacto, tanto en línea como fuera de ella, con redes e individuos extremistas. Con recursos limitados (y los recursos de las autoridades siempre serán limitados, independientemente de la financiación de que dispongan), tienen que aplicar un sistema de clasificación para evaluar la amenaza que puede suponer un individuo o un grupo, y gestionar el riesgo lo mejor que pueden.
Evalúan cuidadosamente lo que se dice y el lenguaje utilizado, por ejemplo, y comprueban si la persona tiene antecedentes de violencia. Por muy enfadada y molesta que esté la gente, como es comprensible, tras un incidente tan horrible, hay que reconocer que las autoridades no pueden simplemente detener a todo aquel que exprese ideas extremistas o tenga vínculos pasajeros con elementos extremistas.
Aún necesitamos saber más sobre este ataque terrorista y los presuntos atacantes, pero hasta la fecha no hay pruebas de que exista una red en funcionamiento. Dado que los presuntos autores eran padre e hijo, técnicamente se ajusta al perfil de un ataque “aislado”, como vimos en el asalto al Lindt Cafe de Sídney en 2014 y en Christchurch en 2019.
Es muy difícil para las autoridades predecir y, por lo tanto, prevenir los ataques de actores solitarios. Por su naturaleza, a menudo no hay señales previas de la posibilidad de violencia. Además, los lugares públicos como la reserva de Bondi Beach requieren amplios recursos para su vigilancia, lo que significa que no todos pueden estar adecuadamente protegidos.
Como señaló Burgess en su evaluación anual de amenazas, “nuestra mayor amenaza sigue siendo un actor solitario que utiliza un arma fácil de conseguir”. Lamentablemente, eso ha demostrado ser cierto.
La naturaleza cambiante de la amenaza terrorista en Australia
En los últimos años se ha prestado mucha atención al auge del extremismo y el terrorismo de extrema derecha.
Una de las mejores guías al respecto es la evaluación anual de amenazas de Burgess. En ella explica que, hace una década, solo uno de cada diez casos que seguía la ASIO estaba relacionado con extremistas de derecha, ya que la mayor parte de su atención se centraba en los grupos islamistas radicales. Sin embargo, en los últimos años, la proporción se ha acercado a una de cada dos investigaciones relacionadas con el extremismo de derecha. En otras palabras, gran parte de la atención y los recursos de la ASIO se dedican ahora necesariamente a la lucha contra ese extremismo, especialmente tras el atentado terrorista de Christchurch, en el que 51 personas fueron asesinadas a tiros por un terrorista australiano de extrema derecha durante la oración del viernes en dos mezquitas de Nueva Zelanda.
En términos más generales, el terrorismo islámico sigue siendo una amenaza mundial. El Estado Islámico y Al Qaeda continúan activos en Oriente Medio y, cada vez más, en África, así como en Asia Central y Afganistán. En general, las autoridades están haciendo un buen trabajo a la hora de controlar cualquier amenaza que estas redes puedan suponer en Australia.
No hay duda de que el ambiente general entre los grupos propalestinos y judíos se ha vuelto mucho más febril a raíz del ataque de Hamás y la guerra de Gaza. Hay mucha ira y frustración, ya que cada día se retransmiten escenas de violencia y sufrimiento, y hemos visto un aumento tanto del antisemitismo como de la islamofobia desde que comenzó la guerra, simplemente por la forma en que se desarrolla en la imaginación de la gente.
Pero incluso en las protestas que hemos visto durante muchos meses, el número de personas que podrían utilizar este sentimiento para incitar a la violencia es reducido.
Una vez más, no hay pruebas de que el tiroteo de Bondi formara parte de una red más amplia, y es muy difícil detener el ataque de un actor solitario en un lugar público.
Por otra parte, el hombre cuyo acto heroico, muy elogiado, de arrebatarle una de las armas al presunto tirador ha sido identificado como Ahmed Al-Ahmed, un musulmán de 43 años propietario de una frutería. Se espera que la valentía de este hombre, que nos mostró lo mejor de la humanidad en medio de lo peor, ponga fin a cualquier análisis simplista que culpe a la comunidad musulmana de tal violencia. Ya hemos visto esto en Estados Unidos, y Australia debe hacerlo mucho mejor.
¿Ha hecho lo suficiente el Gobierno?
Es muy difícil garantizar la seguridad total de los eventos públicos al aire libre. Los edificios son relativamente fáciles de proteger, pero un parque en la playa lo es mucho menos.
No podemos cerrar todas las lagunas ni frustrar todos los riesgos. No podemos impedir que la gente recurra a la violencia, ni podemos controlar todos los pensamientos de odio.
Es evidente que el Gobierno australiano debe hacer más para detener el terrorismo, y los eventos públicos son un objetivo obvio para destinar más esfuerzos. Pero va a costar mucho trabajo averiguar dónde podemos utilizar mejor los recursos.
![]()
Greg Barton es rector (director académico) de la Universidad Deakin Lancaster Indonesia (DLI). Greg recibe financiación del Consejo Australiano de Investigación. Participa en una serie de proyectos financiados por el Gobierno australiano cuyo objetivo es comprender y combatir el extremismo violento en Australia, el sudeste asiático y África.
– ref. Australia se está recuperando del peor ataque terrorista sufrido en su territorio: ¿se podría haber evitado? – https://theconversation.com/australia-se-esta-recuperando-del-peor-ataque-terrorista-sufrido-en-su-territorio-se-podria-haber-evitado-272081